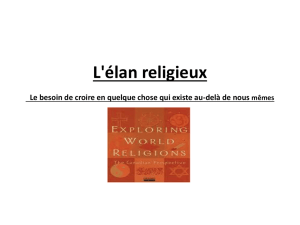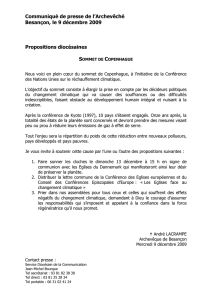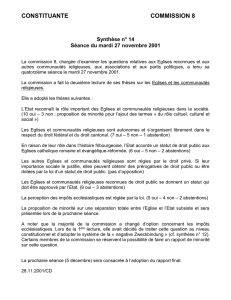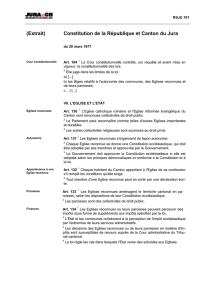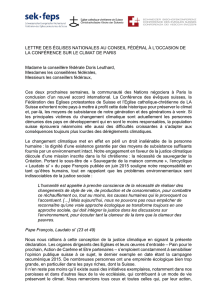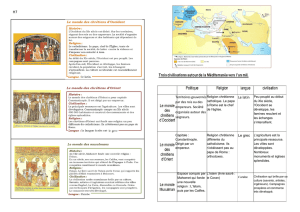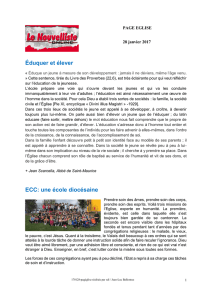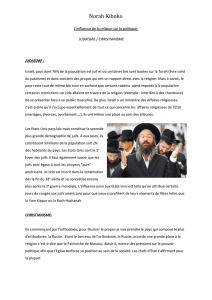Le 19e, siècle de l`affrontement de la science et de la religion

Dissertation d’histoire Conférence de Mr Ferragu
Léopold Scharwitzel
Le 19e, siècle de l’affrontement de la science et
de la religion ?
Institut d’Etudes Politiques de Paris Premier cycle, première année

Dans son Esquisse d’un tableau des progrès de l’esprit humain, Condorcet présente
l’histoire comme le cheminement de la Raison qui prend lentement conscience d’elle-même.
L’esprit humain doit lutter contre les superstitions qui l’asservissent. Cette opposition
classique entre la Raison qui s’exerce dans les sciences et la religion est assez récente. En
effet, la science telle qu’elle existe aujourd’hui, avec ses méthodes (recours à l’observation et
au raisonnement) et ses objectifs, est née au 17e siècle. De l’Antiquité à la Renaissance, on
parle davantage de « philosophies naturelles », car la connaissance du monde est alors
intimement liée à des fins métaphysiques. Cette science a pris ses distances avec la religion
dès lors que les scientifiques ont compris que les Eglises gêneraient leur travail plutôt qu’elle
ne le favoriseraient. Dès le 16E et le 17e, des conflits opposaient l’Eglise à des théories
susceptibles de contester la validité du dogme. La condamnation de Galilée en 1633 au nom
de la Bible en est certainement l’exemple le plus frappant. Mais les éclatants succès de la
période 1770-1820 donnent à la science un véritable pouvoir intellectuel et social : elle ne se
limite plus à chercher à comprendre le monde, mais elle vise à améliorer la condition de
l’homme, notamment par la médecine ou par de nouvelles techniques de production. Elle
offre donc une nouvelle éthique du bonheur détachée de l’idée religieuse de grâce ou de salut.
Dès lors, elle se pose en compétiteur de la religion. Comment concilier les exigences du
dogme et de la foi avec l’évolution de la pensée scientifique au cours du 19e siècle ? Nous
verrons d’abord que l’opposition entre science et religion naît au cours du 19e pour devenir
une lutte ouverte. Puis, nous analyserons les tentatives de réconciliation des deux domaines
initiées par les milieux scientifiques et puis par les Eglises.
A. La dichotomie entre science et religion se développe au cours du
siècle et finit par paraître insurmontable.
1. Progrès et émancipation des sciences.
Le conflit entre la science et la religion naît du décalage croissant de l’autorité
« éternelle » et « certaine » des Eglises avec l’observation et l’interprétation des phénomènes
naturels. Progressivement, la science s’intéresse à la connaissance de la terre, à la vie animale
et végétale, au corps et enfin à l’esprit humain. Cette évolution accroît l’importance de la
science dans la vie quotidienne de l’homme du 19e siècle, particulièrement dans la
Bildungsbürgertum allemande ou dans les classes moyennes cultivées.
L’héritage des Lumières
L’autorité théologique avait déjà été érodée par la révolution copernicienne. Mais c’est
au 18e siècle que l’attaque de la sciences contre la théologie est la plus vigoureuse, d’autant
parce qu’elle s’appuie sur le mouvement philosophique des Lumières. Buffon publie son
Histoire Naturelle à partir de 1749. Il rejette l’idée newtonienne de création divine du système
solaire, l’attribuant plutôt à un phénomène naturel. Il refuse le Déluge et son estimation de
l’histoire de la Terre est en évidente contradiction avec les estimations antérieures, fondées
sur la Bible. Il finit par être condamné par la Sorbonne et se rétracte. L’idée d’évolution, qui
sera la pomme de discorde entre théologiens et scientifiques, commence à apparaître en
astronomie avec Kant (Histoire générale et théorie des cieux) ou, un peu plus tard, avec
Laplace (Exposition du système du monde). Ainsi, sans remettre en cause le dogme de façon
radicale (à l’exception de la période révolutionnaire), le 18e prépare le terrain aux grands
bouleversements du siècle suivant.

L’apparition d’une vérité terrestre
C’est donc au 19e que l’influence conjuguée du rationalisme, de la Révolution
française et des progrès scientifiques permet à la science de se dégager de la tutelle séculaire
de l’Eglise. L’espérance et le bonheur cessent d’être liés au Salut ou à la grâce divine. La
science, parce qu’elle propose une alternative, devient une puissance autonome. Elle ne
reconnaît que les phénomènes matériels et attribue une valeur supérieure au principe de
causalité. Aussi fait-elle redescendre les problèmes terrestres sur Terre. Si la médecine était
jusqu’alors subordonnée à l’Eglise avec les hôpitaux, une répartition des tâches entre le
médecin chargé du corps et le prêtre chargé de l’âme du patient, une substitution courante du
prêtre au médecin (pourtant interdite au concile de Latran de 1139), le corps médical organise
son émancipation progressive en limitant l’ingérence des Eglises : « La science médicale n’est
et n’aurait jamais dû être tributaire de la métaphysique » affirme Broussais. L’opinion
publique du 19e soutient largement ce jugement. L’Eglise finit par reculer en adoptant les
vaccins antivarioliques et les anesthésies. Elle se rallie aux thèses hygiéniques qu’elle avait
d’abord combattues. Elle tente toutefois de créer sa propre thérapeutique (pèlerinages, lutte
contre les pratiques païennes, constatation de miracles) et de garder une influence sur les
médecins catholiques.
2. La rupture des années 50-60 et la réaction manquée des Eglises.
La révolution évolutionniste
Le contexte du milieu du 19e est très favorable à une remise en cause de la religion. La
foi dans le progrès est alors extrêmement forte (Renan, l’Avenir de la science, 1849). Toute la
lutte va se concentrer sur le problème de l’évolution. Pour l’orthodoxie, le monde avait été
créé en 6 jours, et il avait immédiatement contenu tous les corps qu’on pouvait rencontrer). La
science était tenue de rester dans un cadre étroit de 6000 ans. En 1859, Darwin fait paraître De
l’origine des Espèces au moyen de la sélection naturelle ou la lutte pour l’existence dans la
nature. Dans ce livre, il part du constat que tous les êtres vivants présentent des variations
organiques individuelles puisqu’une reproduction orientée peut fixer héréditairement certaines
de ces variations. Les êtres vivants sont aptes à être sélectionnés d’une manière analogue au
sein de la nature. D’autre part, il existe une capacité naturelle d’occupation totale et rapide de
tout le territoire par les représentants d’une seule espèce, animale ou végétale, se reproduisant
sans obstacle. Comme il existe des équilibres naturels constitués par la coexistence, sur un
même territoire, de représentants de multiples espèces, il doit y avoir un mécanisme
régulateur et éliminatoire qui réduit l’extension numérique de chaque population : c’est la
lutte pour l’existence (struggle for life) qui effectue cette sélection naturelle. Ce principe
s’oppose très clairement à l’idée théologique de création indépendante d’espèces immuables
par un créateur omni-prévoyant. Les espèces descendent les unes des autres suivant un
processus continu de divergence, par le moyen de modifications survenant « au hasard » et
qui sont sélectionnées et transmises . Le darwinisme sonne donc le glas de la fixité des
espèces, de l’histoire courte de la genèse, du principe de Providence et, surtout, du caractère
unique de l’homme du point de vue théologique. Quelques théologiens vont faire observer
que les hommes ont des âmes immortelles, contrairement aux animaux, qu’ils ont un sens du
bien et du mal et que c’est eux, et non les singes, que le Christ a voulu sauver. En fait, ils
auront bien du mal à endiguer la progression de l’évolutionnisme, du moins dans les milieux
scientifiques et éclairés. La théorie de l’évolution est sans doute le coup le plus dur porté à la
théologie depuis Copernic, puisque l’admettre oblige à remettre en cause la Création divine.

Le mutisme des Eglises et le retour à la scolastique
Mis à part quelques théologiens, le clergé ignore tous ces problèmes. Le bas clergé en
particulier vit en vase clos durant la majeure partie du siècle. Après la vague de
déchristianisation de la fin du 18e siècle, le renouveau religieux est important, mais face aux
évolutions de la science et de la pensée scientifique, les Eglises optent pour un retour aux
valeurs sûres du dogme et s’opposent à toute tentative d’exégèse. Le bas clergé est, par sa
formation, incapable de répondre aux critiques ou de donner à réfléchir aux adversaires. On
compte peu de savants catholiques. Les critiques du dogme sont seulement interprétées
comme des tentations du démon. L’Eglise catholique choisit la voie du thomisme. Le Concile
de Vatican I proclame le pouvoir de la raison de reconnaître Dieu avec certitude. Léon XIII
exalte volontairement le thomisme dans l’encyclique aeterni Patris (1879) : on peut atteindre
les vérités naturelles et surnaturelles par la raison. Parallèlement, le protestantisme connaît un
mouvement fondamentaliste très puissant.
Dès le 18e, le conflit entre la science et la religion devient latent pour éclater dans les
années 1850-1860, alors que la capitalisme se développe et que la foi dans le progrès est plus
forte que jamais. Les premières désillusions économiques et sociales vont toutefois apaiser le
conflit et amener les deux camps à tenter un rapprochement.
B. Les Eglises, comme les milieux scientifiques, tentent de réconcilier ces
« deux faces de la vie sociale » (Russell).
1. Science et croyances
La science comme religion
Face à l’échec des religions traditionnelles, certains scientifiques et philosophes
proposent de leur substituer une religion de la science. Dans son Avenir de la Science, Renan
affirme que « la science ne vaut d’autant qu’elle peut rechercher ce que la Révélation prétend
affirmer. » Il ajoute dans la préface du même livre : « la science est donc ma religion. » La
science ne doit donc pas seulement comprendre le monde, mais également proposer certaines
valeurs capables de combler le vide laissé par la déchristianisation. Le mouvement le plus
significative de cette évolution du discours scientifique est le positivisme d’Auguste Comte.
Dans le Cours de philosophie positive, Comte expose les grandes thèses de sa doctrine par
l’observation de l’histoire de l’humanité : une loi des trois Etats (âge théologique, âge
métaphysique, âge positif) et une hiérarchie des sciences à laquelle il adjoint une méthode de
travail qui vise à expliquer des phénomènes simples pour évoluer vers des phénomènes de
plus en plus complexes. A partir de 1848, le positivisme cherche à peser sur le cours du siècle.
Mais Comte comprend que le positivisme ne peut être une religion « froide », sans quoi elle
ne suscitera aucun engouement. Il met donc en place des institutions internes qui visent à
relier les adeptes entre eux et à l’Humanité (calendrier, nouvelles fêtes). D’autre part, il
n’hésite pas à introduire des aspects sentimentaux avec le culte de Clotilde de Vaux. Le
Catéchisme positiviste précise le dogme, le culte et le régime de cette religion de l’Humanité.
Comte ne mène pas une guerre contre la religion en elle-même, qu’il juge nécessaire pour
assurer l’ordre social -d’autant qu’il spécule aisément sur des causes scientifiques pour
justifier l’ordre social (ex des femmes)-, mais contre le « surnaturel » et le « révélé »,
auxquels il oppose le « naturel » et le « démontré ».

La science comme justification à l’ordre moral, social et politique
Pendant le 19e siècle, la science devient une telle force intellectuelle et sociale qu’elle
ne résiste pas aux tentatives de dévoiement dont elle est l’objet. Elle sert rapidement de base
intellectuelle à certaines idéologies mais surtout, et c’est ce qui est intéressant dans le cadre de
notre sujet, elle justifie les croyances et les préjugés. Le premier dévoiement de la théorie de
l’évolution et de la lutte pour la vie de Darwin se trouve dans la préface à la traduction
française de l’Origine des espèces par Clémence Royer. Celle-ci affirme sa foi dans le progrès
par la compétition entre les hommes ou entre les nations. Cette transposition du darwinisme
de la nature à la société aboutira le darwinisme social (1880), une théorie qui s’appuie sur les
idées de Darwin pour justifier des préjugés antérieurs. Quoique Darwin y fût assez hostile, le
darwinisme social servit de justification au libéralisme économique. Cette idéologie avait été
jusque-là en déficience de légitimité par rapport aux théories traditionalistes et absolutistes.
Le darwinisme social est donc providentiel : il justifie non seulement le libéralisme sauvage
mais également la lutte interraciale voire, à partir des années 1880, l’eugénisme.
Certains milieux scientifiques, non contents d’avoir rejeté le pouvoir spirituel hors du
champ temporel, voulaient substituer leur propre système de valeurs à celui des Eglises. Mais
ce processus, comme l’avait pressenti Comte, ne pouvait aboutir qu’en réintroduisant des
éléments de spiritualité et d’irrationnel dont le fondement scientifique légitimait, avec
darwinisme social notamment, des égarements idéologiques autrement plus graves.
2. La tentative d’adaptation des Eglises
Tandis que la science essaie de s’ingérer dans des domaines d’où le pouvoir temporel
avait été exclu jusqu’à présent, les Eglises connaissent un mouvement général de rénovation à
la fin du siècle. Alors que le scientisme s’essouffle, les Eglises retrouvent un rôle certain,
d’autant qu’elle s’appuient pendant un temps sur des méthodes scientifiques d’exégèse.
Le modernisme
La création des Instituts catholiques en 1875 permet la renaissance des études
cléricales. Il faut combler un retard de plusieurs décennies. Georges Sorel déclare en 1901 :
« on ne croit plus que des progrès des recherches scientifiques soient un danger pour
l’Eglise. » A la fin du siècle, certains membres du Clergé comme Loisy, Duchesne ou Hébert
sont persuadés qu’il est urgent accorder les Eglises avec les idées scientifiques de leur temps.
Ils multiplient les tentatives d’exégèse et n’hésitent pas à ruiner certaines « légendes » pour se
défendre sur le terrain du discutable. Pour reprendre un image de Russell, « l’Eglise
abandonne les bastions pour garder la citadelle intacte ». L’abbé de Broglie établit en 1891 le
bilan des rapports de la science et de la foi. Les résultats de la science seraient un mélange de
faits scientifiques acquis et d’hypothèses philosophiques ayant leur aspect. L’Eglise n’est pas
rejetée dans l’impuissance perpétuelle. Seul un mouvement historique conjoncturel explique
que des savants soient sortis du champ de la foi pour empiéter le domaine des philosophes. En
fait, la Révélation et la foi restent « d’actualité ». Mgr d’Hulst, recteur de l’Institut catholique
de Paris, affirme que la science et la foi ne s’excluent pas, que les convictions religieuses
n’entravent pas la liberté du savant et que les catholiques n’ont rien à craindre de la science.
Parallèlement, il crée les congrès scientifiques internationaux des catholiques.
 6
6
1
/
6
100%