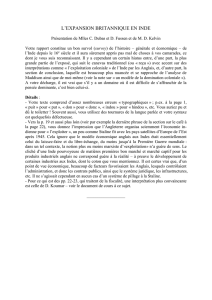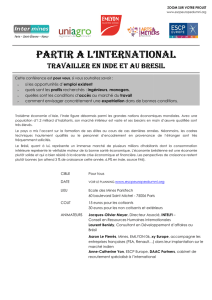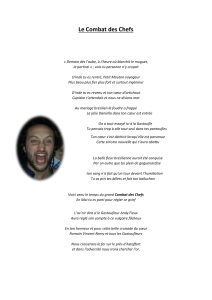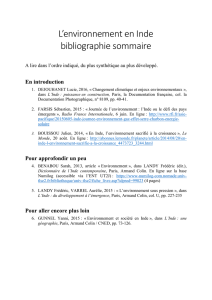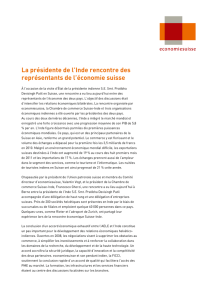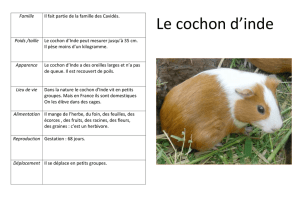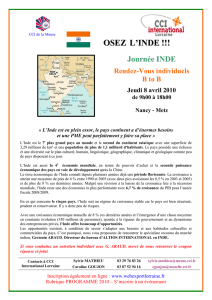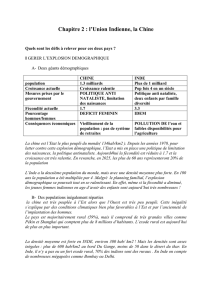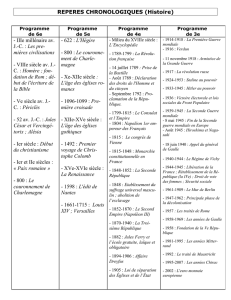II- Attrait de l`environnement d`investissements 7

U n i v e r s i t é L a v a l
Séminaire I : Asie
Professeur : Mr. Zhan Su
Les attraits de l’environnement d’investissements:
Une comparaison entre l’Inde et la Chine.
Élaboré par :
François-Xavier Mauppin (00 256 933)
Nadim Hadj Fredj (02 324 101)
Hiver 2004

Table des matières
Introduction 1
I- Paysage économique 2
1- Caractéristiques économiques 2
2- Stratégies d’attraction des IDE 4
II- Attrait de l’environnement d’investissements 7
1- Environnement politique 7
2- Environnement économique 8
3- Environnement d’affaires 10
4- Environnement légal 11
5- Environnement culturel 13
6- Infrastructures 13
III- Synthèse 15
Conclusion 17
Bibliographie 18
Annexes 20

Introduction :
Depuis une quinzaine d’années, on ne cesse de parler et d’annoncer le miracle chinois.
En effet, la Chine a su, de 1979 à 2003, élever son économie au 6ème rang mondial en
détrônant le monstre américain en terme d’IDE. Sa croissance soutenue de l’ordre de 9 %
depuis 10 ans suscite de nombreuses questions, de la jalousie, de la crainte et du
scepticisme sur la viabilité à long terme des réformes entreprises par le gouvernement.
Rien ne semble pouvoir freiner le rouleau compresseur chinois.
Dans la même région, un autre géant, l’Inde, commence à se faire reconnaître depuis
1991 comme une autre économie prometteuse. En effet l’Inde se voit flattée d’une
croissance soutenue qui flotte au tour des 5 %. En terme de croissance des IDE, l’Inde
s’aligne sur la dynamique chinoise. Déjà de nombreux experts posent la problématique de
savoir si l’Inde, dans un avenir plus ou moins proche va pouvoir dépasser la Chine.
D’autres nous affirment que la Chine et l’Inde sont les deux prochaines nations leaders
économiquement au monde.
Alors que dans certains pays riches, les taux de croissance dépassent péniblement les
1%, il semble que ces deux pays en voie de développement détiennent la clé du succès.
On se propose donc dans ce travail, après un portrait détaillé de l’économie de chacun
des pays, d’analyser l’environnement d’investissements afin de mieux comprendre le
miracle asiatique et aussi de comparer ces deux géants de l’Asie.
Page 1

0
500
1000
1500
2000 2001 2002 2003
Évolution du PIB / h. ($ US)
Chine Inde
0
500
1000
1500
2000 2001 2002 2003
Évolution du PIB (Mds de $ US)
Chine Inde
I- Paysage économique :
1- Caractéristiques économiques :
Depuis 25 ans, la Chine connaît un véritable décollage économique. L’importance du
rôle économique de ce pays n’est plus à démontrer. En effet, la richesse créée est passée
de 4 à 14 % du total mondial (à parité de pouvoir d’achat) ; ce qui propulse la Chine au
6ème rang mondial, avec un PIB
1
d’environ 1260 Mds $ US
2
. Depuis 1978, la Chine
maintient une croissance de l’ordre de 9 % par année et « la richesse par habitant
continue à croître sur une tendance de 7 à 8% par an »
3
. Le PIB par habitant, quant à lui
demeure faible par rapport à celui des pays riches (le PIB / hab. au Canada est environ
égal à 25 000 $) et viens de franchir le seuil des 1000 $ en 2003 ; il faut néanmoins
rappeler que la Chine est le pays le plus peuplé au monde avec 1 280 975 000
4
habitants.
Données tirées de DREE. Statistiques Chine et Inde, Janvier 2004.
Loin d’être négligeable, l’économie indienne connaît elle aussi une croissance
soutenue. Effectivement, même avec un PIB (de 579 Mds $ en 2003) nettement inférieur
à celui de la Chine (voir ci-dessus), l’Inde se positionne au 11ème rang mondial. Avec une
population proche de celle de la Chine (1 048 279 000), son PIB par habitant reste très
faible, soit 545 $ par an.
Malgré son manque d’ouverture au commerce mondial, l’Inde a su maintenir une
croissance flottant autour des 5 % grâce à son secteur privé domestique comme l’ont
souligné Huang et Khanna (2003).
1
Les valeurs de PIB sont tirées de la DREE et de The World Bank Group.
2
Le signe « $ » désignera le dollar américain pour tout le reste de ce travail.
3
DREE (2003). Chine : Situation économique et financière.
4
Les nombres d’habitants sont tirés de The World Bank Group [On-line] Available
http://www.worldbank.org/data/databytopic/POP.pdf
Page 2

L’Inde conserve une économie assez traditionnelle, axée sur les services, qui
contribuent à eux seuls à la moitié (49 %) du PIB. D’un autre côté, la Chine possède une
économie beaucoup plus industrialisée. En effet, le secteur de l’industrie représente 49 %
du PIB, alors qu’en Inde, il ne représente que 26 %. Cette différence dans la structure de
ces deux économies s’explique par deux stratégies différentes. L’Inde, fidèle à son
histoire et sa culture, décide de mettre en avant les « cerveaux » développant ainsi le
secteur tertiaire. Alors que la Chine, déploie une stratégie de « cols bleus », une économie
basée sur la main d’œuvre renforçant le secteur industriel.
Données tirées de Jean Villette. L’Atlas Francophone.
D’après ce qui précède, on peut conclure que les économies de l’Inde et de la Chine
sont assez différentes, et n’auraient en commun que le fait d’être en croissance soutenue.
D’ailleurs, d’après Lingle (2003), en terme de PPA, la Chine possède la 2ème plus
importante économie au monde, et l’Inde occupe la 4ème position. L’IDH en constante
croissance, dénote, plus globalement, que les deux pays se développent parallèlement
d’une manière rapide (voir ci-dessous
5
).
Évolution de l'Indice de Développement Humain (IDH)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1 975 1980 1985 1990 1995 2001
Années
IDH
Chine Inde Canada
Données tirées de United Nations Development Program (2003).
5
L’IDH du Canada est donné pour référence.
Répartition du PIB en Chine (2003)
18%
49%
33%
Agriculture Industrie Services
Répartition du PIB en Inde (2003)
25%
26%
49%
Agriculture Industrie Services
Page 3
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%