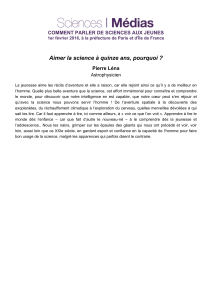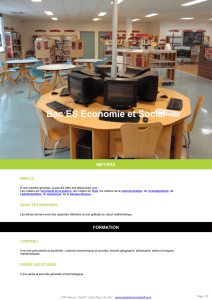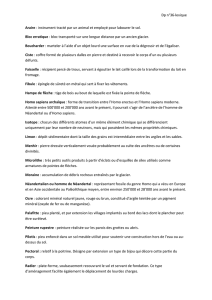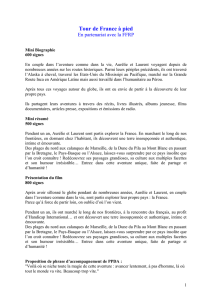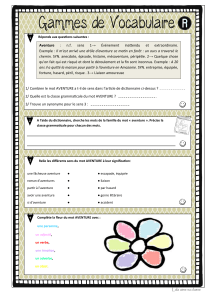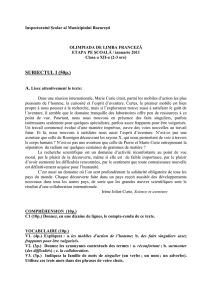compte-rendu de la journée de réflexion du CHT

Centre Haroun Tazieff pour les sciences de la Terre - Le Chambon sur Lignon.
Conférence en trois entretiens :
« Aventure humaine ? » « Aventure humaine ?? » « Aventure humaine ??? »
Par Pierre Zettwoog, philosophe, physicien, équipier d’Haroun Tazieff.
Présentation du Centre Haroun Tazieff et de ses objectifs sur le Plateau, centrés sur la valorisation du patrimoine
paysager comme ouverture vers les richesses patrimoniales du massif Meygal-Mézenc-Gerbier. Cette conférence
inaugure les initiatives qui seront conduites au fil des ans par le CHT pour souligner l’actualité de la dimension
éthique des expéditions Tazieff, conduites par celui qui fut peut-être le dernier des grands explorateurs du
XIXème siècle mais pleinement engagé dans les combats essentiels du XXème, notamment sous l’occupation
nazie.
x-x-x-x
L’ancienneté du vivant est ancrée dans l’ancienneté du passé de la planète terre. Les évidences ne manquent
pas : il suffit de regarder le paysage. Curieusement ces évidences, les hommes n’ont longtemps pas su ni voulu
les voir.
Au cours du 19ème siècle, elles s’imposèrent. Il fut brusquement pris conscience de ce que la vie avait non
seulement un long passé, mais surtout une longue histoire. Scientifiquement, cette histoire s’exprimait en terme
d’évolution des espèces : s’accumulèrent des preuves de ce que les espèces contemporaines n’avaient pas
toujours existé, qu’elles étaient même toutes récentes à l’échelle des temps géologiques, que l’inventaire de la
biodiversité s’était de nombreuses fois complètement renouvelé. Le patrimoine génétique transmis de génération
en génération entre les individus d’une même espèce était certes stable, c’est là-même la définition de la notion
d’espèce, mais il fut découvert que cette stabilité ne valait que sur quelques milliers de générations, à l’évidence
elle n’existait plus sur des dizaines de milliers de générations : à moyen terme les espèces se diversifiaient ou
s’éteignaient.
Les paléontologues retracent l’histoire du vivant ancien. Ce qui veut dire chercher à mettre en lumière :
les mécanismes de l’évolution du patrimoine génétique,
et les facteurs qui les déclenchent.
« Aventure humaine ? »
Il y a 2,5 millions d’années, en Afrique, au sein de la famille des hominidés, en cousinage avec la lignée des
australopithèques, apparaît la lignée humaine, qui fut d’emblée buissonnante : plusieurs espèces appartenant au
genre Homo sont documentées de cette époque.
Ce qui a séparé les humains des autres vivants avec lesquels ils cohabitaient au sein des mêmes écosystèmes, c’est
en fin de compte l’apparition du fait culturel.
Avec le genre Homo, il y a de l’inédit, il ne suffit plus de la seule génétique pour rendre compte de l’évolution
plus ou moins en parallèle des différentes espèces humaines qui sont apparues et se sont éteintes au cours de ces
millions d’années ; la notre, homo sapiens sapiens, étant la seule qui n’ait pas disparu. Ce qui se transmet de
générations en générations, ce n’est plus seulement du patrimoine génétique : pour la première fois dans l’histoire
du vivant, les générations d’une même espèce se transmettent un patrimoine culturel de plus en plus substantiel.
Celui-ci s’avère, au fil des âges, plus déterminant que le patrimoine génétique. A la limite, de homo sapiens
pourrait dériver une version homo sapiens silicium-téflon, sans biologie et donc sans génétique, dont les
représentants ne se transmettraient plus que du culturel.
Comment interpréter le fait culturel, c’est-à-dire l’apparition de la pensée conceptuelle, l’acquisition du sens du
beau, l’émergence des besoins esthétiques, celle du sens du bien et des besoins éthiques, celle de la pensée
symbolique ? Quels sont les mécanismes de la production de la conscience ? Les questions que posent cette
nouveauté au sein du vivant conduisent avec précaution à notre titre : « Aventure humaine ? », avec précaution
car l’apparition du fait culturel s’interprète sans difficulté par le hasard néo-darwinien, ce qui du coup ne permet
pas de justifier l’expression « aventure ? » et son finalisme sous-jacent. C’est le temps de l’humain innocent.
« Aventure humaine ? ? »
L’espèce homo sapiens sapiens est la seule rescapée de la lignée humaine. Ce qui finalement la caractérise le
mieux par rapport à tous les autres vivants, c’est sans doute l’apparition et la montée progressive en puissance du
questionnement métaphysique. Depuis cent mille ans, l’âge du maar de Chaudeyrolles, soit quatre mille

générations, il existe dans chaque société humaine un phénomène de production d’une extériorité qui conduit
chaque être humain au delà de lui-même. Cette extériorité prend de plus en plus de consistance et d’autonomie
par rapport à son cadre de production. Elle devient une réalité située hors de l’univers physique environnemental
quotidien (au sens propre, c’est une réalité métaphysique). En retour, cette extériorité régule et stabilise la société
et lui permet de résister aux processus d’autodestruction qui la menacent en permanence, de l’extérieur comme de
l’intérieur.
C’est pour rendre compte des rites funéraires mis en évidence chez les Néandertaliens il y a 100 000 ans, peut-
être même encore plus tôt chez les hommes de Atapuerca près de Burgos, il y a 500 000 ans, que les
paléontologues sont amenés à parler d’un questionnement métaphysique au moins implicite. Chez les hommes
modernes ce questionnement sera de plus en plus explicité, conceptualisé. Il aboutira même au 1er millénaire
avant notre ère, dans toutes les cultures du monde, à une interrogation sur la source de ce questionnement.
Cette interrogation au second degré est en particulier au centre de l’activité des philosophes grecs du 5ème siècle
avant notre ère. Est explicitement énoncée la question fondamentale de la métaphysique, qui porte sur la source
de l’être : quelle est la réalité vraie sous la réalité apparente du monde des sensations immédiates ? Cette question
est au cœur de toute la philosophie depuis 25 siècles jusqu’à sa reprise par Martin Heidegger. Un certain nombre
de systèmes de pensée philosophiques ou religieux proposent des réponses toujours actuelles à la question de la
source de l’être. Certains d’entre eux répondent par le rejet argumenté de la question et plus généralement de la
pertinence de la métaphysique comme discipline intellectuelle. L’apparition du questionnement métaphysique
s’explique-t-il par des mécanismes néo-darwiniens ? Cette question en appelle une autre : «peut-il y avoir un
savoir sur l’auto-transcendance sans transcendance véritable ? » Deux questions qui expliquent le double point
d’interrogation du titre de ce deuxième entretien. C’est le temps de l’humain encore naïf, sujet du deuxième
entretien.
Aventure humaine ???
Quelle signification accorder à la question de la source de l’être en ce 21ème siècle ? Reformulée en termes
accessibles à tout le monde la question devient : « Qu’est-ce qui donne du sens à ma vie ? »
L’homme prend conscience de ce qu’en tant qu’espèce biologique, sa survie à court terme, qui n’était pas mise en
cause au temps de l’humain innocent, est devenue, par suite de ses propres errements, problématique. Les
écosystèmes dont il dépend sont également menacés, et différents mécanismes peuvent amener à la disparition
rapide des homo sapiens, avec ou sans descendance post-humaine.
Et le voilà qui du coup se met à prendre en charge, selon ses propres finalités, les mécanismes de l’évolution du
vivant, à coup d’OGM, de bionique et d’informatique. Mécanismes qui, depuis trois milliards d’années, étaient
restés purement aléatoires, (« le hasard darwinien »). N’y est-il pas obligé ?
Mais en fait, quelles sont ces finalités ? Pour répondre il faudrait commencer par clarifier ce qu’est une personne
humaine, ce qu’elle n’est pas ; répondre à la question du sens de l’existence humaine. Ne viser qu’à la seule
intégrité du génome ne serait guère motivant. Il faut ici constater qu’aucun processus visant à obtenir à l’échelle
mondiale un consensus sur ces questions n’a été engagé. Il faut donc constater et regretter que pour le moment
l’homme ne fait que répondre au coup par coup à des nécessités locales et à court terme, tout en faisant confiance
aux mécanismes aveugles du marché. A la question « quelles finalités ? », pas de réponses pour le moment.
Il est évident que dans ces conditions les pires scénarios des auteurs de science fiction peuvent se concrétiser. En
situation de mondialisation il pourrait ne pas y avoir de deuxième chance.
C’est le temps de l’humain averti. Une aventure, c’est un but à atteindre avec des risques d’échec. L’expression
« aventure humaine » est donc bien justifiée au temps de l’humain averti. Que faut-il pour que d’emblée l’échec
ne soit pas inéluctable ?
Peut-être faut-il trouver la réponse à l’énigme de la « question du mal métaphysique ». A maintes reprises au
cours de l’histoire, les sociétés humaines ont opté, inéluctablement semblait-il, pour des solutions désastreuses.
Quel est le mécanisme anthropologique qui rend compte de cette défaillance persistante ? Pour que les chances
de succès de l’aventure humaine augmentent, il faut donc que ce mécanisme soit maîtrisé, encore faut-il qu’il
soit élucidé. Mais le libre arbitre existe-il ? L’humain est-il en position de décideur ?
Toutes ces questions redoutables justifient le triple point d’interrogation du titre de ce troisième entretien.
x-x-x-x

L’objectif de Pierre Zettwoog était de susciter des noyaux de réflexion ou des ateliers de rencherche pour
prolonger les échanges de cette journée. Si rien de concret n’en est encore sorti, la conception du Pôle scientifique
Haroun Tazieff de Borée doit le programme général de la bibliothèque aux échanges amorcés lors de la
conférence du Chambon.
Situer l’histoire des sciences de la Terre dans celle des développements sociaux, culturels, spirituels, éthiques,
scientifiques, tel est le projet de centre culturel qui se profile derrière l’installation de la bibliothèque de Borée.
Pour Pierre Zettwoog, Tazieff était pleinement engagé dans l’aventure intellectuelle du XXè siècle, héritier des
Lumières, « c’était pour moi, le dernier des grands explorateurs du XIXè, poussés par leur passion de découvrir,
comprendre, connaître . »
La science s’est trouvée au cœur de l’aventure humaine du siècle denrier. A partir de 1945, les ressources
consacrées à la recherche scientifìque prennent une importance énorme. Cette date symbolique, essentiellement
politique, sociale, scientifique, technique, idéologique et morale, reste le pivot de l’avenir, du siècle qui s’ouvre.
Haroun Tazieff avait compris que les scientifiques ne devaient pas être les seuls bénéficiaires des fortunes
allouées à la recherche et que la noblesse de ces métiers ne tenaient pas tant au prestige de la carrière des élites
qu’à la capacité de vulgariser les travaux des chercheurs auprès du plus grand nombre. Il a aussi clarifé le statut
de l’expert scientifique en charge de l’information des gouvernants. Faisant face aux opportunismes de gauche ou
de droite autant que de nombre d’écologistes, il ne s’est pas fait que des amis. Certes, il a varié sur des sujets
cruciaux tels le nucléaire ou le réchauffement du climat, mais lui au moins n’aura jamais falsifié de données ni
signé les travaux de ses assistants pour se fabriquer une gloire usurpée. Il aura toujours témoigné du courage
indispensable à l’honnêteté intellectuelle. Personnage médiatique comme peu le furent, il en aura usé avec cette
fougue exceptionnelle qu’il mettait en tout. Dans les années d’après-guerre, ils n’étaient qu’une poignée, ceux qui
ont tenté d’alerter le monde sur les catastrophes auxquelles conduisait le cours pris par l’aventure humaine. Mais
depuis 40 ans, la communauté scientifique mondiale est dûment informée, les responsables politiques et les
médias aussi. Et pourtant, la course à la croissance des « produits intérieurs bruts », à la consommation et à la sur-
consommation, l’éducation permanente et populaire aux mensonges d’une propagnade publicitaire désormais
planétaire restent des déterminants majeurs de l’aventure humaine contemporaine.
Cette épopée a foiré, elle a mal tourné. Comment cela se fait-il, demande Pierre Zettwoog ? D’où vient la
défaillance ?
Il y a 40 ans, les films qui font peur, ceux d’Al Gore, de Yann-Artus Bertrand ou de Nicolas Hulot, aurait fait
appel à des images de synthèse. Aujourd’hui, ce sont des documentaires…
Toute était-il en germe à l’émergence de l’humanité, au sortir de l’animalité ?
Au temps de l’humain encore innocent, tout était encore possible, analyse Zettwoog. La maîtrise des écosystèmes
pour des finalités purement humaines a conduit les hommes depuis des millénaires, de la Chine, de la Grèce ou de
la Perse antiques à la philosophie des « lendemains qui chantent » ou celle de la « fin de l’Histoire » ou du « choc
des civilisations ». Quels que soient les grands crimes de l’humanité contre elle-même, nous en étions jusqu’il y a
une quarantaine d’années aux temps de l’humain encore naif. Désormais, l’homme est averti.
Un animal s’est-il jamais posé la question du paysage ? Le paysage est le compagnon de l’homme depuis qu’il a
trouvé la culture, les grottes qui furent ses abris en témoignent. Le paysage est aussi le grand livre des comptes de
l’humanité. Il y a 2.500.000 ans que le culturel a ouvert la différenciation de l’homme et de l’animal. Et pourtant,
nous souffrons encore très largement d’illettrisme paysager.
Compte-rendu écrit par Frédéric Lavachery et Pierre Zettwoog, août 2009.
1
/
3
100%