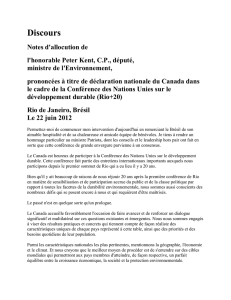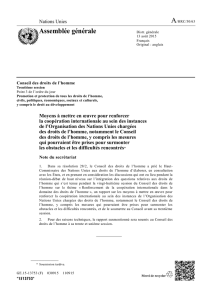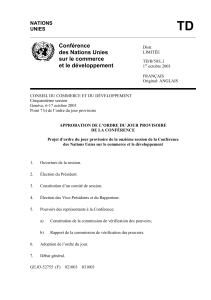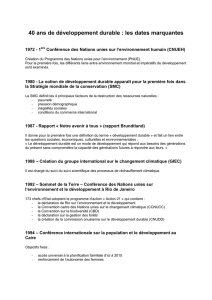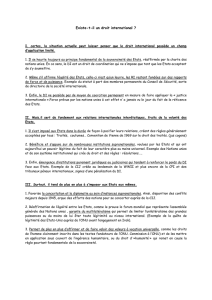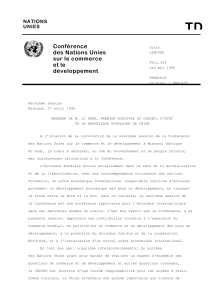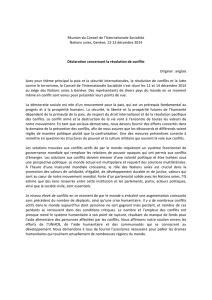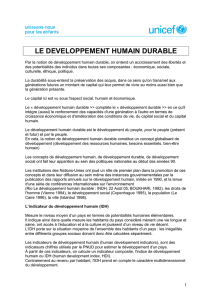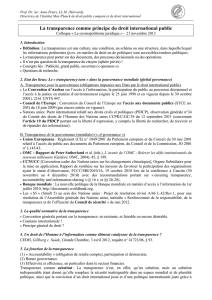La gouvernance du développement durable à RIO+20 : pour la fin

La gouvernance du développement durable à RIO+20 : pour la fin du système
oligarchique !
Jean-Philippe Thomas - ENDA Tiers Monde - [email protected]
Le mouvement international de prise en compte de la planète Terre et de l’environnement
date de 1972 avec la première Conférence des Nations Unies sur l’Environnement Humain
(CNUEH, Stockholm - Suède). Ce mouvement fait suite, au niveau international, à la prise en
compte dans les années 60, des problèmes de commerce et de développement avec la
première Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED –
1964). Les questions écologiques entrent donc ainsi de plein pied dans les préoccupations
internationales avec la mise en place du Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE). Le contexte est favorable, puisque c’est à la même période que le
Club de Rome lance l’objectif de «Halte à la croissance ». Egalement, le pas est donné
puisque les dirigeants de la planète s’engagent à se rencontrer tous les dix ans pour faire le
point sur l’état de la Terre. Après l’échec de la Conférence de Nairobi en 1982, dû aux
tensions sur le plan international, tous les espoirs se reportent sur la Conférence de Rio, en
1992. Les résultats de cette Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le
Développement sont considérés, par tous, comme une réussite puisqu’il en ressort le
programme d’Action 21 (avec plus de 2500 recommandations) et trois conventions
majeures : Changements climatiques, biodiversité et lutte contre la désertification. Le
développement durable est né, sa gouvernance est assurée par les instances multilatérales
« ad hoc » relevant du système des Nations Unies.
Mais parallèlement et suite au premier choc pétrolier, un G5 informel est initié
en 1974 (États-Unis, Japon, France, Allemagne de l'Ouest, Royaume-Uni). Il devient G6 puis
G7 avec l’entrée de l’Italie et du Canada. C’est en 1997 que le G8 prendra sa forme actuelle
avec l’entrée de la Russie. Le G8 n’est pas une administration transnationale, c’est un groupe
informel avec une Présidence tournante. Ce groupe, dit de discussion et de partenariat
économique, va tendre, dans les faits, à se substituer aux instances multilatérales mises en
place dans le cadre du système des Nations Unies.
En 2002, le « Sommet Mondial sur le Développement Durable » (Johannesburg), organisé
par les Nations Unies, a, au-delà des bilans, pris des décisions dans les sens du
développement durable, entre autres, sur l'eau, l'énergie, la santé, l'agriculture et la
diversité biologique. Il faut y ajouter le renforcement des partenariats entre le nord et le sud
et entre les secteurs publics et privés. Ce sommet s’inscrit dans une trajectoire de lutte
contre la pauvreté consacrée, deux années plus tôt (2000), par l’adoption aux Nations Unies
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

Mais, comme le note l’IDDRI (RA 2010), la gouvernance du développement durable,
institutionnalisée par le Sommet de la Terre de Rio en 1992 et ses trois conventions
(Désertification, Biodiversité, Changements Climatiques), a subi des transformations
profondes au cours de la dernière décennie, marquée à la fois par la diffusion large de l’idée
de développement durable dans les discours et des résultats insatisfaisants, sinon décevants.
En d’autres termes, le développement durable a été largement mis à mal par les vingt
dernières années.
Parallèlement, et suite aux crises financières des années 90, le G8 va s’agrandir en G20 (19
pays
1
+UE) en 1999. Ce Groupe à un « poids » important puisqu’il représente 85 % du
commerce mondial, les deux tiers de la population mondiale et plus de 90 % du produit
mondial brut, mais il reste totalement informel !
On perçoit aisément le flou existant dans la gouvernance du développement durable
puisqu’un des piliers (l’économie) échappent totalement à sa gouvernance institutionnelle,
ce qui, par suite, rétroagit sur les autres piliers, en particulier le social.
Ce mouvement trouve sa reconnaissance dans les attendus de Rio+20 puisque les Nations
Unies admettent que « Le sommet mettra également l’accent sur deux thèmes spécifiques:
une économie verte dans le contexte de l’éradication de la pauvreté et le développement
durable, et une structure institutionnelle qui favorise le développement durable ».
La définition des deux thèmes spécifiques à aborder, d’emblée, pose problème
D’abord, la notion « d’économie verte » émerge du développement durable pourtant basé sur les
trois piliers à parts égales. L’expérience des cinquante dernières années doit conduire à une
certaine prudence sur l’appropriation de nouvelles notions : croissance économique,
écodéveloppement, croissance zéro, ajustement structurel, objectifs du millénaire,
développement durable. Les changements d’appellation sont-ils des changements de
paradigme pour des politiques identiques ? Nous avons répondu à cette question en
réfutant la notion d’économie verte
2
.
Ensuite, la séparation qui est proposée entre l’économie verte et la gouvernance du
développement durable (structure institutionnelle) perdure et renforce une vision de la
société désarticulée entre les acteurs, c'est-à-dire les populations, et ceux qui décident des
règles et des modes de fonctionnement da la société.
1
G8 + Australie, Japon et neuf pays émergents : Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie,
Mexique, Turquie.
2
Voir : « L’économie verte ou le retour de l’économisme effréné ? » - Jean-Philippe Thomas - ENDA Tiers
Monde – Dakar, 2012.

Or, au niveau international, face aux processus de mondialisation/globalisation, se pose,
avec une grande acuité, le problème de la gouvernance mondiale pour l’économie, le
commerce, le monétaire et financier, l’environnement, et disons, par extension, tous les
biens collectifs mondiaux. S’il existe un consensus sur deux défis majeurs - l’éradication de la
pauvreté et la sauvegarde de la planète – la diversité des formes de capitalisme actuel (avec
plus ou moins d’Etat ou de marché) engendre des dérégulations en chaînes matérialisées par
les suites de crises (financières, des matières premières, de l’immobilier ou du foncier,…)
que rencontre l’ensemble des pays du monde, certes à des degrés divers. Ce qui signifie que
les réponses obtenues jusqu’à aujourd’hui par rapport aux défis sont très en deçà des
objectifs poursuivis. Le bilan dressé par les Nations Unies, cinq ans avant l’échéance des
objectifs du millénaire (OMD), est très mitigé, car il est peu probable que l’ensemble des
objectifs soient atteints. Il en est de même de la sauvegarde de la planète pour laquelle les
atermoiements des négociations sur un agrément post 2012 sur le « Climat » conduisent à
des choix d’objectifs de réchauffement climatique très au dessus des recommandations de la
communauté scientifique, si l’on veut effectivement lutter contre le réchauffement de la
planète.
Les limites du marché, en tant que mécanisme de régulation sont maintenant admises, c’est
ce que l’on appelle la crise de la régulation « libérale ». La question des mécanismes d’une
nouvelle régulation se trouve ainsi posée. C’est le retour du débat marché/Etat, mais au
niveau international. Quelle institution peut jouer à l’international ce rôle de régulateur. Des
réponses partielles sont données, les Conventions sur l’environnement, en particulier le
Climat, en sont un exemple. Mais au niveau global, la réponse de la communauté
internationale est, depuis plusieurs décennies, on l’a vu plus haut, constituée par les divers
« G », réunions informelles des Présidents de Nations auto désignées, puisqu’au départ
constituées uniquement de pays industrialisés (G8). Ce que d’aucun appelle une
« Diplomatie de connivence
3
», constituait jusqu’à aujourd’hui le mécanisme ultime de la
régulation mondiale basée principalement sur l’évaluation par les pays industrialisés du
rapport de force avec l‘ensemble des autre pays, ce qui permettait aux pays membres de
trouver « entre eux » des arrangements (connivence) pour une « meilleure » régulation
mondiale. Mais ce comité de pilotage rigide n’a pu survivre à la montée des pays émergents
comme la Chine, le Brésil, l’Inde ou l’Afrique du sud. L’extension du comité (G20) répond aux
contestations de plus en plus marquées sur bon nombre de problèmes entre les pays
industrialisés et les pays émergents qui ne partagent pas le même sens des responsabilités
au niveau mondial. Quoiqu’il en soit, ce système oligarchique actuel n’est pas durable !
C’est donc le concept de développement durable qui doit être renforcé, non pas en séparant
économie et gouvernance, mais en adjoignant un quatrième critère aux piliers du
développement durable : la gouvernance, ses institutions et leur cohérence. On pourra
3
« La Diplomatie de connivence ».- Bertrand Badie. Editions de la Découverte, Paris. 2011.

ainsi juger du degré de conformité des processus allant de l’économique au politique, et du
degré de convergence des politiques et mesures, etc.
De manière explicite, c’est le cadre d’analyse du développement durable qu’a déjà proposé
ENDA et qui se trouve largement corroboré par les conclusions du UN High-Level Dialogue
on the Institutional Framework for Sustainable Development, (July 2011, Solo, Indonesia,
attending by 300 policy makers, diplomats, NGOs and experts) et, en particulier, Martin Khor
du Third World Network (TWN) : « The main consensus was that there has been a big
implementation problem – the goals of sustainable development have not been not
implemented, either at the global level (such as in the UN, or IMF and WTO) or in national policy
making. A major reason is the weakness of absence of institutions. The UN’s Commission on
Sustainable Development, the main agency to follow up on the 1992 Rio Summit, has too small a
secretariat and meets for only three weeks in a year. All three sustainable development pillars –
environment, economic and social – are very weak at the UN. The agencies interact too little, if at
all, with one another. The governments do not have adequate fora, such as a powerful UN
economic committee to discuss the financial crisis and economic recession, or a UN environment
committee with authority to act. This weakness is also reflected at the country level. National
councils of sustainable development were set up after Rio 1992, but many have not functioned
well. Economic policies are still made with little regard for the environment”.
Il devient impératif d’élargir les « piliers » du développement durable à un critère
supplémentaire, l’institutionnel (gouvernance et cohérence des politiques) qui était jusqu’ici
le grand absent du développement durable.
Les quatre piliers du D.D.
Economie
Social
Institution
Environnement
(a) (b) (c)
(f)
(f)
(g)
(g)
Approche globale
C’est à partir d’un tel cadre qu’il s’agit maintenant d’analyser les formes de gouvernance de
l’international au local. Il n’existe pas un modèle type mais beaucoup plus, dans cette vison
holistique du développement durable, des panoplies d’indicateurs partagés qui doivent

répondre aux principes de la durabilité (voir exemple ci-dessous) et évaluées les
transformations opérées.
Critères Développement Durable
Critères
Conditions de
« durabilité »
Indicateurs (exemples)
Economique
Efficience/Efficacité
•Valeur produite > valeur consommée
•Valeur ajoutée (VA)
•PIB (productivité des facteurs)
Social
Equité
•Répartition de la VA (ou PIB), IDH
•Population pauvre bénéficiaire
•Réduction pauvreté (% femmes,
enfants)
Environnemental
Viabilité/Conservation
•Emissions GES, stockage de carbone
•Synergies désertification,
biodiversité,…
Institutionnel
Cohérence/Régulation
•Convergence des actions & politiques
•Gouvernance
•Degré de conformité des processus
•Degré de participation
J.Ph.Thomas
Ce n’est pas une institution juxtaposée qui va décider de la durabilité mais beaucoup plus la
recherche, par les acteurs, d’une « harmonie » entre les relations qui s’instaurent entre les
quatre piliers du développement durable et qui est génératrice du sentier sur lequel
s’engage et se poursuit le développement.
On est donc beaucoup plus dans une approche ascendante (bottom up) que top-down.
La décentralisation administrative et institutionnelle qui s’opère dans la plupart des pays
africains à l’heure actuelle est révélatrice de la nouvelle configuration des centres de
décision. Le rôle économique et social des Etats tend de plus en plus à s’effectuer dans des
pôles de subsidiarité comme les collectivités locales ou territoriales jusqu’aux communautés
à la base. Les dynamiques sociales et populaires deviennent alors le ferment des
transformations. Cette dévolution, en multipliant les centres de décision, sera effective
lorsque ces centres de décision décentralisés jouiront pleinement des possibilités de
planification, de collecte de ressources financières et d’accès direct à des sources de
financement nationales ou internationales (financement direct « Climat », par exemple).
Les nombreux travaux et les innovations politiques (en particulier dans les pays émergents) qui
ont opérationnalisé la notion de développement durable (incluant sa gouvernance) constituent
 6
6
1
/
6
100%