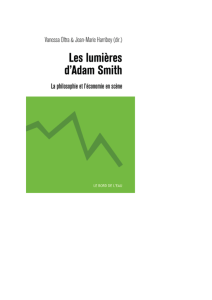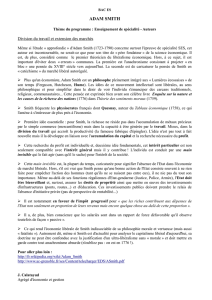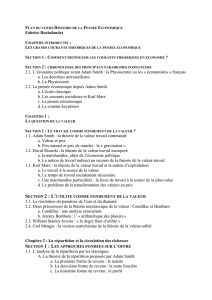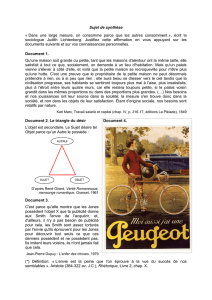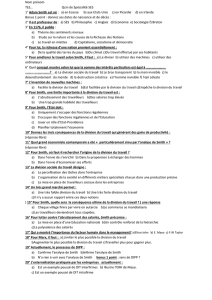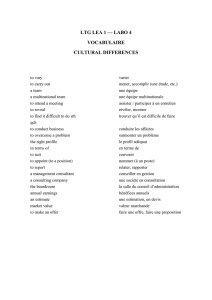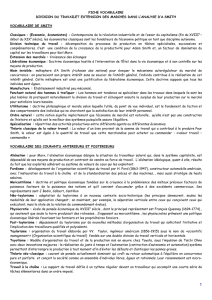RECONNAISSANCE DE LA RICHESSE ET RICHESSE DE LA

RECONNAISSANCE DE LA RICHESSE ET RICHESSE DE LA
RECONNAISSANCE CHEZ ADAM SMITH
INTRODUCTION :
La problématique de la RN est posée dès les premières lignes. Dans les
nations sauvages tout le monde travaille, l’entièreté du produit du travail revient au
travailleur. Il n’y a ni capitaliste pour prélever un profit, ni Etat pour prélever des
impôts. Et pourtant il y règne une grande indigence. Tandis que dans les nations
commerciales une partie non négligeable de la population est oisive et pourtant y
règne une opulence générale qui fait que le plus modeste des travailleurs de cette
société est en définitive plus riche que le plus riche des sauvages. Comment
expliquer cet apparent paradoxe ? Voilà ce que ce propose Smith dans son ouvrage.
Nous pensons toutefois qu’au-delà de cela un regard porté sur l’ensemble de l’œuvre
smithienne permet de mettre en lumière non pas seulement comment mais surtout
pourquoi il faut enrichir la nation et les individus qui la composent. Nous nous
proposons dès lors d’identifier un questionnement moral qui pourrait être le
fondement de la Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations : il s’agit du
concept de reconnaissance. Pour ce faire notre étude comportera trois parties. La RN
identifie deux grandes causes d’augmentation de la richesse nationale :
l’accumulation du capital et la division du travail. Dans la première partie nous
tenterons d’élucider non pas ce qu’est l’accumulation du capital mais pourquoi nous
cherchons à nous enrichir. Nous pensons que le moyen plus simple d’améliorer notre
condition est de nous enrichir parce que richesse et grandeur attirent les regards et
l’admiration. D’où la nécessaire distinction des rangs qui crée un système
d’émulation. Mais quelle est dès lors la situation des pauvres ? L’enrichissement
national, qui se répand parmi toutes les classes du peuple, ne permet il pas d’assurer
une vie décente aux pauvres ? La seconde partie discute la question de la liberté et de

l’indépendance, condition nécessaire à une vie digne. La relation salariale ressemble
à s’y méprendre à une nouvelle relation de dépendance. Mais l’étude du système de
la liberté naturelle et du cercle vertueux de croissance remet en question ce jugement
précipité. Enfin nous abordons dans la dernière partie les fondements de la division
du travail. Les relations d’échange sont des relations de persuasion. L’homme est un
animal « commerçant » et le marché devient dans les sociétés commerciales le lieu
fondamental de reconnaissance sociale.
I/Richesse et Reconnaissance
La démarche que nous proposons consiste à éclaircir les fondements de la
problématique de la RN. Le titre de l’ouvrage économique de Smith est on ne peut
plus explicite. L’Enquête porte sur la nature et les causes de la richesse des nations.
Smith en identifie principalement deux : l’accumulation du capital et la division du
travail. Intéressons nous à la première. La question que nous nous posons n’est pas
de savoir ce qu’est l’accumulation du capital mais pourquoi nous accumulons, c'est-à-
dire pourquoi nous cherchons à nous enrichir. Une réponse simple peut être trouvée
en s’appuyant sur la théorie de la valeur smithienne. Smith a une conception
négative du travail. C’est un effort, une peine, une perte de liberté. Or être riche c’est
commander le travail des autres ; c’est donc reporter ces inconvénients sur autrui.
Mais qu’est ce qui nous porte véritablement à accumuler du capital ? Pour le
comprendre, remontons la chaine causale. Nous découvrons de ce fait que
l’accumulation du capital prend sa source dans l’épargne
1
. Et si nous épargnons c’est
parce que nous désirons améliorer notre condition. Ainsi « le principe qui nous porte
à épargner, c’est le désir d’améliorer notre sort ; désir qui est en général, à la vérité,
calme et sans passion, mais qui naît avec nous et ne nous quitte qu’au tombeau.
2
»
C’est véritablement une caractéristique de la nature humaine que Smith décrit ici.
1
« Les capitaux augmentent par l’économie…Tout ce qu’une personne épargne sur son revenu, elle l’ajoute à
son capital. » (RN II.iii p 425)
2
(RN II.iii p 429)

L’homme est fondamentalement un être incomplet et, contrairement à ce que
pensaient les stoïciens et de manière concomitante, un être d’action. Ce désir est
incessant, il nous poursuit tout au long de notre existence puisque « il n’y a peut être
pas un seul instant où un homme se trouve assez pleinement satisfait de son sort,
pour n’y désirer aucun changement ni amélioration quelconque.
3
» C’est le « principe
de vie » de l’espèce humaine, le moteur de la croissance économique. « Cet effort
constant, uniforme et jamais interrompu de tout individu pour améliorer son
sort…est la source primitive de l’opulence publique et nationale, aussi bien que de
l’opulence privée », et il est si puissant qu’il peut maintenir « en dépit des folies du
gouvernement et de toutes les erreurs de l’administration, le progrès naturel des
choses vers une meilleure condition.
4
» L’expression est à comprendre en son sens
strict. Améliorer son sort ou sa condition c’est augmenter son bien être. Plusieurs
solutions s’offrent aux individus pour atteindre cette fin. Parmi celles ci Smith va
naturellement s’intéresser dans la RN « au moyen par lequel la majeure partie des
hommes se propose d’améliorer son sort », à savoir « une augmentation de fortune »
parce que « c’est le moyen le plus commun et qui leur vient le premier à la pensée » ;
et comme « la voie la plus simple et la plus sûre d’augmenter sa fortune, c’est
d’épargner et d’accumuler
5
», le désir d’améliorer sa condition se manifeste chez la
plupart des gens par un désir d’enrichissement. C’est toutefois dans la TSM, pierre
angulaire du système smithien, que l’on découvre, outre qu’il existe un moyen
alternatif pour améliorer son sort, pourquoi nous pensons qu’une augmentation de
richesse est la source de l’amélioration de notre condition. Pour le comprendre, il faut
se focaliser sur la « parabole » du fils d’un homme pauvre
6
« que le Ciel dans sa
colère a affligé d’ambition » et qui « admire la condition des riches » : il voudrait,
comme eux, loger dans un palais, être transporté dans des calèches plutôt qu’aller à
pied et comme « il se sent naturellement indolent et souhaite se servir le moins
possible de ses mains » ; il « juge qu’une suite nombreuse de domestiques lui
épargnerait bien de la peine ». Ainsi, « il pense qu’une fois obtenu tout cela, il
3
(RN II.iii p 429)
4
(RN II.iii p 430)
5
(RN II.iii p 429)
6
Toutes les citations suivantes sont tirées de (TSM pp 253-6)

pourrait enfin demeurer satisfait et paisible, et jouir à l’idée du bonheur et de la
tranquillité de sa situation ». « L’idée lointaine de cette félicité l’enchante », c’est
pourquoi il décide de se consacrer « à jamais à la poursuite de la richesse et de la
grandeur. Mais « pour obtenir les commodités qu’offrent ces dernières, il s’oblige… à
plus de fatigues et de soucis que l’absence de ces commodités aurait pu lui causer
toute sa vie durant. » Il doit de se distinguer de ses rivaux par des talents
exceptionnels et s’oblige pour cela à une « industrie acharnée », travaillant « jour et
nuit …Toute sa vie durant, il poursuit l’idée d’un repos factice et élégant qu’il ne
connaitra peut être jamais, à laquelle il sacrifie une quiétude réelle toujours à sa
portée et qui, si jamais il l’atteint à la toute fin de sa vie, ne lui paraitra en rien
préférable à l’humble tranquillité et au contentement qu’il a abandonnés ». Ce n’est
qu’à l’aube de la mort, « le corps épuisé… et l’esprit humilié » qu’il comprend enfin,
dans un éclair de lucidité, que la richesse et la grandeur ne sont que « des bibelots
d’utilité frivole » inaptes à satisfaire notre bonheur, c’est à dire le bien être du corps
et la tranquillité de l’esprit.… Lorsque nous observons « les palais, les jardins,
l’équipage, la suite des grands », « l’évidente commodité » de ces objets ne peut
manquer de nous frapper. C’est pourquoi « nous entrons aisément dans le sentiment
de cette utilité, nous jouissons par sympathie de la satisfaction qu’ils sont propres à
leur offrir, et nous applaudissons. » En revanche, « la curiosité d’un cure-dent…n’a
rien d’aussi manifeste…Il est donc moins raisonnable d’en faire des sujets de vanité
que ce n’est le cas pour la magnificence de la richesse et de la grandeur. » Ainsi, si
nous admirons tant la condition des riches et des grands « ce n’est pas à cause du bien
être ou du plaisir plus grands dont ils sont supposés jouir », mais en raison « des
innombrables arrangements artificiels et élégants qui procurent ce bien être ou ce plaisir. » En
d’autres termes, nous n’imaginons pas que les riches et les grands sont plus heureux
mais qu’ils ont plus de moyens de l’être. Encore une fois, ce n’est que dans « la
langueur de la maladie » et « la lassitude de la vieillesse » que nous prenons
conscience de la futilité des objets de notre ambition et de l’absence de satisfaction
réelle que leur possession nous amène. La puissance et la richesse nous apparaissent
alors « telles qu’elles sont, d’énormes machines compliquées composées des ressorts
les plus fins et les plus délicats, inventées afin de produire quelques commodités

futiles pour le corps »…Elles sont d’immenses édifices, dont la construction exige le
labeur d’une vie entière, qui menacent à chaque instant d’ensevelir celui qui les
habite…Mais cette « philosophie mélancolique, familière à tout homme en temps de
maladie ou d’accablement » n’est que passagère. En effet « une fois recouvrées une
santé et une humeur meilleures… nous sommes enchantés par la beauté de
l’arrangement qui règne dans les palais et l’économie des grands » ; c’est
l’arrangement des moyens aux fins plus que les fins elles mêmes qui frappe notre
imagination par sa beauté, son harmonie, son ordre et suscite par là même notre
admiration. Nous contemplons avec délectation les merveilleux rouages des ces
immenses machines. A y regarder attentivement « la satisfaction réelle que toutes
ces choses sont capables de produire, pour elle-même et indépendamment de la
beauté de l’arrangement propre à la favoriser…nous apparaitra toujours au plus haut
point méprisable et insignifiante. » Fort heureusement pour le bonheur de
l’humanité :
« nous la considérons rarement sous ce jour abstrait et philosophique. Nous
la confondons naturellement en notre imagination avec l’ordre, le
mouvement harmonieux et régulier du système, de la machine ou de
l’économie au moyen desquels elle est produite. Les plaisirs de la richesse et de
la grandeur, considérés sous cet aspect complexe, frappent l’imagination comme
quelque chose de grand, de beau et de noble, dont l’obtention mérite amplement le
labeur et l’angoisse que nous sommes portés à lui consacrer. Et il est heureux que la
nature nous abuse de cette manière. C’est cette illusion qui entretient le mouvement
perpétuel de l’industrie du genre humain. C’est elle qui d’abord incita les
hommes à cultiver la terre, à construire des maisons, à fonder des villes et
des Etats, à inventer et améliorer toutes les sciences et tous les arts qui
ennoblissent et embellissent la vie humaine ; c’est elle qui a entièrement changé
la face du monde. »
Par conséquent la nature nous abuse, nous trompe, en nous faisant
confondre moyens et fins, cause efficiente et cause finale. C’est pourquoi nous
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%