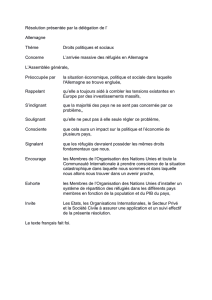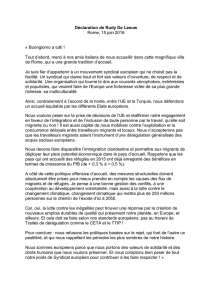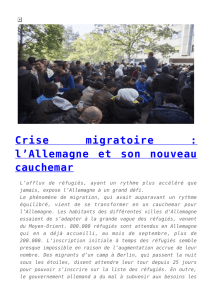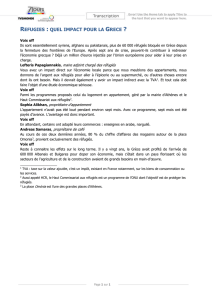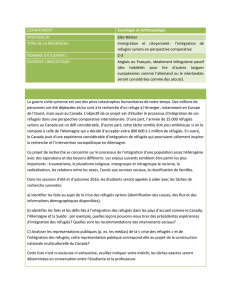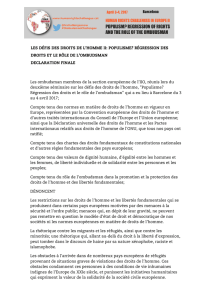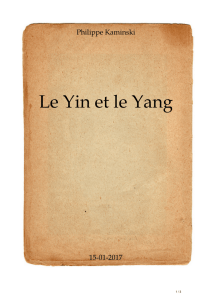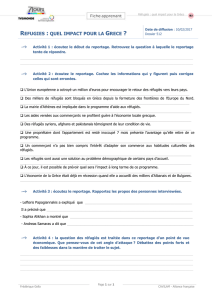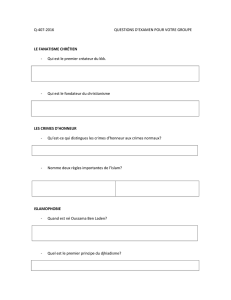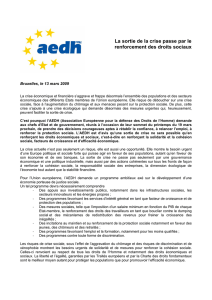Espagne, de 1935 à 2015, un passé qui ne doit pas passer Notre

Espagne, de 1935 à 2015, un passé qui ne doit pas passer
Notre actualité récente commune a fait resurgir de nos mémoires des images, des mots, des faits et
des méfaits. Ce que l'on appelle communément la « crise des réfugiés » reproduit sous nos yeux les
mêmes phénomènes que ceux qui suivent partout et de tout temps les exactions et les crimes des
dictatures et leurs prises de pouvoir. Arménie 1915, Italie 1923, Allemagne 1933, Espagne 1936.
Après la fin de la seconde guerre mondiale, dans le cadre d'une guerre froide qui a figé les droits
dans la gangue des rapports de force internationaux, les peuples subissent les répressions en
Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, en Europe même, en Grèce après la prise du pouvoir par les
colonels, au Chili bien sûr en 1973. J'arrête là cette tragique énumération du passé, en oubliant
sûrement des drames, des meurtres, des tortures et des négations des libertés.
Et je reviens au présent. Toutes ces personnes qui arrivent en Europe, depuis les côtes espagnoles
jusqu'aux îles grecques sont soumis, outre leur situation personnelle faite de fatigue, de peur, de
violence, de misère, voire pour nombre d'entre elles de mort, aux effets d'une contradiction. Elles
sont considérés comme les causes d'une crise des réfugiés et/ou des migrants alors qu'elles sont les
conséquences d'une vraie crise double, celle de l'instabilité du monde, et celle de l'Europe.
L’Association européenne pour la défense des droits de l’Homme considère que l’avenir de l’Union
européenne est en question tant les responsabilités des États membres sont lourdes de conséquences
pour les droits des migrants, qu’ils fuient la guerre, la répression, la misère ou la mort. Alors que
des milliers d’êtres humains, femmes, enfants, hommes croient en l’Europe pour survivre et tenter
de se reconstruire une certaine sûreté, les gouvernements des pays de l’Union affichent pour les
mieux disposés d’entre eux les limites qu’ils fixent à leur générosité et pour les pires, préférence
nationale, violence, xénophobie, racisme. Incapables de comprendre que l’instabilité du monde ne
peut se résoudre avec toujours plus de barrières et de murs, les réunions du Conseil des ministres
révèlent la faillite de la construction européenne. Alors qu’elle proclame avoir l’Etat de droit
comme fondement, elle se révèle malade de peur, gangrenée par la méfiance, voir la haine de
l’étranger. En faisant croire à la réalité d’une invasion sauvage et concertée, certains gouvernements
justifient le recours à la violence, et prennent le risque de dérapages potentiellement mortels.
Les décisions des gouvernements allemand ou autrichien, pour un accueil limité et réparti, ne sont
pas les mêmes que celles du gouvernement hongrois (qui refuse toute installation) ou slovaque (qui
ne veut accueillir que des chrétiens) ou même espagnol (qui prétend ne rien à avoir à faire de plus
que ce qu'il fait à Ceuta et Melilla pour protéger l'Europe) ; le gouvernement français se déconsidère
avec un tout petit 24 000 en deux ans ; le gouvernement du Royaume-Uni a timidement accordé
qu'il pourrait voir pour quelques centaines... Et au niveau européen, on voit que le principe de droit
–l’accueil –cède la place à la pratique de la répartition qui va de l’acceptation à priori de quelques
milliers de réfugiés, au refus de tout accueil imposé et tout quota obligatoire, Hongrie, Slovaquie,
République tchèque…. Dans cette situation de divergences, c’est la fixation de limites qui apparaît
comme raisonnable et réaliste : limiter les effets sur les pays, limiter les arrivants aux réfugiés,
limiter les réfugiés à certaines catégories sociales. Dans cette logique, le pire est sans doute à venir
avec la création des centres de tri de la périphérie entre les bons réfugiés et les mauvais migrants
qu'il faut renvoyer dans leurs pays, présents sur les listes des « pays sûrs ».
Si crise il y a, c'est celle de l'instabilité du monde et de la répartition des richesses. Si les personnes
menacées veulent trouver en Europe un lieu où vivre en sûreté, c'est parce que sa richesse offre des
possibilités qui n'existent plus ailleurs. La société civile en Europe est vigoureusement intervenue,
mais l'élan de solidarité est fragile. L’AEDH appelle à construire sur cette solidarité élémentaire
mais humanitaire et individuelle une défense collective et politique des droits. L'AEDH demande
que l'on inverse l'ordre des priorités pour faire que l'accueil soit inconditionnel avec des procédures

réglementaires qui garantissent les mêmes droits pour tous.
Comment ne pas voir que ces questions sont aussi celles qui, toutes choses égales par ailleurs et
sans vouloir faire de comparaison historique terme à terme, se sont posées en 1936 et se posent à
chaque fois que des mouvements de population vers l'exil sont provoquées par la répression
pratiquée par ceux qui viennent d'arracher le pouvoir par la violence ou bien veulent le conserver
par la terreur. Et que les mêmes situations posent les mêmes questions : comment intervenir dans le
pays, comment refuser la terreur, comment faire l'accueil, comme garantir des droits.
Notre expérience historique nous apprend que rien n'est jamais acquis. De l'ex-Yougoslavie, au
Rwanda, et aujourd'hui de l'Erythrée à la Somalie et enfin de l'Irak à la Syrie, les situations se
répètent et les souffrances semblent sans fin, comme si les êtres humains ne pouvaient voir
l'écoulement de la vie que comme une suite de violences éventuellement séparées par des
intermèdes de paix civile et d'instauration de l’État de droit.
On pourrait alors se laisser aller au pessimisme nihiliste et se contenter d dire « c'est comme ça ».
C'est ainsi que l'on justifierait une sorte de méfiance pour les droits. L'argument est le suivant.
Puisque les droits ne sont pas appliqués partout, ils ne sont pas universels. Il conviendrait de
prendre la mesure réaliste de l'évolution du monde. C'est un discours très habituel que celui qui fait
de la realpolitik le fondement des relations internationales. Et il permet de renvoyer les défenseurs
des droits dans le camp des rêveurs, des utopistes, des droit-de-l’hommistes. Il est ainsi monnaie
courante pour une organisation comme la LDH de se voir opposer la pratique au principe. Dans ce
cadre il est défendu l'idée que l'on ne fait pas de politique avec les droits. Probablement ne peut-on
pas faire de politique qu'avec les droits, mais ce qui reste historiquement vérifié, c'est qu'on n'en fait
pas de bonne sans les droits.
Dans certains milieux politiques, on oppose régulièrement la réalité de l'état des droits à la DUDH.
Comment peut-on parler de l'universalité des droits quand ils ne sont pas appliqués partout ? C'est
oublier que les droits sont une conquête et qu'ils ont une histoire. S'ils ne sont pas appliqués partout
ne signifie pas qu'ils ne sont pas applicables partout. Et si l'on mesure l'état des droits à la situation
la pire qui puisse exister sur la planète, si l'on compare ce qui se passe en Espagne ou en France à ce
qui se passe disons au Soudan ou en Arabie saoudite, alors il n'y a rien à faire que de se
recroqueviller sur notre petite communauté en espérant qu'aucun dictateur ne prenne la décision de
passer à l'acte. Comme en 1933, comme en 1936, comme en 1973. En fait comme à peu près tout le
temps. Il est justifié de proclamer que la définition des droits ne se fait pas en comparant ce qui se
passe dans chacun des pays à l'aune de ce qui se fait dans le pire d'entre eux, mais par rapport au
corpus des droits, marqué par leur universalité et leur indivisibilité
La notion de mondialisation qualifie l'interdépendance croissante du monde sur les plans
technologique, économique et financier. Le terme de globalisation, que les anglophones utilisent
rend peut-être mieux compte de ce qui n'est pas une apparition de l' économie-monde qui est
ancienne, mais une nouvelle étape dans une mondialisation de l'aventure humaine dont les racines
sont lointaines. Les trois domaines d'interrogation sont les suivants. Comment garantir l'universalité
des droits dans un monde en fragmentation ? Comment faire que les droits civiques et politiques ne
soient pas balayés par les politiques sécuritaires ? Comment maintenir les droits économiques,
sociaux et culturels remis en cause par les effets des crises ?
Dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous pouvons émettre l'hypothèse que défendre
l'universalité des droits c'est faire revenir sur le devant de la scène les manquements et les crimes
qui ont marqué l'histoire des pays. On ne peut valablement défendre les droits et la démocratie sans
avoir tiré les leçons et initié les réparations morales et individuelles, sans avoir fait toutes les
lumières et dit toutes les vérités. Parce qu'il en va de la crédibilité de l'extension des droits que nous

voulons pour tous et partout. Parce que il s'agit de l'universalité de la condition humaine puisque
« chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition » comme le disait Montaigne.
Pour vivre dans ce monde élargi à toute la planète, notre tâche est alors de refonder l'universalisme
en lui donnant toute la légitimité d'un droit commun de l'humanité avec autant de légitimité au
regard des civilisations non européennes que là où il s'est d'abord développé historiquement. Mais
pour faire ça, il nous faut faire l'histoire des droits et de ses involutions. A défaut, les discours
relativistes continueront à connaître de beaux jours. Souvenons-nous qu'ils sont toujours au service
non des peuples ou des individus mais des despotes, sous couvert de défense de la religion, de la
famille, de la patrie, que sais-je encore, en tout cas pour éviter de mettre en avant qu'il y a bien des
réalités communes aux individus qui seuls font les sociétés. C'est un défi d'importance pour l'avenir
de l'humanité et l'universalisme dont nous nous réclamons. Car si le monde forme un système
définit comme un ensemble d'éléments en interaction constante, il en résulte à la fois un destin plus
que jamais commun et une échelle pertinente qui est celle de l'intégration mondiale en train de se
jouer.
Je vais faire ce qui peut apparaître de prime abord comme un détour. Le discours commun bien
installé est celui de la primauté, voire de la victoire d'une économie libérée du politique et
prétendant n’obéir qu’à ses propres lois et il se déploie depuis quarante ans à l'échelle mondiale. Ce
qui fut longtemps l'apanage du Sud, c'est-à-dire la régression sociale massive imposée par le FMI
sous le nom d'ajustements structurels (Argentine, Mexique, nombreux pays africains, etc.), est
désormais le lot d'Etats européens, Grèce, Portugal, Irlande, Espagne, ceux que l'on appelle
honteusement les PIGS !... en attendant peut-être l'Italie, la Belgique, la France, etc. Derrière une
façade institutionnelle maintenue, s'impose une tutelle déléguée des prétendus marchés qui évite de
désigner clairement les acteurs demandant jusqu'à 15% par an de rentabilité financière. Les
questions de l'efficacité de la politique et du type démocratique ou non de sortie de crise se posent
régulièrement comme à Reykjavik, à Athènes, à Madrid. Elles sapent la confiance dans les
institutions représentatives et la participation électorale un peu partout en Europe. Et dès lors je
propose une deuxième hypothèse : sur ce fond d'affaiblissement de la politique, la tentation existe
de considérer que les droits sont secondaires. Ne peut-on dire que nombre des projets de loi
proposés par le gouvernement Rajoy et pour certains adoptés par les Cortès, ont le fumet d'une
certaine filiation ?
Élargissons encore la réflexion. Depuis l'effondrement du communisme à la mode réelle et
l'incapacité subséquente des forces progressistes à relever le défi de l'idéologie néo-libérale
triomphante, nous vivons dans cette nouvelle scène idéologiquement bipolaire alors même que le
monde réel est plutôt géopolitiquement multipolaire. D'un côté le monde est réduit à un marché
commun par l'hégémonie culturelle des tenants de la globalisation financière, de l'autre il est refusé
au nom de contre-valeurs traditionalistes/régressives, religieuses, nationalistes.
Il n'y a de ce point de vue pas de limitation à l'inventaire des droits. Cet inventaire est aussi celui du
passé. On ne pourrait pas penser les droits au présent si on n'a pas pensé le passé. Je voudrais
donner les dix domaines qui constituent de mon point de vue le corpus d'analyse et d'action pour la
défense et la promotion des droits. Cet inventaire est sans hiérarchie. C'est la grandeur et il est vrai
la servitude des organisations généralistes de promotion et de défenses des droits d'en être les
acteurs. Et je voudrais dire qu'ils sont non seulement les enjeux de la politique internationale
d'aujourd'hui, mais aussi un programme de développement des droits dans chacun de nos pays :
les changements à apporter au fonctionnement des Organisations internationales pour
qu'elles soient universelles ;
le règlement des conflits et le droit des interventions militaires internationales ;
la Justice internationale et les rapports entre la justice transitionnelle et la CPI ;
la continuité entre l'Universalité des droits et le pluralisme culturel

les droits des femmes comme axe stratégique et l'égalité femmes-hommes comme
impératif ;
faire solidarité avec les dynamiques démocratiques contre les solutions autoritaires,
despotiques ou théocratiques et la réalpolitik ;
défendre toutes les libertés menacées par les mésusages étatiques et privés des techniques en
particulier d'information, pour le respect de la vie privée et des données personnelles
faire de la convention internationale pour les droits des migrants et de leurs familles une
réglementation vers la reconnaissance de la citoyenneté de résidence au-delà des titres de
séjour ;
défendre les droits des peuples à décider par eux-mêmes et ceux des minorités à exister ;
considérer que les questions climatiques et écologiques sont mondiales et vitales au sens
propre du terme, parce que à + 4°, le sort de la planète et de toutes les espèces est en jeu.
Les droits et la justice, les libertés et la démocratie : autant de termes et de notions qui ne peuvent
pas se conjuguer au futur si l'histoire de leur passé est enfoui sous de prétendues nécessités de la
politique même et surtout s'il s'agit de réconciliation nationale. Et j'émettrais ma troisième
hypothèse : cet enfouissement du passé est asymétrique. Il met sur le même pied les victimes et les
bourreaux. Cette asymétrie n'est ni juridiquement fondée, ni politiquement justifiée.
J'ai voulu fonder l'idée, valable en tout pays, que le futur des droits de l'Homme est au moins en
partie lié à la reconquête du passé. Mais tout le monde comprend bien qu'une tâche de cette
ampleur, n'est pas chose aisée. Non seulement les acteurs concernés, les auteurs des crimes comme
leurs héritiers politiques se battent sans relâche pour solder à moindre frais ces périodes. Mais de
plus les rapports de force politiques internationaux enserrent les pays dans tout un réseau
d'échanges et de compromis peu conforme aux droits et peu sensible à la justice. Il n'est qu'à voir
combien ce que l'on appelle la communauté internationale a du mal à faire respecter les droits,
pourtant proclamés par une déclaration universelle en 1948 et judiciarisés et donc justiciables, par
deux pactes internationaux sur les droits civiques et politiques et les droits économiques, sociaux et
culturels en 1966. Voyez la Hongrie qui n'a pas l'air d'être sensible aux injonctions, il est vrai
timides, de l'Union européenne d'abandonner sa politique de discrimination. Voyez la Chine,
insensible à sa condamnation régulière pour son refus catégorique des libertés démocratiques.
Voyez l'Arabie saoudite condamnée par le comité pour l'élimination de la torture pour les centaines
de coups de fouet qu'elle inflige à ses condamnés. Et cependant elle vient d'obtenir un poste de
responsabilité au Comité des droits de l'Homme des Nations Unies. Voyez le Soudan, l'Erythrée.
Mais aussi la France pour le traitement des Roms. Les Etats-Unis pour les exécutions capitales. Et
la Russie pour ses internements abusifs et les crimes commis en Tchétchénie. Et tant d'autres...
Il nous faut prendre la mesure de ce qu'est cette communauté internationale et de ses insuffisances
flagrantes s'il s'agit de parler de droits. Mais aussi accepter que nous n'avons aucun intérêt à
transformer de mauvaises instances de discussion en de bonnes guerres. Je plaide donc pour que
nous considérions la communauté internationale au sens large, et non pas réduite à ses divers
comités officiels. Il faut à la fois élargir le plaidoyer et assiéger les institutions.
Je définirai plusieurs niveaux d'action pour que notre action en faveur des droits soient cohérente :
Profiter de tout élément en discussion au Comité des droits de l'Homme de l'ONU pour
généraliser la critique des lois d'amnistie asymétriques et rédiger des communications
rappelant la situation espagnole ;
au moment des examens périodiques universels , rédiger et publier des rapports alternatifs
qui permettent de peser sur les discussions des États membres ;
organiser la coopération avec des organisations des pays concernés par les questions de
même nature ;

demander au Comité contre les disparitions forcées une action solennelle pour le deuxième
anniversaire en juillet 2016 de sa communication et de ses recommandations au
gouvernement espagnol ;
développer l'action pour que ce qu'il est convenu d'appeler la justice transitionnelle soit
équilibrée entre la justice et la transition singulièrement en faisant de la Cour pénale
internationale un véritable instrument de droit par le développement du nombre d'Etats
parties prenantes ;
intervenir auprès du Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe qu'il
diligente une enquête sur les effets cumulés des lois de 1977, de 2007 et des politiques
dilatoires des instances juridiques espagnoles et du gouvernement ;
organiser une procédure devant la Cour européenne des droits de l'Homme au motif
d'inégalités de l'exercice de la justice pour les victimes de crimes imprescriptibles ;
solliciter des députés européens pour que la commission LIBE du parlement européen se
saisisse de ces questions et enquête sur ces questions
utiliser la clause de compétence générale, que le gouvernement espagnol cherche d'ailleurs à
limiter fortement, pour amener certaines juridictions nationales, par exemple dans des pays
qui ont accueillis des réfugiés en 1936, à diligenter des enquêtes ;
faire organiser par les associations des sociétés civiles de différents pays concernés une
rencontre internationale lors d'une assemblée générale des Nations unies pour discuter du
futur des droits universels sous la menace d'un passé qui ne peut pas passer ;
solliciter les groupements internationaux professionnels d'historiens pour l'organisation
d'une campagne systématique de demandes auprès des institutions espagnoles aux fins de
révéler l'histoire.
Peut-être ne ferons-nous pas tout en même temps. Mais je vous demande de voir que ces
instruments d'actions ont quelque chose à voir avec les dix domaines d'actions pour l'universalité
des droits que je vous ai présenté dans cette communication. En février 2014, le rapporteur spécial
des Nations Unies sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de
non-répétition, Pablo de Greiff, déclarait à Madrid que l'Espagne doit revenir sur sa loi d'amnistie
en enquêtant sur les crimes commis sous la dictature franquiste et il proclamait qu'il faut annuler la
loi d'amnistie de 1977 qui « a été utilisée pour classer sans suite presque la totalité des cas qui arive
devant la justice ». Il constatait de plus « une distance immense entre les positions affichées par la
majeure partie des institutions de l’État d'un côté et les victimes et différentes associations de
l'autre ». Il soulignait aussi que « cette distance est plus grande que dans tous les autres cas
rencontrés lors de mon expérience professionnelle ». Il a enfin appelé « les institutions de l'Etat à
montrer leur engagement de manière décidée, déterminée et prioritaire » à enquêter sur les crimes
commis lors de la guerre civile et la dictature franquiste. Pendant ce même mois de février, les
députés espagnols de la majorité, ont cherché à limiter la procédure de compétence générale dont il
jugeait l'usage abusif par les associations que Pablo de Greiff avait sans doute reçues. Une sorte de
revanche évidente de ces héritiers de Fraga Iribarne. C'est en juillet de la même année que le comité
des Nations Unies sur les disparitions forcées a publié son rapport extrêmement sévère contre
l'Espagne etb demandant sous 90 jours des réponses au gouvernement espagnol.
Où l'on voit que ce n'est qu'un début de réponse internationale. Continuons donc le combat !
1
/
5
100%