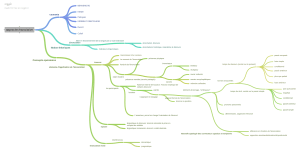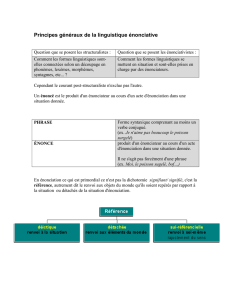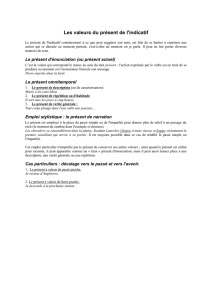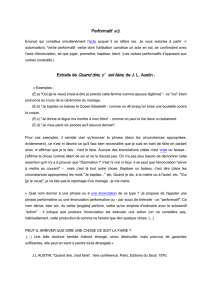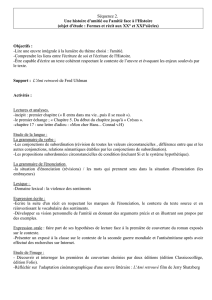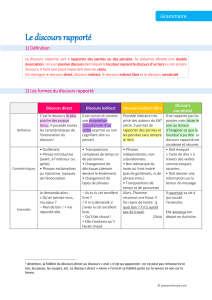Montrer/évoquer

1
De la pragmatique du langage à l’interaction sociale
Pour une reformulation du modèle d’Austin
Alain Eraly
Université libre de Bruxelles
On connaît la théorie des actes de langage d’Austin
1
. Selon le philosophe
d’Oxford, toute énonciation, par exemple « je laisserai la clé sous le paillasson », recouvre
trois actes différents :
1. Un acte locutoire (ou locution), c’est-à-dire la mise en œuvre d’un lexique et
d’une syntaxe afin de produire une phrase qui articule des référents (je, la clé, sous le
paillasson).
2. Un acte illocutoire (ou illocution), c’est-à-dire l’action conventionnelle que nous
réalisons en énonçant la phrase (j’avertis, je préviens, je promets de laisser la clé sous le
paillasson).
3. Un acte perlocutoire (ou perlocution), c’est-à-dire l’effet que nous cherchons à
susciter chez autrui par notre énonciation (qu’il sache comment entrer dans la maison,
qu’il cesse de s’inquiéter, etc.).
Classiquement, l’acte locutoire est l’acte que l’on accomplit par le fait de dire
quelque chose. L’acte illocutoire celui que l’on accomplit en disant quelque chose :
promesse, conseil, avertissement, prière, suggestion, affirmation, etc. L’acte perlocutoire
celui que l’on accomplit par le fait de dire quelque chose : convaincre, dissuader,
surprendre, embarrasser, susciter un sentiment, modifier une opinion, etc. Et toute parole
s’analyse comme la combinaison singulière de ces trois actes dans des circonstances
déterminées.
La théorie austinienne des actes de langage, plus ou moins amendée, raffinée,
complétée par des auteurs comme Searle, Vanderveken, Ducrot, Strawson, Récanati, Bach
et Harnish est au cœur de ce qu’on nomme la pragmatique du langage, à savoir l’étude de
l’usage du langage en situation, par opposition à la linguistique qui concerne l’étude du
système linguistique in abstracto, sous l’angle phonologique, morphologique, syntaxique et
sémantique. En gros, on peut dire que la pragmatique a pour objet l’étude de ce qui, dans
la signification d’un énoncé, relève de la situation des locuteurs et non de la seule
structure linguistique de la phrase utilisée. Plus on étudie le langage concret, c’est-à-dire
les paroles en situation, plus la signification des énoncés, et d’abord l’identification des
1
J.-L. Austin, Quand dire, c’est faire, Paris, Seuil, 1970. Voir aussi : K. Bach & R.M. Harnish, Linguistic Communication and
Speech Acts, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1979; O. Ducrot, Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique,
Paris, Hermann, 1972. Fr. Récanati, La transparence et l’énonciation. Pour introduire à la pragmatique, Paris, Seuil, 1979. J.R.
Searle, Les actes de langage, Paris, Hermann, 1972 ; Sens et expression, Paris, Minuit, 1982. J.R. Searle & D. Vanderveken,
Foundations of Illocutionary Logic, Cambridge, Cambridge University Press, 1985. P.F. Strawson, “Intention and
convention in speech-acts”, The Philosophical Review, 1964.

2
référents (Qui est « je » ? De quelle clé et de quel paillasson parle-t-on ?), s’avère
dépendante du contexte de son énonciation. De ce point de vue, la pragmatique
linguistique semble s’inscrire naturellement dans une théorie de l’interaction verbale.
Or, cette inscription est pour le moins malaisée comme l’a bien vu Pierre
Bourdieu
2
. La conception de l’interaction verbale qui émerge des études de pragmatique
reste souvent entachée d’un formalisme réducteur. Il ne s’agit pas ici de reconduire la
critique sociologique trop facile qui reproche aux spécialistes du langage de postuler une
situation de parole abstraite en négligeant la variété des déterminations sociales qui font
de toute énonciation un événement produit non par des locuteurs indéfinis mais par des
agents sociaux, lesquels importent leurs connaissances mutuelles, positions, rôles, statuts,
pouvoirs dans leurs moindres échanges en sorte que leur être social s’exprime dans leur
lexique, leur syntaxe, leur prononciation, les tournures qu’ils adoptent, le contenu de leurs
discours. Mes réserves portent plutôt sur la conception de l’interaction. La pragmatique
du langage reste naturellement centrée sur son objet premier, elle tend par conséquent à
reconstruire l’interaction à partir du langage, et donc à n’introduire dans sa conception que les
seuls éléments qui lui sont absolument nécessaires pour répondre à cette question
fondamentale : d’où vient la signification des énoncés ? De leur côté, les sciences sociales
partent d’une question plus générale : comment les êtres humains, dans le cours de leurs
activités, agissent-ils les uns sur les autres, notamment au moyen du langage ? Lorsque donc
les sciences sociales partent de l’interaction pour y inscrire le langage, la linguistique tend à
partir du langage pour reconstruire l’interaction. Un tel point de départ comporte des
dangers évidents.
Marquée par sa double origine – la linguistique de la phrase et la logique -, la
pragmatique du langage conduit souvent à négliger la matérialité et la subjectivité de
l’interaction verbale. Centrée sur les énoncés, elle renvoie dans ce fourre-tout trop
commode qu’est le « contexte » la matérialité fondamentale de l’interaction : le milieu
d’activités communes où surgit l’énonciation, l’environnement matériel de l’échange et
d’abord la contribution des corps : la distance entre les interlocuteurs, les postures, les
mouvements, les mimiques, l’intonation, tous éléments tenus pour des adjonctions au
langage. Par une abstraction arbitraire – certes féconde au plan heuristique -, on retire du
langage les contributions corporelles qui, depuis les premiers protolangages, lui furent
consubstantielles et que le jeune enfant apprend en même temps que l’usage des mots. Le
chemin est alors ouvert pour une dématérialisation de l’interaction verbale, conçue
comme un simple échange de représentations mentales via les paroles échangées.
Encore plus remarquable à mon sens est la mise entre parenthèses de la
subjectivité de l’interaction. Chacun en conviendra : lorsque nous disons quelque chose,
nous exprimons, nous ne pouvons faire sans exprimer une disposition affective : bienveillance,
joie, agacement, colère, froideur, détachement, ironie, etc. Cette expressivité affective
propre à toute communication est étrangement négligée dans la théorie du langage,
fascinée qu’elle est par la phrase ou l’énoncé. Ainsi le Dictionnaire encyclopédique de
2
P. Bourdieu, Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982.

3
pragmatique réalisé par Jacques Moeschler et Anne Reboul
3
n’évoque-t-il nulle part la
question centrale de l’expression des sentiments - au point de négliger ce fait pourtant
élémentaire qu’il est possible de réaliser la même locution et la même illocution, par exemple
la formulation d’un reproche, en exprimant de la tristesse, de la colère, du mépris, etc.,
cette expression affective affectant directement la perlocution (l’expression de la tristesse pour
culpabiliser, de la colère pour impressionner, du mépris pour blesser, etc.).
La question de la signification délimite presque naturellement le domaine de la
pragmatique linguistique. Celle-ci cherche avant tout à répondre à la question assurément
fondamentale : comment les locuteurs font-ils pour se comprendre ? C’est la raison pour
laquelle le concept austinien de perlocution – l’effet anticipé d’une parole – ne retient
guère l’attention en pragmatique. Or une signification n’est jamais qu’une médiation dans
l’exercice plus général d’une influence sociale. Devant toute énonciation, la question de
l’interprète : « Que cherche-t-il à me faire comprendre ? » s’inscrit nécessairement dans
une autre : « Dans quel but me dit-il cela ? Comment s’attend-il à ce que je réagisse ? » Nul
ne parle simplement pour se faire comprendre. A l’instant de s’élancer dans son discours,
le locuteur anticipe déjà la réaction d’autrui et le langage, de ce point de vue, ne se réduit
pas un instrument de référence et de signification, il recouvre un ensemble hétérogène
d’actions sonores sur les actions d’autrui.
Dan Sperber et Deirdre Wilson
4
, inspirés par Paul Grice, discernent au fondement
de tout énoncé une intention informative : l’intention qu’a le locuteur de faire savoir
quelque chose à l’autre ; et une intention communicative : l’intention qu’il a de lui faire
connaître son intention informative. Supposons qu’un ami m’ait fait faux bond et que je
désire lui faire savoir ma déception. Je pourrais par exemple attendre qu’il se trouve dans
les parages et dire à voix haute à un tiers : « je l’ai attendu en vain hier soir » en feignant
d’ignorer sa présence. Je pourrais aussi lui adresser ce reproche directement : « je t’ai
attendu en vain hier soir ». Dans les deux cas, j’ai informé mon ami de ma déception.
Quelle différence fondamentale entre les deux procédés ? Dans le second, je n’ai pas
seulement l’intention de faire comprendre à mon interlocuteur la déception qu’il m’a
causée, mais simultanément l’intention qu’il reconnaisse mon intention de le lui faire
comprendre. Cet argument est assurément pertinent, mais il néglige une question plus
générale : faire comprendre dans quel but ? Pour susciter quel effet chez l’autre ? Un
message se formule et s’interprète toujours sur le fond principiel d’une inter-action.
Pour finir, la pragmatique du langage reste marquée par la tentation d’aller
chercher dans les énoncés ce qui appartient à la situation de communication, de leur
prêter une force qui provient des rapports sociaux. La croyance reste ancrée que la
signification d’un message appartient au champ linguistique, qu’elle est une propriété des
énoncés eux-mêmes. Les êtres humains, dans cette perspective, se comprennent pour
autant qu’ils comprennent les énoncés qu’ils profèrent et ce qu’ils expriment se réduit à
ces énoncés. Même prononcée par un perroquet ou débitée par un ordinateur, la phrase
3
Paris, Seuil, 1994.
4
D. Sperber & D. Wilson, La pertinence. Communication et cognition, Paris, Minuit, 1989.

4
« le chat est sur le paillasson » possèderait ainsi une signification objective. Il existerait
donc, en deçà de l’interaction verbale, quelque chose comme un noyau dur, une
signification pure qui tiendrait à son contenu de vérité. La mystique du texte vivant,
dépositaire du sens, ressurgit sans cesse comme une tournure spontanée de notre esprit.
On semble ne pouvoir se résoudre une bonne fois à admettre que la suite de mots « le
chat est sur le paillasson » ne veut rien dire en dehors de l’interlocution tout simplement
parce que les êtres humains seuls sont susceptibles de vouloir dire. Que la phrase ne
contient pas plus sa signification qu’un marteau son usage. Que même la signification la
plus littérale s’obtient en replaçant tacitement, presque inconsciemment, la phrase dans un
contexte interlocutif. Notre esprit est simplement incapable de considérer un énoncé sans
évoquer – ou moins que ça : sans se disposer à évoquer – son usage potentiel. Du reste, où
a-t-on vu un énoncé distinct de son énonciation ? Comment justifier pareil objet ? Suivant
l’acception classique, une phrase – ou « proposition » - est une entité linguistique abstraite,
indépendante des locuteurs, identique à elle-même à travers ses occurrences. Abstraite de
l’énonciation, la phrase semble exister indépendamment de son énonciation comme un
outil de l’usage concret de cet outil. L’énonciation est l’acte de production de l’énoncé,
l’énoncé est le résultat de l’énonciation, il s’oppose à celui-ci comme le produit à l’acte de
production. Or, dans le cas de la parole, comment distinguer production et produit sans
réifier l’énoncé, c’est-à-dire sans lui donner une existence autonome et objective qu’il
n’acquiert, à la rigueur, que sous sa forme écrite ?
Dans la suite de cet article, je me propose d’esquisser les grandes lignes d’une
reformulation de la théorie des actes de parole susceptible de dépasser les limites propres
à la pragmatique en inscrivant la parole dans l’interaction sociale en faisant droit à la
subjectivité et la matérialité qui lui sont propres. Pour ce faire, il me semble utile
d’introduire six modifications dans la théorie princeps afin de faire des actes de langage
des actes proprement sociaux, c’est-à-dire visant un effet sur autrui.
1. On l’a vu, l’acte locutoire recouvre, chez Austin, le fait de produire des sons, de
combiner ces sons pour former des vocables et d’articuler ces vocables afin de « produire
une phrase dotée d’un sens et d’une référence ». Cette conception mélange deux types
d’éléments logiquement distincts : a) l’énonciation proprement dite (les sons qui se
combinent pour former des mots qui se combinent pour former des phrases) ; b) la
référence, c’est-à-dire la réalité extérieure à laquelle renvoie l’énonciation. Comme telle,
l’énonciation n’est pas un acte social si l’on entend par là une action sur l’action d’autrui,
elle n’en est que le substrat ou le médium. Et quel rapport entre l’énonciation et la
référence ? Le même, dirions-nous, qu’entre l’index pointé et le fait de désigner, par ce
geste ostensif, un objet à l’attention d’une personne. L’index pointé est le moyen de la
désignation et seule cette désignation est un acte social. En pointant l’index, je montre un
objet à la personne tout juste comme en lui parlant, je suscite chez elle l’évocation d’une
réalité extérieure à cette énonciation. Et de même que je puis parler tout seul, de même
puis-je m’amuser à pointer solitairement l’index devant moi. En revanche, il faut la
présence d’autrui – fût-ce d’un autrui imaginé – pour désigner un objet ou pour susciter son

5
évocation. L’énonciation ne saurait inclure ni se confondre avec la référence, elle n’est que le
moyen de cet acte social spécifique qu’est la référence si l’on entend par là l’action de susciter
une évocation chez autrui.
2. Cette référence, comment la comprendre ? Il n’est pas question ici de se
confronter à la question classique de l’existence ou non de la réalité à laquelle le locuteur
fait référence et dont il cherche à susciter l’évocation chez son allocutaire, mais plus
fondamentalement de s’interroger sur cette propriété fascinante du langage de renvoyer à
ce qui n’est pas – ou pas encore – présent dans la situation d’interlocution. Cette relation
de « renvoi à autre chose », il est étrange de constater qu’elle est ordinairement postulée au
fondement du langage et des systèmes de signes comme si c’était une évidence naturelle.
De quoi s’agit-il au juste ? Lorsque nous disons quelque chose, par exemple « j’ai
mal dormi cette nuit », nous évoquons neuf fois sur dix un être ou un événement absent,
c’est-à-dire étranger en quelque manière à la situation que nous partageons, mon
interlocuteur et moi - un être ou un événement étranger à notre champ de perception et
que nous ne pouvons, par conséquent, montrer simplement du doigt. Dans l’immense
majorité de nos énonciations, il existe l’un ou l’autre élément qu’on ne peut montrer et
qu’on doit se débrouiller pour évoquer. Si, me promenant dans un musée, je dis à ma
compagne : « j’adore celui-là » en désignant un tableau devant nous, je montre bel et bien le
tableau, mais j’évoque le fait que je l’adore. Le tableau est présent dans notre champ de
perception commun, mais non pas mon adoration. J’appelle fonction virtuelle cette propriété
fascinante du langage de représenter (re-présenter) des réalités absentes, c’est-à-dire de
susciter chez les interlocuteurs une évocation déterminée. A l’évidence, ce qu’on a
coutume d’appeler la « fonction référentielle » présuppose nécessairement cette faculté
plus générale de représentation. Pour qu’une phrase renvoie à une réalité extralinguistique
spécifique, pour qu’on puisse poser la question de son « contenu de vérité », c’est-à-dire
de sa « correspondance » éventuelle avec un état de la réalité, il faut que les locuteurs aient
appris cette autre manière d’habiter et d’éprouver le monde, intégralement fondée sur la
conscience partagée de l’absence, sur ce « sentiment paradoxal de présence de l’absent »
qu’évoque Paul Ricoeur
5
.
Il s’agit bien d’apprentissage, et même d’apprentissage social. Cette fonction
virtuelle, je le répète, n’a strictement rien d’évident. Si certains mammifères supérieurs
présentent, selon toute vraisemblance, une capacité d’évocation rudimentaire, la fonction
virtuelle du langage recouvre quant à elle un faisceau complexe de dispositions cognitives
et pratiques qui correspondent à autant de modalités grammaticales et narratives. Il y a de
multiples façons d’être absent et il faut à l’enfant des années d’apprentissage pour en
acquérir la maîtrise : la relation à l’être ou l’événement absent peut se concevoir sur le
mode de l’ailleurs (mon ami qui est parti en Australie), du passé (mon grand-père décédé),
du futur (les vacances prochaines), du conditionnel présent (ce que je pourrais faire), du
conditionnel passé (ce que j’aurais pu faire), du fictionnel (Madame Bovary), de l’interdit
(tricher aux cartes), etc. La culture se glisse au cœur même du signe, dans les différentes
modalités de renvoi du signifiant au signifié.
5
J.-P. Changeux & P. Ricœur, Ce qui nous fait penser. La nature et la règle, Paris, Odile Jacob, 1998.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%