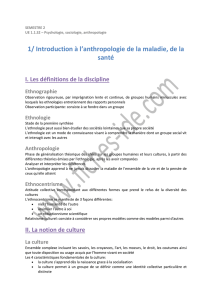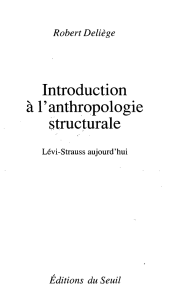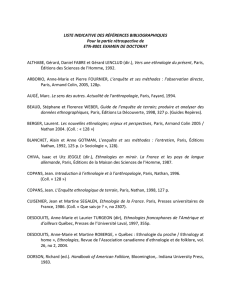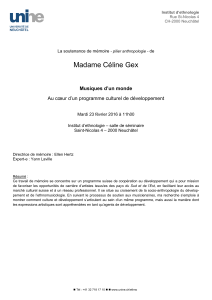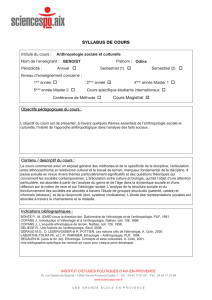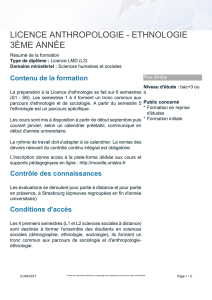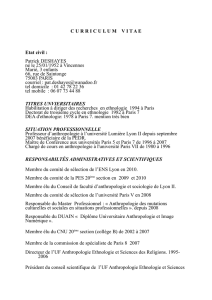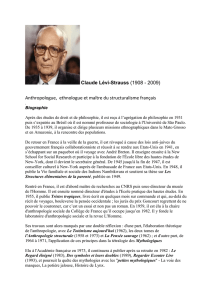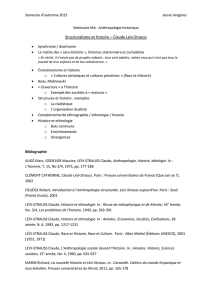Word - La recherche

E
Et
th
hn
no
ol
lo
og
gi
ie
es
s
c
co
om
mp
pa
ar
ré
ée
es
s
http://alor.univ-montp3.fr/cerce/revue.htm
N°8
Printemps 2005
PAYS, TERROIRS, TERRITOIRES
Un parcours ethnologique
Entretien avec Françoise Héritier
Paul Pandolfi : Commençons par le début si vous voulez bien. Pourriez-vous
nous dire pourquoi et comment vous êtes devenue ethnologue ? Comment êtes-
vous entrée en ethnologie en quelque sorte ?
Françoise Héritier : Cela me ramène à un temps qui pour moi n’est pas très
lointain mais qui pour les jeunes chercheurs paraîtra antédiluvien. C’est un
temps où il n’y avait pas d’enseignement de sciences sociales et humaines et pas
d’enseignement d’ethnologie à proprement parler. Existaient cependant à Paris,
au Musée de l’Homme, un certificat d’ethnologie, plus exactement un certificat
d’ethnologie-sciences et un certificat d’ethnologie-lettres. C’était tout. Cela pour
cadrer la situation. J’étais alors étudiante en histoire et géographie et je me
préparais à l’agrégation. J’étais très liée avec des étudiants en philosophie qui
préparaient eux aussi ce concours et qui devaient obtenir, pour se présenter à
l’agrégation de philo, un certificat de science. C’était alors une obligation légale.
Ils choisissaient parmi les différents certificats de science qui leur étaient
proposés celui qui leur paraissait le plus proche de leurs intérêts, c’est-à-dire
celui d’ethnologie-sciences. Par sciences, on entendait un peu de statistique, de
démographie, d’anthropologie physique et pas seulement de l’anthropologie
sociale et culturelle. Ils en parlaient avec moi avec énormément d’intérêt. Et
surtout, ils évoquaient la découverte que représentait pour eux l’enseignement
de quelqu’un qui à l’époque était presque un nouveau venu : Claude Lévi-
Strauss.
Il était de retour en France après son long séjour aux USA. Mes camarades
suivaient ses enseignements à l’EPHE où il était directeur d’études à la Vème
section (sciences religieuses) et la VIème section (sciences économiques et
sociales). Et ils en parlaient avec tellement d’enthousiasme que je suis allée y
voir. Or, à cette époque (années 1954-55), je ne savais même pas que
l’ethnologie était une discipline, je ne savais même pas ce que ce terme
recouvrait. J’y suis allée pour me rendre compte par moi-même et j’ai suivi les
enseignements de Claude Lévi-Strauss pendant plusieurs années. Ce fut une
découverte totale. Il ne se souvient peut-être pas lui-même de ces cours mais

Ethnologies comparées
Centre d'Études et de Recherches Comparatives en Ethnologie
2
j’en ai gardé un grand souvenir parce qu’ils étaient désorientants pour quelqu’un
qui faisait des études d’histoire et de géographie. Cette année-là, il nous parla du
privilège du neveu utérin chez l’oncle maternel et particulièrement de ce
privilège portant le nom de vasu à Fidji. Et ce vasu fidjien était pour moi porteur
d’une charge d’exotisme et d’étrangeté absolue. J’ai donc suivi ses cours et me
suis inscrite par la suite pour passer ce certificat d’ethnologie mais option lettres.
C’est la seule formation que j’ai eue en ethnologie, il n’y en avait pas d’autre de
toute façon. J’ai continué à suivre les enseignements de Lévi-Strauss. La
deuxième année, il traita de la chasse rituelle aux aigles chez les Hidatsa, de la
fabrication des paquets rituels de chasse etc. Par la suite, il a traité de choses très
différentes, en collaboration avec Jean-Claude Gardin, sur le rapport entre
archéologie et ethnologie et notamment sur la mise au point d’un langage
universel de description des objets et artefacts tant ethnologiques
qu’archéologiques. Le début de mon parcours est là. Cela ne m’empêchait pas
de préparer l’agrégation mais l’envie me passait de plus en plus de rester dans la
ligne que j’avais préalablement choisie. Le coup de chance ce fut lorsque Claude
Lévi-Strauss, qui avait des amis qui de temps en temps proposaient des
opportunités aux jeunes, a fait savoir à la fin de l’année 1956 qu’un de ses
collègues, Roger Daval, désirait recruter deux jeunes chercheurs, un ethnologue
et un géographe, pour aller travailler en Haute-Volta. Roger Daval était
professeur de philosophie à l’université de Bordeaux et il y avait monté un
Institut de sciences humaines appliquées (ISHA) qui avait passé un contrat avec
le Service de l’hydraulique de l’AOF. Il s’agissait d’un programme
d’aménagement consistant à établir un barrage sur le Sourou, un affluent de la
Volta noire doté d’une caractéristique intéressante pour les géographes. C’est un
affluent-défluent, son cours change selon les moments de l’année : au moment
des crues il coule dans l’autre sens. Cela permet de faire des cultures irriguées à
deux moments de l’année. L’idée était d’établir un barrage pour régulariser ce
système naturel des crues et ce dans une région très faiblement peuplée pour
diverses raisons historiques mais aussi sanitaires, à cause notamment de la
présence de l’onchocercose et de l’impaludation.
Notre travail consistait à voir si on pouvait envisager des déplacements
volontaires de populations en provenance du plateau mossi. C’est un plateau
latéritique surpeuplé avec de grands flux migratoires qui se dirigeaient à
l’époque vers les plantations du Ghana ou de la Côte d’Ivoire. Le problème était
le suivant : était-il possible de prendre appui sur ces flux migratoires pour en
détourner une partie vers la vallée du Sourou afin d’y pratiquer, grâce à
l’irrigation, la culture du riz. La question était aussi de savoir comment les
migrants seraient accueillis dans la vallée du Sourou.
Claude Lévi-Strauss nous a publiquement fait part de cette proposition. Nous
sommes deux à y avoir répondu : Michel Izard (que j’ai épousé par la suite) pour

Ethnologies comparées
Centre d'Études et de Recherches Comparatives en Ethnologie
3
le poste d’ethnologue et moi pour le poste de géographe, puisque j’avais une
licence de géographie. Je me suis formée en plus auprès d’un ingénieur-
géographe de l’IGN pour apprendre à faire des relevés topographiques à la
planchette car cette technique me paraissait indispensable.
A trouvé place alors une petite histoire intéressante sur le plan des relations
du masculin et du féminin. Des deux candidatures présentées par Lévi-Strauss,
celle de Michel Izard a été aussitôt acceptée par le Service de l’Hydraulique et la
mienne a été refusée parce que j’étais une femme. Elle n’a été retenue que trois
mois plus tard en l’absence de candidature masculine. Ils m’ont acceptée
contraints et forcés en quelque sorte. D’une certaine manière, j’ai forcé les
portes du destin. L’idée était que le terrain n’était pas fait pour les femmes. Ce
n’était pas une nouveauté cependant, puisque dans les années trente Denise
Paulme ou Germaine Dieterlen sont parties sur le terrain mais il s’agissait ici
d’un service officiel de l’administration qui estimait que ce travail n’était pas
fait pour les femmes. Ce fut là mon premier terrain. En fait le barrage n’a jamais
été construit. Mais ceci est une autre histoire. Il y eut l’indépendance et le projet
a été abandonné. J’ai fait à cette occasion mes premiers relevés généalogiques…
Ils ne nous étaient pas demandés mais il nous a semblé utile de ne pas nous
cantonner l’un et l’autre dans les tâches qui nous étaient imparties, l’un en
géographie l’autre en ethnologie. Je m’intéressais déjà à la question du choix du
conjoint et à celle de la transmission des droits, d’où l’enquête généalogique.
Pour passer du pays mossi (qui va devenir le lieu privilégié de travail de
Michel Izard) aux pays marka et pana dans la vallée du Sourou, on traversait le
pays samo. Pays remarquable à plus d’un titre pour l’œil de la géographe que je
me piquais d’être à l’époque. Il n’avait strictement rien à voir avec les deux
autres cultures. Les Mossi forment une population extrêmement nombreuse qui
vit dans un paysage très détérioré. La brousse y est extrêmement clairsemée, le
sol est devenu latéritique et peu cultivable et on observe de grandes étendues
nues et désertiques. Par ailleurs les villages sont des ensembles de type
administratif. J’entends par là que ce sont des lieux où s’exerce un pouvoir local,
une chefferie, mais physiquement ils sont éclatés : ce qu’on voit ce sont des
quartiers qui correspondent à des lignages, des familles étendues. Ils sont
souvent éloignés les uns des autres avec un habitat très particulier : cases rondes,
greniers de paille sur pilotis... c’est un habitat très dispersé. En revanche, on
découvrait en pays pana de tout petits villages très resserrés avec une
organisation en moitiés qui était physiquement visible. L’habitat était constitué
de cases plates, rectangulaires, aux toits en terrasse. Ces petits villages refermés
sur eux-mêmes avaient un côté forteresse. Les Pana sont dans la vallée du
Sourou, c'est-à-dire dans une vallée avec une partie de forêt le long de la rivière,
une brousse assez dense… Entre les deux régions, dans un paysage de brousse
armée constituée majoritairement d’arbustes porteurs de piquants, avec quelques

Ethnologies comparées
Centre d'Études et de Recherches Comparatives en Ethnologie
4
grands arbres épars, se trouvaient les villages samo. C’étaient aussi des villages
compacts avec un habitat en argile séchée (banco), des maisons rectangulaires et
une organisation dualiste assez visible sur le terrain. Mais c’étaient de gros
villages avec une particularité étonnante : ils étaient entourés d’une zone
pourvue d’une seule espèce arborée. On appelle cela un parc, ici un parc à
balanzan, nom d’un arbre dont l’appellation savante est acacia albida. C’est un
acacia qui a plusieurs particularités : il est anthropique, il se reproduit après être
passé par l’appareil digestif des chèvres car les noyaux doivent être prédigérés,
et surtout il perd ses feuilles à la saison des pluies et les garde à la saison sèche.
Ce qui en fait, bien évidemment, un fourrage très précieux. C’est un paysage très
particulier. On quittait une brousse très dense où on ne voyait rien à cinq mètres
et on arrivait subitement dans un immense espace peuplé de ces magnifiques
balanzans, on traversait le parc à balanzans sur plusieurs centaines de mètres et
on débouchait sur les villages. C’était très beau, surprenant et complètement
différent des types de présence au sol des Mossi ou des Pana. Nous y avons fait
halte assez fréquemment. J’ai pris des contacts et en parlant un peu avec les
gens, je me suis rendu compte qu’ils avaient une organisation sociale
particulière qui valait la peine qu’on s’y arrête. Il n’y avait pas de chefferie
comme c’est le cas en pays mossi où il s’agit d’un royaume avec des chefferies
déléguées jusqu’au niveau villageois. Là les villages étaient autonomes même
s’ils pouvaient être regroupés en petites fédérations politiques. De plus, ils
étaient tous organisés sur la base d’une séparation en deux parties qui
correspondaient aux deux maîtrises de la terre et de la pluie. Ajoutez à cela le
fait qu’ils étaient – tout au moins dans la partie que j’ai traversée – très peu
touchés par le catholicisme et par l’islam (ce qui a changé depuis bien sûr), que
visiblement il y avait aussi une importante présence d’autels d’ancêtres, enfin
tout ce que j’ai alors pu entendre dire des interdictions matrimoniales… Bref,
c’est chez eux que j’ai choisi de revenir. C’est là l’histoire de mes débuts.
Concernant ce premier terrain, ces premiers pas en ethnologie, avez-vous
l’impression aujourd’hui, avec le recul, que vous avez pu commettre des
« erreurs ». Si tel est le cas, comment les analyseriez-vous ? Ceci à destination
des jeunes ethnologues qui commencent leur carrière.
À partir de mon expérience de terrain en pays samo, si j’avais une chose à
dire ce serait la suivante : il faut se laisser porter par le terrain, ne pas avoir
d’idée préconçue sur le type de recherche que l’on entend mener. Par ailleurs,
même si l’on croit faire des erreurs, même si l’on pense que ce qu’on observe
n’a pas de logique, n’a pas de rationalité, il faut persévérer car il peut s’agir
d’une erreur d’appréciation qui nous vient de nos propres logiques et
connaissances occidentales. Nous pouvons avoir un biais culturel qui nous
amène à considérer comme seules logiques, seules rationnelles et même
biologiquement fondées des façons de concevoir les choses qui ne sont pas

Ethnologies comparées
Centre d'Études et de Recherches Comparatives en Ethnologie
5
universellement partagées. J’ai connu ce type de situations où j’aurais très bien
pu passer à côté de l’essentiel. L’essentiel pour les Samo, c’est qu’ils ont une
terminologie de parenté omaha et un système semi-complexe d’alliance. Le
système semi-complexe d’alliance, en posant des questions et en faisant un
inventaire comme je l’ai fait (« qui était épousable ou pas ? »), je l’aurais peut-
être vu mais j’aurais très bien pu passer à côté du système omaha de
terminologie. Je n’avais pas appris l’existence de ce type de système. Je ne me
doutais même pas que cela pouvait exister tout comme je ne savais pas que
l’ethnologie existait avant de découvrir Lévi-Strauss. Ce qui fait que lorsque j’ai
commencé à recueillir des termes de parenté, j’ai cru que j’étais induite en erreur
par des défauts de compréhension, que je n’arrivais pas à me faire comprendre,
que les autres ne recevaient pas clairement ma demande. Et donc que j’obtenais
des résultats erronés, fallacieux, alors que, tout simplement, j’obtenais des
réponses dont je ne comprenais pas la logique parce que je n’étais pas armée
pour cela, ni culturellement ni scientifiquement.
Par ailleurs, cette première expérience de recueil de termes de parenté m’a
amenée à me rendre compte d’un fait essentiel : il nous est difficile de nous
représenter mentalement, sans l’aide du papier et d’un dessin, le rapport de
parenté qui existe (prenons un exemple simple) entre moi et le fils de la fille du
frère de la mère de mon père. Il faut un gros effort mental pour nous représenter
de qui il s’agit. C’est pareil pour les autres : ils font ce même effort et la
difficulté est encore plus grande si celui qui interroge ou celui qui répond doit
opérer une conversion. Qu’est-ce à dire ? Dans notre conception nous partons
d’Alter : dans mon exemple, le fils de la fille du frère de la mère de mon père.
Les Samo partent d’Ego, quelque chose comme : de ma mère le père puis la
sœur (du père), le fils (de cette sœur), la fille (de ce fils). Donc une conversion
difficile à mettre au point à laquelle aucun apprentissage ne m’avait préparée.
Deuxièmement, j’ai essayé d’appliquer des conseils alors en usage et figurant
dans des manuels. Pour recueillir une terminologie de parenté sommaire (car on
n’envisageait pas un recueil très approfondi) il était conseillé de passer par la
généalogie, de dresser la généalogie d’individus réels et de recueillir leurs
appellations réciproques. Je me suis très vite rendu compte que cela posait deux
ordres de problèmes. Le premier, c’est que si des positions de parenté
manquaient d’un porteur dans la généalogie, personne ne voyait la nécessité de
dire comment on aurait appelé un individu qui n’existait pas. La deuxième
difficulté, parfaitement compréhensible si j’arrive à l’exprimer clairement, tenait
au fait suivant. Dans des sociétés où il y a beaucoup d’inter-mariages
(contrairement à ce que l’on pourrait croire au vu des interdictions), les
individus sont reliés par plusieurs chaînes de parenté et non pas par une seule.
L’appellation qui leur est donnée, quand il s’agit d’individus réels, ne tient pas
nécessairement compte de la chaîne que, nous, nous avons en tête mais peut-être
d’une autre chaîne qui est soit plus courte soit plus évidente pour le locuteur. Par
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%