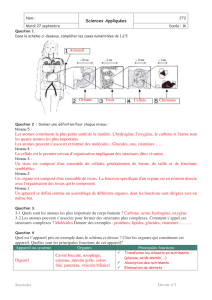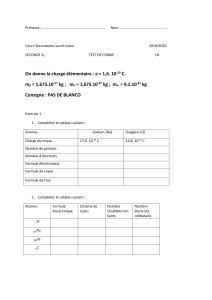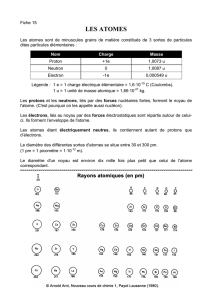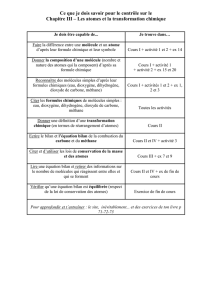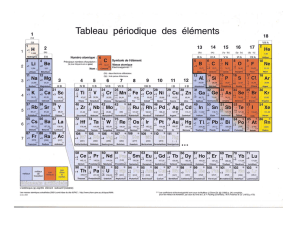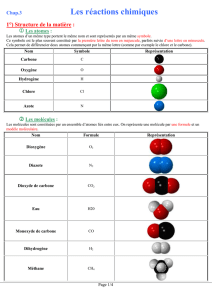Résumé chimie organique

l
Analyse spectrale des molécules
Nomenclature et groupes caractéristiques:
Un alcane est un hydrocarbure saturé à chaîne carbonée ouverte. Sa formule brute est donc : CnH2n+2
Méthane Ethane Propane Butane Pentane Hexane
CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14
Les groupements alkyles sont notés R: méthyle: CH3 éthyle: CH2CH3 isopropyle: CH3CHCH3
Formule topologique: on ne représente pas les atomes de carbone, mais la chaîne carbonée
est représentée en zig-zag : il existe un atome de carbone à chaque extrémité de segment.
On ne représente pas non plus les atomes d’hydrogène liés aux atomes de carbone.
Les autres atomes (O, N, …) sont représentés, ainsi que les atomes d’hydrogène qui leur sont liés.
Un alcène est un hydrocarbure à chaîne carbonée ouverte non saturé car
possédant une double liaison C=C. Sa formule brute est donc : CnH2n
Des molécules isomères ont la même formule brute mais des formules développées différentes.
Un groupe caractéristique est un groupe d’atomes qui permet de différentier une molécule d’un alcane.
Toutes les molécules possédant un même groupe caractéristique appartiennent à une même famille de
composés ayant des propriétés chimiques communes et correspondant à une fonction particulière.
L’atome de carbone présent dans le groupe caractéristique s’appelle « carbone fonctionnel ».
La chaîne carbonée principale, qui donne son nom à la molécule, doit forcément contenir le carbone
fonctionnel. Cette chaîne doit être numérotée dans un sens tel que le carbone fonctionnel porte le plus petit
numéro possible.
Alcools de formule générale ROH
Acides carboxyliques de formule générale RCOH
Esters de formule générale RCOR’
Aldéhydes de formule générale RC O
Cétones de formule générale RC R'
Amines de formule générale RN
Remarque: L'atome d'azote de l'amine peut être lui-même uni à d'autres groupements alkyle.
Le nom de l'amine est alors précédé de la mention N-alkyle
Amides de formule générale RC
Loi de Beer-Lambert:
L'absorbance A d'une espèce X en solution suit la loi de Beer-Lambert:
A = (). l . C où l est l'épaisseur de solution traversée par la lumière
() est le coefficient d'absorption molaire
() dépend de la nature de l'espèce X et de la longueur d'onde de la lumière utilisée.
Groupe hydroxyle
OH
4-méthyl pentan-2-ol
O
Groupe carboxyle
OH
O
O
Groupe ester
de 1-méthyléthyle
2-méthylbutanoate d’isopropyle
H
O
2-méthylbutanal
O
3-méthylbutan-2-one
3-méthylbutan-2-amine
Groupe carbonyle lié à un H
O
Groupe carbonyle
NH2
H
H
Groupe amine
N-éthyl,N-méthyl-3-méthylbutan-2-amine
N
NH2
O
O
N
H
H
Groupe amide
2-méthylbutanamide
MnO4-(aq)
3-éthyl 2,3-diméthyl hexane
O
O
acide 2-méthyl propanoïque
1
4-méthyl pent-2-ène
Attention aux unités! l en m donc C en mol.m–3 A sans unité donc () en m2.mol–1
fonction
groupe
caractéristique
2-méthyl pent-2-ène
C6H12

Spectres d'absorption UV, visible et IR:
Les absorptions dans le visible ou l'U.V. sont dues à des transitions
électroniques. Ainsi, plus il y a de doubles liaisons conjuguées
dans une molécule, plus absorption augmente, passant de l’UV au visible.
* Lorsqu'une espèce chimique n'absorbe que dans un seul domaine de
longueurs d'onde du visible, sa couleur est la couleur complémentaire
de celle des radiations absorbées (voir cercle chromatique ci-contre).
* Lorsqu'une espèce chimique absorbe dans plusieurs domaines de longueurs
d'onde du visible, sa couleur résulte de la synthèse additive des couleurs
complémentaires des radiations absorbées.
Ainsi, la chlorophylle qui absorbe dans le violet (couleur complémentaire
du jaune-vert) et dans l’orange (couleur complémentaire du bleu-roi) donne
des solutions aqueuses de couleur bleu-vert (= jaune-vert + bleu-roi).
Par contre, les spectres I.R. sont liés aux possibilités
de déformation ou de vibration des molécules.
Certains groupes d'atomes donnent des bandes
d'absorption caractéristiques et spécifiques dont
la position dans le spectre dépend peu du reste de la molécule.
Attention! ordonnée = absorbance (visible) ou transmittance (I.R.)
abscisse = longueur d'onde en nm (visible)
ou nombre d'onde = 1/ en cm–1 (I.R.)
Un spectre I.R. permet de détecter les liaisons hydrogène impliquant
les alcools en phase liquide car la liaison O H liée donne une bande
d'absorption large entre 3200 et 3400 cm–1.
Par contre en phase gazeuse, les liaisons hydrogène sont inexistantes
car les molécules sont plus éloignées les unes des autres, et la liaison
O H libre donne une bande d'absorption étroite entre 3580 et 3670 cm-1.
Spectroscopie RMN du proton :
RMN signifie « résonance magnétique nucléaire » et elle concerne ici les protons (noyaux d’hydrogène).
On peut définir pour chaque proton un déplacement chimique δ exprimé en ppm par rapport à une fréquence
de référence qui est la fréquence de résonance des protons dans la molécule de TMS (tetraméthylsilane).
Remarque: le déplacement chimique δ est représenté sur un axe horizontal orienté vers la gauche.
* Des protons qui ont le même environnement dans une molécule sont
équivalents: ils ont le même déplacement chimique.
* On appelle protons voisins des noyaux d’atomes d’hydrogène unis
à des atomes de carbone voisins dans la molécule.
Règle des (n+1) uplets : un groupe de protons équivalents possédant
chacun n protons voisins est caractérisé par un multiplet de n+1 pics.
Les protons des groupes OH, CO2H ou NH2 ne peuvent se coupler avec
d'autres atomes d'hydrogène: ils donnent des singulets.
* La hauteur relative des paliers de la courbe d'intégration indique les proportions de protons dans chaque
groupe de protons équivalents.
Exemple: l’éthyl-benzène a pour formule développée: h1/h2 = 3/2
Les noyaux des atomes H donnent 3+1=4 pics et les noyaux des atomes H donnent 2+1=3 pics.
2
pent-4-ène-2-
ol
lié
Si
CH3
CH3
CH3
H3C
gazeux
OH
libre
chlorophylle
H H
H H
C C H
H
H
H
H
H
Remarque: Les atomes H liés à un cycle benzénique donnent des pics très voisins les uns des autres (vers 7 ppm)
cycle benzénique
1
/
2
100%