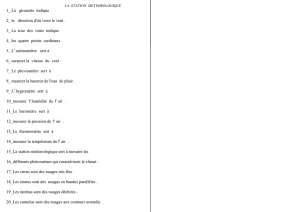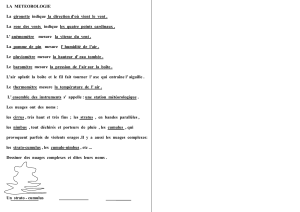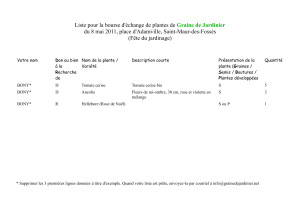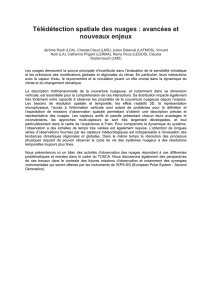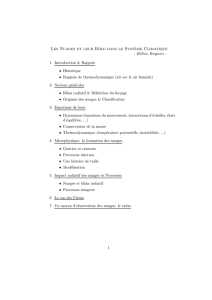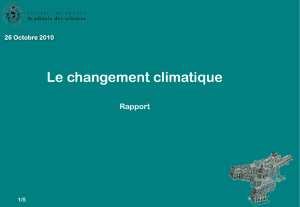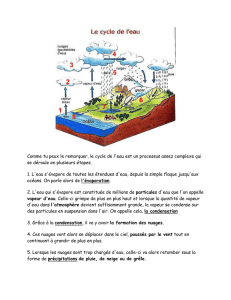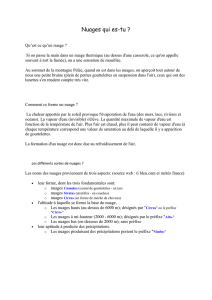II-1 Étude du changement climatique en cours

II-1 Étude du changement climatique en cours
Code couleur:
rouge: personne responsable de chaque sous-section;
bleu: personne dont j'ai reçu les contributions dans les différentes sous-parties.
II-1-1 Troposphère : vapeur d'eau et nuages
II-1-1-a Vapeur d’eau: L.Picon, R.Roca
II-1-1-b Nuages bas océaniques tropicaux : S. Bony, H. Chepfer, F. Chéruy, F. Codron, J-L Dufresne, L.
Fairhead, F. Hourdin, A. Idelkadi, I. Musat, G. Sèze
S. Bony, H. Chepfer, F. Chéruy, F. Codron, J-L Dufresne, L. Fairhead, F. Hourdin, A. Idelkadi, I. Musat,
C. Rio, G. Sèze
II-1-1-c Nuages hauts: R. Armante, M. Bonazzola, A. Chédin, H. Chepfer, C. Crevoisier, M. Haeffelin, B.
Legras, V. Noël, N. Scott, G. Sèze, C. Stubenrauch
II-1-2 Stratosphère
II-1-2 -a Mécanismes à l'origine du changement climatique dans la stratosphère: C. Claud, F. Codron, F. Lott
II-1-2- b Impact de la stratosphère sur le climat de la troposphère: A. Chédin, C. Claud, F. Codron, B. Legras,
F. Lott
R. Armante, A. Chédin
II-1-3 Surfaces continentales
II-1-3- a Caractérisation des surfaces continentales: F. Aires, R. Armante, A. Chédin, C. Crevoisier, F.
D’Andrea, J. Polcher
V. Capelle, A. Chédin, R. Armante, C. Crevoisier
II-1-3- a2 Interaction entre la surface du sol et le climat,
Fabio D’Andrea
II-1-3- b Variabilité du cycle hydrologique: K. Laval, J. Polcher
II-1-3- c Émission de CO2 par les feux de biomasse: A. Chédin, C. Crevoisier, F. Hourdin, N. Scott, S. Turquety
A. Chédin, C. Crevoisier, F. Hourdin, N. Scott, S. Turquety

II-1-1 Troposphère : vapeur d'eau et nuages
II-1-1-a Vapeur d’eau: L.Picon, R.Roca

II-1-1-b Nuages océaniques tropicaux (nuages de couche limite et convectifs)
Permanents : S. Bony, H. Chepfer, F. Chéruy, F. Codron, J-L Dufresne, L. Fairhead, F. Hourdin, A. Idelkadi, I.
Musat, C. Rio, G. Sèze
Thésitifs: F. Brient (début sept 2008), G. Césana (début sept 2010), S. Fermepin (début sept 2010), A. Jam
(début sept 2009), I. Tobin (début sept 2009)
Post-docs: C. Nam (depuis Avril 2011), R. Roehrig (depuis Nov 2010)
Les travaux de recherche réalisés sur les nuages océaniques tropicaux au cours des quatre dernières
années se sont organisés autour de 5 grands thèmes; seuls les principaux résultats sont mentionnés ici:
1. L'amélioration de la représentation des processus de couche limite et des nuages bas dans
LMDZ. Une nouvelle paramétrisation des thermiques de couche limite a été développée dans LMDZ
(Rio et Hourdin 2008), et un schéma statistique de nuages couplé à ce schéma et utilisant une double
gaussienne pour représenter la variabilité sous-maille de l'eau a été développé (Jam et al. 2011). Ces
nouvelles paramétrisations ont été développées en étroite interaction avec les groupes de modélisation à
méso-échelle du CNRM, et ont été évaluées sur la base de différentes campagnes d'observation
(BOMEX, ARM, ASTEX, RICO, etc) et d'observations spatiales. Ces développements ont permis
d'améliorer considérablement la couverture nuageuse basse du modèle LMD et du modèle couplé de
l'IPSL (Hourdin et al. 2011, Dufresne et al. 2011). La représentation réaliste par LMDZ des nuages de
couche limite dans le Pacifique Sud-Est a également été remarqué dans l'exercice d'intercomparaison
“preVOCA” (Wyant et al. 2010) de la campagne VOCALS.
2. L'évaluation des nuages simulés par les modèles de circulation générale à l'aide des
observations spatiales de l'A-Train. De gros efforts ont été déployés au laboratoire (i) pour
développer des simulateurs d'observations Calipso et Parasol permettant de comparer de façon
cohérente les observations spatiales de l'A-Train et les simulations des modèles climatiques (Chepfer et
al. 2008), et (ii) pour préparer un jeu d'observations CALIPSO-PARASOL totalement cohérent avec les
diagnostiques du simulateur (Chepfer et al. 2010). Les simulateurs développés au laboratoire ont été
intégrés à COSP (CFMIP Observations Simulator Package, Bodas-Salcedo et al. 2011), et l'utilisation
de COSP dans les simulations climatiques qui seront évaluées par le 5ème rapport du GIEC fait partie
des recommendations des projets internationaux CMIP5 (Meehl et Bony 2011) et CFMIP (Bony et al.
2011). Plus d'une vingtaine de groupes de modélisation (climat et météo) utilisent actuellement ces
simulateurs et les données spatiales associées. Notamment, les observations de l'A-Train ont été
intensément utilisées au laboratoire pour caractériser les nuages tropicaux (Konsta et al. 2011) et pour
évaluer ces nuages dans le modèle LMDZ (Konsta et al. en préparation, Hourdin et al. en préparation).
L'utilisation de ces données pour évaluer des aspects spécifiques des simulations CMIP5 tels que
l'influence de la structure verticale de la dynamique tropicale sur les effets radiatifs des nuages (Roehrig
et Bony en préparation) ou des processus critiques pour les rétroactions nuageuses en changement
climatique (post-doc de C. Nam) sont en cours.
3. L'étude de l'influence de l'organisation (à grande échelle et à méso-échelle) de la convection
profonde sur l'état thermodynamique de l'atmosphère tropicale. Par une analyse de longues séries
d'observations spatiales (géostationnaires et défilants) et le développement d'une méthodologie
originale de caractérisation de l'état d'agrégation de la convection profonde, nous avons montré que
pour une intensité convective donnée (caractérisée par exemple par le taux de précipitation sur un
domaine donné), l'humidité relative de la troposphère libre, les flux turbulents à la surface de l'océan et
les flux radiatifs au sommet de l'atmosphère et dans la troposphère étaient significativement et

robustement affectés par l'organisation à grande échelle et à méso-échelle de la convection (Tobin et al.
2011). De tels résultats avaient été suggérés par des simulations à méso-échelle, mais n'avaient encore
jamais été confirmés observationnellement. Nos résultats montrent de plus (et ce en désaccord avec les
simulations méso-échelle) que l'impact des changements d'organisation de la convection profonde sur le
bilan radiatif au sommet de l'atmosphère dépend fortement des changements de nuages peu profonds
(petits cumulus, congestus). Ce résultat est susceptible d'expliquer une partie des biais systématiques
des modèles climatiques dans les tropiques (étude en cours). L'étude des implications de ces résultats
pour l'interprétation des tendances à long-terme de la vapeur d'eau dans les tropiques est également en
cours.
4. La compréhension physique des mécanismes qui contrôlent la réponse des nuages de couche
limite lors d'un réchauffement global. Le modèle climatique de l'IPSL se caractérise depuis
longtemps par une forte rétroaction positive des nuages en changement climatique. Cette rétroaction
résulte en premier lieu de la diminution des nuages de couche limite à mesure que le climat se
réchauffe. A partir d'une analyse énergétique de l'atmosphère et en utilisant un large spectre de modèles
(couplé océan-atmosphère, atmosphérique, aqua-planète, 1D) nous avons mis en évidence deux
mécanismes robustes contribuant à la forte rétroaction positive des nuages bas dans le modèle de l'IPSL
: le principal est lié à la modification du gradient vertical d'énergie statique humide sous l'effet de la
relation thermodynamique de Clausius-Clapeyron et des changements de flux turbulents à la surface
des océans (Brient et Bony 2011) et le second est lié à la rétroaction positive entre humidité relative et
effet radiatif des nuages dans la troposphère (Brient et Bony, en préparation). Ce dernier mécanisme
implique une corrélation forte entre la simulation des nuages dans le climat présent et la réponse des
nuages en changement climatique. Ce travail ouvre de nombreuses perspectives vis-à-vis de
l'interprétation des différences de rétroactions nuageuses entre modèles climatiques, et des tests
observationnels qui pourraient être appliqués aux modèles pour évaluer certaines composantes de leurs
rétroactions nuageuses en changement climatique. Ces travaux se poursuivent dans la cadre de l'analyse
des simulations CMIP5.
5. L'interprétation de la réponse régionale des précipitations tropicales au réchauffement global.
Un cadre théorique et une méthodologie d'analyse ont été développés pour interpréter les changements
régionaux de vitesse verticale et de précipitation prédits par les modèles de circulation générale en
changement climatique. Appliqués aux différentes simulations CMIP5, à des simulations LMDZ
réalisées en mode “prévision du temps” ou à des simulations 1D réalisées dans “l'approximation des
faibles gradients de température”, ces travaux nous permettent de mieux comprendre les temps de
réponse et les structures spatiales des changements de précipitation tropicale sous l'effet des forçages
anthropiques. Notamment, ils nous permettent de quantifier et de comprendre physiquement la réponse
de la précipitation au forçage radiatif du CO2 d'une part, et aux changements de température de surface
d'autre part (Bony et al., in préparation). Ces résultats seront utilisés dans le cadre de l'analyse des
simulations multi-modèles CMIP5 pour interpréter les ressemblances et les différences de projections
régionales de la précipitation dans les Tropiques. Cela devrait nous permettre de mieux identifier la part
robuste de ces projections d'une part, et de mieux cerner l'origine des incertitudes d'autre part.
Soutien projets :
Ces travaux ont été réalisés en partie dans le cadre du projet européen FP7 EUCLIPSE (EU Cloud
Intercomparison, Process Studies and Evaluation, 2010-2014), du projet international CFMIP (Cloud
Feedback Model Intercomparison Project) et du projet LEFE DEPHY (Développement des

paramétrisations physiques). La thèse de F. Brient a été co-financée par le CNES et Météo-France.
Références citées :
Brient F and S Bony : Interpretation of the positive low-cloud feedback predicted by a climate
model under global warming. Climate Dynamics, in revision (Sept 2011).
Bodas-Salcedo, A., M. J. Webb, S. Bony, H. Chepfer, J.-L. Dufresne, S. A. Klein, Y. Zhang, R.
Marchand, J. M. Haynes, R. Pincus, and V. O. John, 2011 : COSP: satellite simulation software
for model assessment. Bull. Amer. Meteor. Soc., in press.
Bony S, M. Webb, C. Bretherton, S. Klein, P. Siebesma, G. Tselioudis and M. Zhang, 2011 :
CFMIP: Towards a better evaluation and understanding of clouds and cloud feedbacks in
CMIP5 models. CLIVAR Exchanges, Special Issue on the WCRP Coupled Model
Intercomparison Project – Phase 5 (CMIP5), pp 20-24, No. 56, Vol. 16, Issue No. 2, May 2011.
Chepfer, H., S. Bony, D. Winker, G. Cesana, J. L. Dufresne, P. Minnis, C. J. Stubenrauch, and S.
Zeng, 2010: The GCM-Oriented CALIPSO Cloud Product (CALIPSO-GOCCP), J. Geophys.
Res., 115, D00H16, doi:10.1029/2009JD012251.
Chepfer H, S Bony, D Winker, M Chiriaco, J-L Dufresne and G. Sèze, 2008: Use of CALIPSO
lidar observations to evaluate the cloudiness simulated by a climate model. Geophys. Res. Lett.,
35, L15704, doi:10.1029/2008GL034207.
Dufresne et al., 2011 ….papier IPSL-CM5
Hourdin et al., 2011 ….papier nouvelle physique
Jam A et al.: ….papier cld scheme
Konsta, D et al: ….papier A-Train
Meehl, G. A. and S. Bony, 2011 : Introduction to CMIP5.
CLIVAR Exchanges,
Special Issue on the WCRP Coupled Model Intercomparison Project – Phase 5
(CMIP5)
, pp 4-5, No. 56, Vol. 16, Issue No. 2, May 2011.
Rio, C. and F. Hourdin, 2008, A thermal plume model for the convective boundary layer :
Representation of cumulus clouds, J. Atmos. Sci. 65:407—425
Tobin I, S Bony and R Roca : Observational evidence for a systematic dependence of water
vapor, surface fluxes and radiation on the degree of aggregation of deep convection, J. Climate,
submitted (May 2011), in revision (Sept 2011).
Wyant, M. C., R. Wood, C. S. Bretherton, C. R. Mechoso, J. Bacmeister, M. A. Balmaseda, B.
Barrett, F. Codron, P. Earnshaw, J. Fast, C. Hannay, J. W. Kaiser, H. Kitagawa, S. A. Klein, M.
Köhler, J. Manganello, H.-L. Pan, F. Sun, S. Wang, and Y. Wang, 2010: The PreVOCA
experiment: modeling the lower troposphere in the Southeast Pacific. Atmos. Chem. Phys., 10,
4757-4774, doi:10.5194/acp-10-4757-2010.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%