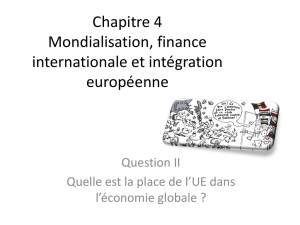Devoir de SES PREMIERE 2 heures

13/01/2011 – QSTP sur table en 3h – 1 ES 3
Travail préparatoire (11 points)
1. Quel est l’objectif de la Banque centrale européenne ? (document 1) - 1 point
2. Quel est l’effet d’une augmentation des taux d’intérêt sur la demande ? (document 1)- 2 points
3. Expliquez la phrase en gras (document 2) – 2 points
4. Faites une phrase donnant le sens de chacune des données soulignées (document 3) - 2 points
5. Faites une phrase avec chacune des données en italique (document 3) – 2 points
6. Montrez que les données du document 3 illustrent le passage souligné dans le document 2 ? - 2 points
Question de synthèse (10 points)
Après avoir montré que la politique monétaire actuellement menée par la banque centrale européenne
(BCE) peut stimuler la croissance, vous montrerez les limites de cette relation.
Document 1
La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales (SEBC) défini par le
traité de Maastricht. Depuis le 1er janvier 1999, l'objectif final est de garantir la stabilité des prix.
La stabilité des prix est définie comme une progression sur un an de l'indice des prix[…] inférieure à 2%
dans la zone euro. Pour atteindre ses objectifs, le SEBC dispose d'une série d'instruments de politique
monétaire, de fixation des taux directeurs notamment.
Ainsi en décembre 2005, la Banque centrale européenne annonce un relèvement d’un quart de point de ses
taux directeurs amenant le taux de refinancement à 2,25%. Elle explique que ce resserrement résulte des
risques accrus à moyen terme de reprise de l’inflation. Elle craint que les entreprises répercutent la hausse du
prix du pétrole dans les prix de leur biens et services d’une part, et que les salariés réclament des hausses de
salaires d’autre part.
D’après Banque de France/J.C Trichet/Euro système 2005
Document 2
Pourquoi faut-il lutter contre l’inflation ? Parce qu’elle provoque une perte de confiance dans la valeur de la
monnaie qui nuit à l’activité économique. […]. Alors que, dans la période antérieure, l’inflation permettait
d’améliorer les conditions de financement des entreprises et des ménages en allégeant le poids des
dettes, elle conduit désormais, à partir du début des années 80, les autorités monétaires à resserrer les
cordons du crédit afin de rassurer les marchés sur le maintient de la valeur de la monnaie. Investissement et
croissance en ont subi les conséquences et un vaste transfert de richesses s’est opéré au bénéfice des
créanciers. Aujourd’hui, le faible niveau atteint par le rythme de la hausse des prix rend inutiles les
politiques monétaires restrictives limitant l’accès au crédit afin de réduire l’inflation.
P. Frémeaux « Stabilité monétaire et croissance » Alternatives économiques, HS 3° trimestre 2000
Document 3
Taux d’intérêt réels, taux d’investissement des sociétés non financières et croissance économique en
France (en %)
En %
1979
1984
1993
1997
2000
2005
Taux d’intérêt réel à long
terme
- 0,1
5,6
5,1
4,5
3,6
1,5
Taux d’investissement
19,3
17,6
18,0
17,0
19,7
19,1
Taux de croissance du
PIB en volume
3,5
1,6
-1,1
2,2
4,0
1,2
Insee, comptes nationaux, 2006.

BONUS : Et parce que c’était Noël il y peu, un document supplémentaire pour vous aider :
En Alsace, début décembre, Saint Nicolas arrive dans les écoles pour distribuer friandises et récompenses aux bons
élèves. Mais il ne vient pas seul : le père Fouettard l’accompagne, et malheur aux mauvais élèves.
La Banque centrale, c’est Saint Nicolas et Père Fouettard réunis pour récompenser ou sanctionner les banques
commerciales. Elle ne distribue pas de cadeau mais de la monnaie centrale ou fiduciaire, ou encore de la liquidité, grâce
auxquelles les banques commerciales vont pouvoir faire face aux demandes de remboursement ou d’argents liquide des clients.
Evidemment, il ne faut pas rêver : on a beau être Saint Nicolas, ces billets et plus généralement cette monnaie Banque
centrale] ne sont pas gratuits, sinon tout le monde s’efforcerait de devenir banquier. Et de toutes façons, un banquier – même
central – qui fait dans le gratuit, c’est comme des poules avec des dents : ça n’existe pas. La Banque centrale cède ces liquidités
contre des titres à un certains prix, le taux d’intérêt du marché monétaire, dont le niveau va encourager ou freiner les banques
commerciales dans leur activité de crédit. Mais pour ces dernières, le fait de savoir que la Banque centrale leur prêtera de l’argent
en cas de difficultés et jouera, comme on dit, un rôle de « prêteur en dernier ressort » est quand même rassurant. Au font Saint
Nicolas distribue des airbags.
Quand à l’aspect père Fouettard, la Banque centrale vérifie que les banques commerciales respectent les règles de
prudence qu’elle impose (par exemple l’obligation de respecter un certain rapport entre les crédits qu’elles consentent et la
trésorerie qu’elles conservent).
Le maniement de ces règles et du taux d’intérêt monétaire (directeur) constitue ce que l’on appelle la politique monétaire
Denis Clerc, « Les mots de la monnaie », Alternatives économiques, hors-série, n°45, 3ème trimestre 2000.
N’oubliez pas de faire dans l’ordre :
- Au brouillon : Analyse de l’énoncé de la question de synthèse (que vais-je devoir prouver dans le
I. ? / dans le II. ?) – 5 à 10 minutes
- Au brouillon : Mettre dans un tableau à 2 colonnes (I./II.) toutes les connaissances personnelles
mobilisables danscesujet – 10 minutes
- Au propre : Faire le travail préparatoire à l’aide des documents et des connaissances perso – 45 à 50
minutes maxi
- Au brouillon : Pour chaque réponse (ou partie de réponse) du TP, déterminer si cela va constituer
un argument du I. ou du II. reprenez votre tableau à 2 colonnes – 10 minutes
- Au brouillon : Construire les sous-parties en triant et en classant l’ensemble des arguments présents
dans chaque colonne rédiger des titres clairs – 10 à 15 minutes
- Au brouillon : rédigez l’intro et la conclusion – 10 à 15 minutes
- Au propre : recopiez l’intro, la conclu et à partir du plan bâti au brouillon, rédigez votre synthèse
complète. – 1 heure. Pensez : * à annoncer ce que vous aller prouver
* à le prouver effectivement (chiffres, exemples, explications)
* à dire que vous l’avez prouvé.
- Relecture - 10 minutes
Bon courage !

Corrigé du TP
Q1 la BCE a pour objectif unique la lutte contre l’inflation c’est-à-dire contre l’augmentation continue et durable
du niveau général des prix. Elle se doit en effet de « garantir la stabilité des prix » afin de sauvegarder la valeur de la
monnaie. Dans la mesure où il est très difficile d’avoir une inflation zéro et qu’il est peu souhaitable que l’indice des
prix diminue (déflation), son objectif est alors de limiter à maximum 2% l’augmentation des prix sur un an.
∆ ! On vous demande quel est son objectif et non pas comment fait-elle pour l’atteindre (H-S) : faites attention à la
consigne !
Q2 une élévation des taux d’intérêts sur les crédits accordés aux agents économiques (ménages, entreprises,
association…) a pour effet de rendre plus cher les emprunts. Ainsi ils empruntent moins et revoient à la baisse leurs
projets d’investissement ou de consommation à crédit. L’investissement et la consommation étant des composantes de
la demande globale, on voit bien qu’une hausse des taux d’intérêt a un effet négatif sur la demande.
Par ailleurs, lorsque les taux d’intérêt sur les placements sont élevés, l’épargne est alors plus rémunératrice et les
agents économiques sont incités à épargner. L’épargne étant la partie du revenu qui n’est pas consommée (ménages)
ou la partie du profit qui n’est pas investie, des taux d’intérêt élevés ont donc bien encore une fois un effet négatif sur
la consommation, l’investissement et donc sur la demande du pays.
Q3 L’inflation « allège le poids des dettes » en diminuant le taux d’intérêt réel (celui-ci est égal au taux d’intérêt
nominal affiché par les banque auquel on soustrait le taux d’inflation : donc plus l’inflation est importante, plus le taux
d’intérêt réel diminue). Ainsi, en empruntant aujourd’hui pour consommer 100€ de B&S, à un taux nominal de 5 %, je
devrais rembourser 105 € dans 1 an. Et si pendant cette même année le prix des B&S augmente de 3 % alors j’aurai du
débourser 103 € pour acheter -sans crédit- ces mêmes B&S un an plus tard. Le fait de consommer à crédit ne m’a alors
réellement couté que 2 € (soit 2%). L‘inflation a donc bien alléger ma dette. L’endettement, c’est-à-dire le mode de
financement intermédié, étant moins couteux, les agents économiques peuvent emprunter davantage : « les conditions
de financement des entreprises et des ménages » sont donc bien améliorées grâce à l’inflation.
Q4 En France, en 1979, le taux d’intérêt réel était négatif : il s’élevait à - 0,1 %. Cela signifie que les agents
économiques « gagnaient » à s’endetter : en empruntant 100 € pour consommer aujourd’hui, ils n’auront à rembourser
réellement que 99,9 € à la fin de l’année, dans mesure où s’ils avaient attendu de disposer des fonds pour consommer,
les B&S auraient vu leurs prix augmenter de telle manière qu’ils se seraient enchéris davantage que le cout du crédit
(intérêts nominaux).
En France en 1984, à chaque fois qu’un agent économique empruntait 100 €, il devait réellement rembourser 105,6 €
un an plus tard.
∆ ! Compréhension de la consigne : « donner le sens d’une donnée » = « faire une phrase avec ce chiffre » : vous
devez donc citer explicitement le chiffre, mais de sorte que l’on comprenne ce qu’est un taux réel.
Q5 En 1979, sur 100 € de valeur ajoutée dégagée par les entreprises françaises, 19,3 étaient consacrés à
l’investissement. [En 1979, 19,3 % des richesses créées par les sociétés non financières françaises servait à acheter du
capital fixe.]
Au cours de l’année 1979, le PIB français en volume a cru de 3,5 %. [En 1979, la quantité de B&S produits a
augmenté de 3,5 % par rapport à l’année précédente.]
Q6En 1979, alors que les taux d’intérêt réels étaient au plus bas grâce à une inflation importante(-0,1%), on observe
que les entreprises investissaient massivement (19,3% de leur VA) et le PIB augmentait de manière significative
(3,5% de croissance annuelle). Mais à partir du début des années 1980, les autorités monétaires décident de lutter
contre l’inflation : automatiquement le taux d’intérêt réel remonte : il atteint 5,6% du capital emprunté en 1984. Ceci
augmente donc le coût des crédits et poussent les agents économiques à diminuer leur demande de crédit. Les
entreprises qui voient le financement de leurs investissements devenir de moins en moins avantageux réduisent alors
leurs achats de capital fixe : en 1984, elles ne consacrent plus que 17,6% de leur VA aux investissements (soit une
diminution de 8,8% depuis 1979). Parallèlement à cela, les ménages réduisent aussi leur consommation à crédit ce qui
diminue la demande de B&S adressée aux entreprises : celles-ci n’ont alors plus de raison d’augmenter leur
production, c’est pourquoi les richesses produites n’ont augmenté en 1984 que de 1,6%, une croissance 2,2 fois plus
faible que celle de l’année 1979. On le voit, l’investissement et la croissance ont visiblement subit les conséquences de
la lutte contre l’inflation (doc.2).

Corrigé de la QS
I. La politique monétaire de lutte contre l’inflation, menée par la BCE, peut stimuler la croissance
économique (symbole : ©). En économie, c’est le courant libéral qui défend cette position.
A) Lutte contre inflation =les prix augmentent peudonc il y a des chances que les revenus augmentent + que
les prix amélioration du pouvoir d’achat des ménages et donc stimule la demande et la P° ©
Constat chiffré possible : année 2000 (doc.3) où les taux d’intérêts réels sont élevés ce qui témoigne d’une
faible inflation, et où le PIB a augmenté de 4%
B) Lutte contre l’inflation baisse des coûts de P° des entreprises car :
Faibles prix des conso intermédiaires hausse de la VA donc du PIB = ©
Si faible inflation, faibles arguments pour réclamer des augmentations de salaires =
modération des prétentions salariales baisse de la part des salaires dans la VA hausse
des profits investissement hausse de la quantité et de la qualité de la P° ©
Faible inflation obtenue grace à des taux d’interets élevés incitation à épargner car la
rémunération est plus importante à long terme les entreprises se reconstituent une épargne
et peuvent donc s’autofinancer baisse du cout du financement hausse des
investissements ce qui constitue une demande de capital fixe auprès des autres entreprises
P° ©
Cf. tjs en 2000, investissement est aussi au rendez-vous cette année-là (19,7%)
C) Lutte contre l’inflation (davantage que les pays voisins)hausse de la compétitivité des entreprises
nationales hausse de la demande étrangère (extérieur) hausse de la P° = ©
II. Cependant, cette politique n’est pas systématiquement favorable à la croissance. Des arguments ici
plutôt d’inspiration keynésienne.
A) La lutte contre l’inflation peut ne pas être efficace pour relancer la croissance car d’autres acteurs
interviennent dans la relation « désinflation-croissance »:
La compétitivité ne tient pas qu’au prix : Si mauvaise compétitivité hors prix, la hausse de la
demande étrangère obtenue grâce à la lutte contre l’inflation ne sera pas au rdv donc la © non
plus
La compétitivité est une notion relative : Si les pays voisins lutte davantage que nous contre
l’inflation, nous subirons une baisse de notre compétitivité-prix baisse P° pas de ©
Si la hausse du pouvoir d’achat des ménages ne se traduit pas par une hausse de la conso mais
au contraire par une épargne de précaution pas de hausse de la dem ni de la P° pas ©
B) La politique monétaire de lutte contre l’inflation peut même avoir des effets néfastes sur la croissance :
pour freiner la hausse des prix, la BCE augmente ses taux d’intérêts (cf Cours). Or cette hausse a des effets
négatifs sr la demande globale (cf. Q2) et donc sur la ©
C) L’inflation comporte certains avantages qui stimulent la croissance :
l’inflation allège le poids des dettes (Q3 et Q4 pour les constats chiffrés) donc lutter contre
l’inflation hausse cout du crédit …. L’investissement comme la croissance en ont subi les
conséquences (cf. Q6 avec constats chiffrés)
A l’origine de l’inflation se trouve la création monétaire, favorable à la croissance : Crédit
accordés (sans épargne préalable) augmentation de la masse monétaire inflation. Or les
crédits servent à consommer ou investir hausse de la demande, de la P° = ©
1
/
4
100%