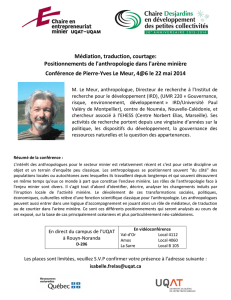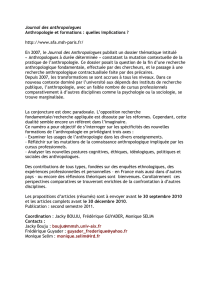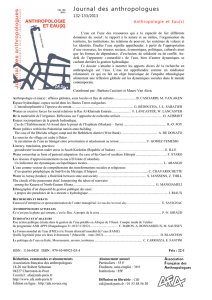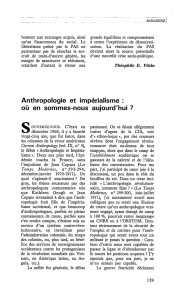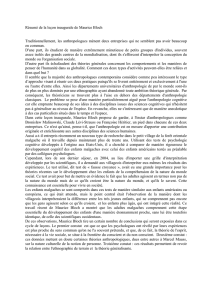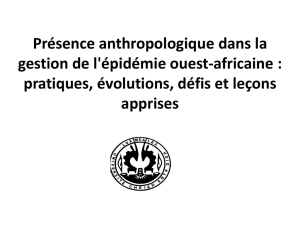Ethique et production du savoir anthropologique : quelques enjeux

1
À paraître in Singleton, M., Hermesse J., Ethique et implication en
anthropologie, Académia-Bruylant coll. "Anthropologie prospective",
Louvain-la-Neuve, 2011
Histoire de l’éthique en anthropologie : la production de la charte de l’American Anthropological
Association
Mathieu Hilgers,
Université Libre de Bruxelles
Si l’on devait retenir, de manière minimale, un principe moral central sur lequel repose l’anthropologie
sociale et culturelle, la plupart des professionnels évoquerait sans doute la reconnaissance d’une commune
humanité construite à partir de la connaissance de l’autre
1
. C’est d’autant plus évident que les grandes
étapes qui ont permis l’émergence de la discipline s’organisent de manière systématique autour d’un
questionnement lié à cette reconnaissance. L’exemple bien connu de la controverse de Valladolid est
particulièrement illustratif. En 1550, le dominicain Las Casas s’opposa au philosophe Sepulveda à propos
du statut à accorder aux indiens. Pour le premier, ceux-ci étaient dotés d’une âme et appartenaient donc
incontestablement au genre humain. Leur massacre par les autorités espagnoles était dès lors abject et
immoral. Pour le second, les indiens faisaient partie d’un peuple dont le statut naturel était de subir la
domination des civilisations supérieures. Derrière la question de savoir si les indiens ont une âme, c’est la
reconnaissance d’une commune humanité qui est en jeu. En affirmant que tout homme possède une
connaissance de la divinité, que chacun a le droit d’adorer son Dieu, que la manière d’adorer son Dieu
revient aux coutumes des peuples et que le Dieu vrai pour moi ne l’est pas nécessairement pour l’autre, Las
Casas pose les jalons du perspectivisme et du décentrement de soi comme condition de possibilité de la
(re)connaissance de l’autre (Todorov, 1982).
Par la suite, au fil de la progressive constitution de la discipline, de nombreux ouvrages et de nombreuses
polémiques ont discuté la question de l’hominisation, les stades de développement vers la réalisation d’une
humanité « pleine » et « authentique », la différence entre les races, leur existence ou non (pour un aperçu
Poliakov 1987 : 177-207, Kilani 1994). La question de la race a été largement battue en brèche, notamment
dans un texte fameux de Lévi-Strauss (1952), à partir d’un argument principal : les migrations et les
relations entre les peuples ont engendré une mixité qui suspend la possibilité même de parler de différentes
races humaines au sens biologique, ce qui distingue les hommes ce sont leurs cultures, leurs manières
d’appréhender le monde et de le pratiquer. Ce qu’il importe de retenir, c’est qu’au-delà de leur portée
scientifique, ces débats renvoient toujours à une question corolaire : comment traiter des individus et des
groupes avec qui nous partageons une commune humanité mais dont nous sommes distincts par une culture
radicalement autre ? Est-ce un devoir moral de hisser des peuples « barbares » à un état de « civilisation » ?
De laisser les peuples suivre leur développement endogène ? La volonté d’améliorer les conditions de vies
d’autres hommes et d’autres sociétés ou de leur laisser suivre leur développement « naturel » soulève aussi
bon nombre de questions. Les réponses apportées à ces interrogations renvoient à des croyances, des
visions du monde, des téléologies, des espérances qui demeurent intrinsèquement liées au projet même
d’une analyse anthropologique du monde et des cultures. Elles façonnent l’ethos professionnel des
communautés de recherches particulières. A mesure de la constitution de la discipline, des débats, et
notamment de l’expérience coloniale, du rôle ambigüe que jouèrent parfois les chercheurs, il fut nécessaire
de clarifier la position de l’anthropologue, son rapport au politique, les (pré)conceptions qui sous-tendent
son travail. Au-delà des préceptes méthodologiques inhérents à la pratique, de la reconnaissance du
caractère moral du fondement de l’anthropologie, l’objectivation des enjeux sociaux et politiques liés à son
exercice ont contraint les professionnels à discuter la possibilité d’élaborer une véritable éthique du métier.
1
Dans ce texte nous entendrons par le terme « morale » un ensemble de prescriptions admises à une époque
donnée, et plus précisément ici, dans une profession, en ce compris l’effort pour s’y conformer et exhorter à
les suivre, par le terme « éthique » la science qui apprécie le caractère bon ou mauvais de pratiques en
fonction des prescriptions de la morale et par le terme « déontologie » la théorie des devoirs professionnels.

2
En revenant sur les étapes qui permirent la constitution de cet espace de discussion, on verra que même si
les anthropologues fonctionnent en suivant une déontologie spontanée, fut-elle parfois idiosyncrasique ou
irrationnelle, il n’y eut à proprement parler d’éthique, c’est-à-dire de code de déontologie professionnel,
qu’à partir du moment où les principes implicites qui gouvernent les pratiques ont été défini et formalisé.
Ce n’est qu’à travers cette codification que la profession a pu passer d’un ethos à une véritable éthique du
métier, en d’autres termes, d’un ensemble de principes organisateur de pratiques et de représentations
partagées, non formalisé mais organisés de manière objectivement systématique sans pour autant être
objectivé, à un ensemble de normes codifiées. La codification du système de normes qui demeurait
jusqu’alors implicite dans la pratique a permis son objectivation et a rendu possible la mise en exergue des
écarts et des déviances. La formalisation de ces principes a ainsi facilité la mise en place de débats relatifs à
l’éthique du métier.
Dans ce texte on étudiera, la production de la principale charte éthique qui a redéfinit la pratique du métier
d’anthropologue. Elaborée au fil de la constitution de l’anthropologie comme discipline académique, cette
charte a suivi une trajectoire bien particulière. Alors que les relations entre anthropologie et colonisation
ont fait l’objet de nombreuses discussions dans les traditions françaises et britanniques, celles-ci n’ont pas
conduit à la formulation de codes de déontologies adoptés par les associations regroupant les professionnels
dans chacun de ces pays. C’est aux Etats-Unis que la réflexion a été poussée le plus loin, même si jusqu’à
ce jour, l’adhésion à la grande plus association anthropologique au monde, l’American Anthropological
Association (AAA) qui regroupe près de 11 000 membres, n’est toujours pas conditionnées par le respect
de sa charte éthique. L’importance de la charte de l’AAA dépasse largement les frontières nationales, en
effet, cette charte est généralement prise comme point de référence pour élaborer les codes éthiques dans
les associations de professionnels.
Au fil d’évènements, de discussions, de l’institutionnalisation et des crises qui ont marqué la discipline, les
questions ayant une visée proprement éthique, c’est-à-dire cherchant à renforcer l’usage et la cohérence
d’un code de déontologie professionnel, ont pris une importance croissante. La production du code éthique
de l’AAA est directement liée à la relation qu’entretient la discipline avec le monde social et plus
particulièrement avec le champ du pouvoir. Dans cet article, on reviendra sur les cinq principales étapes qui
ont conduit à la formulation de cette charte telle qu’on la connait aujourd’hui (Caplan 2003, Fluehr-Lobban
2003) :
1) l’institutionnalisation de la discipline
2) le soutien apporté par les anthropologues à l’Etat lors de la seconde guerre mondiale
3) les années de collaboration secrète
4) le projet Camelot
5) les récentes controverses autour du travail scientifique en Amazonie
Chacun de ces moments historiques pose à sa manière la question de l’autonomie scientifique, souligne
l’illusion de la neutralité axiologique et le caractère politique de toute prise de position éthique. Au terme
de ce parcours la question qui se pose est de donc savoir si la production d’une éthique ayant un degré de
généralité très élevé, comme le code de l’AAA, ne conduit pas nécessairement à établir des principes
abstraits et décontextualisés qui masquent, voir dépolitisent, la relation pourtant irréductible entre éthique et
politique et qui, de la sorte, manquent en partie à leur objectif.
Premier moment : fondation et crise
La constitution de l’anthropologie aux Etats-Unis est étroitement liée à la figure de Franz Boas. Fondateur
de l’American Folklore Association (1888), de l’American Anthropological Association et de l’American
Ethnological Association (1890), Boas était profondément impliqué dans la dynamique institutionnelle et
intellectuelle de la discipline. En 1919, il écrit une lettre intitulée « scientists as a spies » publié dans le
quotidien The Nation. Elle est connaitra un retentissement important dans la petite communauté des
anthropologues. Le texte de Boas était critique et sans concession, notamment envers le Président de
l’époque Woodrow Wilson :

3
« Un soldat dont l’activité est de pratiquer l’art de l’assassinat, un diplomate
dont la tâche est basée sur la tromperie et le secret, un politicien dont la vie
consiste à compromettre sa conscience ou un homme d’affaires dont le but
est de s’enrichir grâce aux limites de lois permissives; tous ceux-là peuvent
être excusés s’ils placent leur dévotion patriotique au-dessus de la vertu de
tous les jours et qu’en tant qu’espions, ils rendent alors service à la nation.
Ils ne font qu’accepter les codes moraux auxquels la société moderne
continue de se conformer. Il n’en est pas de même pour le scientifique. Car
le sens profond de sa vie est placé au cœur de la quête de vérité ».
Cette quête de vérité n’est pas compatible avec le mensonge et la tentative d’utiliser la couverture
scientifique pour mener des projets d’espionnage. Or, Boas accuse quatre chercheurs, qu’il ne nomme pas,
de « prostituer » l’anthropologie en l’utilisant pour camoufler leurs activités de renseignement. En agissant
de la sorte, ils ont, écrit-il, sali la réputation de la discipline mais aussi rendu extrêmement difficile la
pratique du métier en jetant la suspicion sur les intentions réelles, les pratique et les enquêtes des
anthropologues. Dix jour après la publication de cette lettre, lors de son congrès national le conseil de
l’AAA se dissocie officiellement de la position de Boas, le discrédite, le sanctionne pour avoir exprimé un
avis injustifié ne reflétant pas l’opinion de l’association et l’évince du conseil de celle-ci (Fluehr-Loban,
2003 : 3)
2
.
Cette réaction qui peut apparaître surprenante et radicale a été en partie motivée par des facteurs externes
au contenu même de l’article (rivalités, enjeux institutionnels, éventuel anti-sémitisme, Price 2000).
Néanmoins, le propos de Boas dérange profondément. A la tête de l’AAA, on estime que la publicité faite
autour de cette affaire d’espionnage peut nuire à la discipline et aux anthropologues qui sont sur le terrain.
On accuse Boas d’abuser de sa position à des fins politiques et nul ne cherche à vérifier le bien fondé de ces
accusations. A la suite de cette controverse et de l’éviction de Boas, les prises de positions les plus
progressistes sur des enjeux sociaux et politiques, comme ceux liés au racisme ou à la guerre, se prendront
hors de l’AAA, y compris par Boas lui-même.
Ainsi dès 1919, le débat sur la possibilité de concilier, ou non, anthropologie et patriotisme, autonomie
scientifique et engagement au service du politique est posé dans l’espace public. Cependant, l’AAA refuse
d’affronter pleinement les questions soulevées par Boas. Des analyses historiques ont pourtant prouvé la
pertinence de ses allégations. Elles permettent de mieux comprendre la portée et la signification de la
censure dont il fut victime
3
. La réaction du conseil de l’AAA constitue un message clair à la communauté
des anthropologues : il est légitime de faire de l’espionnage sous couvert de la science, ceux qui agissent
par devoir patriotique ne seront pas sanctionnés.
Bien que le débat ait été posé au début du siècle passé, jusqu’à aujourd’hui les relations entre science et
gouvernement et, plus généralement, entre science et politique n’ont pas été entièrement clarifiée. Les
débats ressurgissent de manière récurrente dans l’espace des discussions académiques. Les moments où
ceux-ci sont les plus intenses résultent sont généralement des moments charnières qui sont suivis par des
avancées éthiques.
Second moment : soutien à une guerre « juste »
Au cours des années 30, l’anthropologie s’institutionnalise. Le nombre d’étudiants augmente, les
débouchés s’élargissent, notamment dans des agences gouvernementales (affaires intérieures, affaires
indiennes, parcs nationaux, gestion des sols et de l’agriculture, musées tel que le National Museum).
2
Pour la petite histoire, trois des quatre anthropologues incriminés votèrent cette motion de censure,
Samuel Lothrop, Sylvanus Morley et Herbert Spinden. Le quatrième, Mason, écrivit à Boas une lettre où il
expliquait avoir agit en raison d’un devoir patriotique (Price : 2000), un argument qui sera mobilisé par la
suite de façon récurrente.
3
Il a notamment été montré que Lothrop a travaillé pour les services secrets américains pendant plusieurs
dizaines d’années lors de ces missions en Amérique latine et aux Caraïbes avant de reprendre ses fonctions
au Harvard Peabody Museum et à l’Institut Carnegie.

4
Hormis Kroeber, aucune figure de premier plan ne semble s’inquiéter des effets de ces conditions d’emploi
et de financement sur l’autonomie et la liberté scientifique. On se satisfait au contraire de la pénétration de
l’anthropologie dans le monde social à travers la multiplication des débouchés et la reconnaissance de la
fonction social des anthropologues.
Cette proximité entre la science et les institutions facilite la mobilisation des chercheurs en sciences
sociales lors de la seconde guerre mondiale. Suite aux appels du Comitee for National Moral, les
anthropologues sont encouragés à participer à l’effort de guerre en partageant leur connaissance des
peuples et des cultures avec les stratèges des Etats-majors militaires. C’est surtout au sein du Council for
Intercultural Relations que les anthropologues contribuent à une meilleure connaissance des peuples
ennemis et alliés. Ils le font notamment à travers la description des « caractères nationaux » de certains
pays étrangers. La célèbre étude intitulée « étudier la culture à distance » que Ruth Benedict consacre au
Japon est directement inscrite dans ce programme (Benedict 1998). A la demande de l’Office of War
Information, Benedict qui n'était jamais allée dans ce pays et en ignorait la langue, élabore un manuel pour
les forces d'occupation américaines. Elle donnera des conférences « top secrètes » sur le Japon pour le plus
haut niveau de l’état-major militaire américain au cours desquelles elle tente d’identifier les éléments
culturels contribuant à l'agressivité supposée des Japonais et les « faiblesses » de leur société. En général,
on estime qu’environ la moitié des anthropologues ont contribué à l’effort de guerre, en travaillant pour
l’armée, la navy ou les services secrets (Fluehr-Loban 2003, Caplan 2003).
Contrairement au scandale qu’avait suscité l’article de Boas, cette fois pas d’incident, de débats dans la
presse ou de critiques à propos de ces multiples collaborations. Le soutien à la guerre est unanimement
apprécié car il vise à éradiquer le fascisme et à libérer l’Europe de la domination des nazis. Pour autant
aucune réflexion collective n’est menée pour définir les conditions légitimes du soutien de la profession à
l’effort de guerre ou à la politique gouvernementale. L’effet pervers de cette participation est qu’elle permit
d’établir et de consolider des relations fortes entre les services secrets, les gouvernements et les
anthropologues. Les collaborations se poursuivent et, dans certains cas, se renforcent après la guerre au
point de devenir une nouvelle source de débat.
Troisième moment : les années d’après guerre et la guerre froide
La prolongation des pratiques de collaboration entamées dans la foulée de l’effort de guerre portera à
conséquence sur l’intégrité de la discipline. Au début des années 50, des accords secrets sont passés entre
l’AAA et la CIA. Les services secrets soutiennent indirectement l’obtention de financement pour certaines
recherches. L’AAA de son côté établi une liste exhaustive des anthropologues reprenant leur thématique de
recherches, leurs spécialités géographiques, culturelles et linguistiques. Cette liste mentionne les
anthropologues susceptibles de contribuer aux demandes explicites du gouvernement. D’autres recherches
seront financées à l’insu des chercheurs et contribueront indirectement à la récolte d’informations pour les
services secrets. Néanmoins, il convient de relativiser l’importance de cette collaboration. L’apport de
l’anthropologie américaine au service de renseignement s’apparente à la contribution de l’anthropologie
britannique lors de la période coloniale : elle constitue une aide appréciable au gouvernement mais qui
demeure relativement négligé par celui-ci.
Cette collaboration demeure cependant problématique, d’autant que l’accord passé entre la CIA et l’AAA
reste secret pendant près de 20 ans. Des anthropologues font de la recherche commanditée sans le savoir,
travaillent dans des groupes de recherches sans connaître la finalité réelle de leur travail, certains pratiquent
l’espionnage sous le couvert de leur activité scientifique et tous sont fichés par quelques uns de leur
collègues qui collaborent directement avec le gouvernement. Cette relation opaque se prolonge jusqu’en
1967, moment charnière à partir duquel s’enclenche une succession d’évènements et de crises qui vont
définitivement transformer l’éthique professionnelle et les implications politiques liées à la pratique de
l’anthropologie.
Quatrième moment : Le projet Camelot et la guerre du Vietnam
4
4
Cette section s’inspire directement de Fluehr-Loban 2003a pp. 6-10.

5
Le projet Camelot est généralement perçu comme le véritable déclencheur de la modernisation de l’éthique
professionnelle et de la responsabilité de l’anthropologue. La crise qui en résulte débouche, pendant la
guerre du Vietnam, sur la rédaction par le conseil de l’AAA du premier état (statement) de la recherche
anthropologique et de son éthique. Au-delà de l’anthropologie, le projet Camelot va profondément
bouleverser les sciences sociales américaines.
L’idée de ce projet a germé au Departement of the Army’s Office of the Chief of Research and
Development, et fut sous-traité par l’université de Washington DC. L’objectif est d’élucider les conditions
de création de conflits dans un espace national et les effets de l’action des gouvernements locaux concernés
sur ces conditions (apaisement, exacerbation ou annihilation des problèmes liés à ces conflits). Comme le
note Fluehr-Loban (2003a), le projet tente de définir les connaissances nécessaires pour renverser des
gouvernements et contrôler les insurrections possibles en Amérique latine. Il s’agit donc d’établir comment
le savoir produit par les sciences sociales peut contribuer aux ambitions militaires et impérialistes des États-
Unis, à la stabilisation de nouveaux gouvernements et au besoin à leur renversement dans un contexte où la
révolution cubaine pouvait avoir des effets potentiels sur les pays limitrophes. Bien que les principaux
chercheurs impliqués fussent sociologues ou psychologues, certains anthropologues ont également été
mêlés à cette recherche. Le projet fut rendu public suite à la publication d’un article de presse d’un
chercheur chilien engagé pour l’initier dans son pays. L’affaire fit un tel scandale que le projet Camelot ne
fut jamais mis en œuvre. L’implication réelle des anthropologues n’a donc pas été nécessaire pour relancer
les débats entre anthropologie, politique et coopération avec les autorités de l’Etat.
Dans les pays d’Amérique Latine, lorsque l’existence du projet Camelot fut connue, la réaction fut
épidermique. Au Pérou, par exemple, les anthropologues décidèrent de former leur propre association et
exigèrent que l’AAA les informe de tous les projets et financements des anthropologues américains sur le
territoire péruvien, ils enquêtèrent sur les effets du projet Camelot et reçurent en 1967 une copie du premier
statement de l’éthique des anthropologues.
Ce premier état de l’éthique de la recherche anthropologique, rédigé dans l’urgence pour répondre à la crise
qui frappait, poursuit de manière plus affirmée la première réaction de Boas. Cela s’avérait d’autant plus
nécessaire que cette même année, David Price découvre que depuis 1950 des anthropologues collaborent
avec la CIA, et qu’au Vietnam dès 1964 certains d’entre eux ont participé à des missions de propagandes et
de contre-propagande. Le statement souligne que des anthropologues qui ont prétendu faire de
l’anthropologie ont en réalité mené des actions qui avaient une autre fin, qu’ils ont nuit à la réputation de la
discipline et rendu l’exercice du métier difficile. Certains anthropologues ont utilisé leur position et le nom
d’institutions académiques pour faire de l’espionnage et même pour faciliter des opérations de
déstabilisation. Il est donc établit de manière claire que désormais tout anthropologue adhérant à l’AAA ne
pourra produire aucune connaissance qui pourrait nuire aux populations qu’il étudie et auxquels il doit
respect et dignité. Si un chercheur réalise une recherche commandité, il devra mettre ses compétences au
service de ses commanditaires en leur expliquant les enjeux de la démarche scientifique et en les avertissant
qu’il sera contraint d’arrêter son travail s’il craint de nuire aux populations qu’il étudie
5
.
Pourtant, quelques mois plus tard, en dépit de la formalisation d’une charte éthique, une annonce du
ministère de la défense pour faire de la recherche au Vietnam est publiée dans la revue American
Anthropologist et fait scandale
6
. La parution d’un appel d’offre pour soutenir le gouvernement au Vietnam
montre clairement que désormais les collaborations éventuelles entre gouvernement et anthropologues ne
sont plus secrètes. La transparence est devenue une exigence mais le débat sur la relation entre
anthropologie et pouvoir politique fait rage dans la profession. Les recherches à finalité secrètes sont
bannies mais l’appel à contribution du ministère de la défense pose d’autres problèmes. Certains
anthropologues estiment nécessaire d’identifier les applications potentielles du savoir produit pour une
recherche commandité. Cependant, les avis ne sont pas unanimes sur la définition de ce qui constitue une
application légitime du savoir anthropologique. C’est pour cette raison que lorsque l’année suivante, le
président du comité éthique de l’AAA diffuse des informations mettant en lumière les relations entre le
5
Voir Statement on Problems of Anthropological Research and Ethics 1967.
6
En réaction, l’année suivante, un panel du meeting de l’AAA prendra position contre la guerre du
Vietnam et condamnera l’usage des armes chimiques et napalm pendant les conflits armés.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%