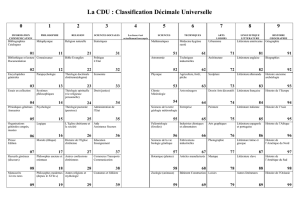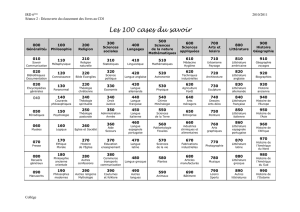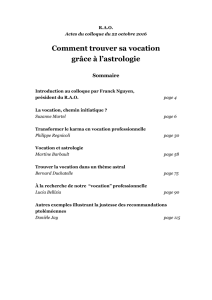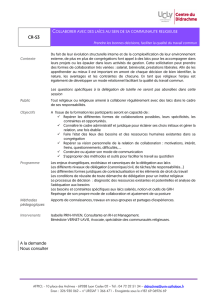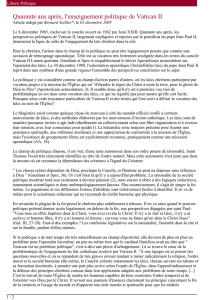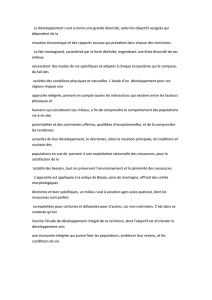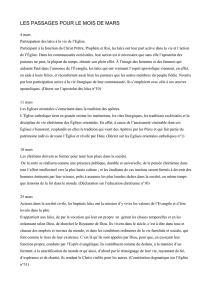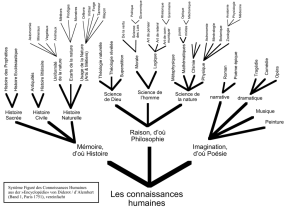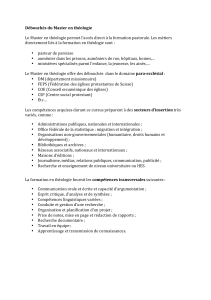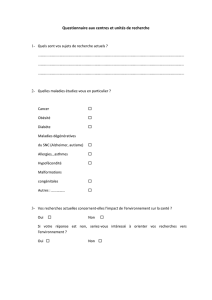L`existence chrétienne, une existence

Service National des Vocations - 106, rue du Bac - 75341 PARIS Cedex
Tél. 01 49 54 05 10 - Fax 01 45 48 48 70 - E-Mail : snv@cef.fr
THEOLOGIE
L'existence chrétienne, une existence " appelée " ?
par le Père Laurent Villemin,
professeur à l'Institut Catholique de Paris
"En quoi l'existence chrétienne peut-elle être dite une existence "appelée" ?" tel est l'intitulé
qui figure sur la dernière version du programme que vous avez entre les mains. Dans l'une des
versions précédentes, vous auriez pu lire : "En quoi la vie laïque peut-elle être dite une
existence "appelée"?" Le changement d'intitulé est, à mes yeux, révélateur des évolutions et,
d'une certaine manière, du flou qui marquent la théologie du laïcat. J'aimerais montrer qu'en
fonction de la théologie des laïcs que l'on développe, il s'en suit un usage particulier du terme
"vocation". Je procéderai en trois parties, correspondant aux trois modèles de théologie de la
mission des laïcs qu'il est d'usage de détecter au XXe siècle. Cette typologie développée par
les théologiens, notamment J.Grootaers [ 1 ] , emprunte sa structure à un exposé du cardinal
Feltin de 1950 sur un demi-siècle d'apostolat. On distingue trois périodes :
I. La période dite des "œuvres" ;
II. La période de la théologie du laïcat ;
III. La période qui va du concile Vatican II jusqu'à aujourd'hui.
Pour chacune de ces périodes, nous tenterons de définir brièvement la théologie des laïcs qui
domine et ensuite l'usage du terme "vocation" qui lui correspond. Toute typologie est
inévitablement réductrice, puisse-t-elle être suggestive !
I - La période des Œuvres
A - La théologie des laïcs en vigueur
Cette première période remonte au XIXe siècle. Quoique située dans une théologie très
cléricale, elle marque un incontestable réveil du laïcat. Qu'il suffise ici de citer quelques noms
comme Ozanam, Louis Veuillot, Montalembert, Léon Harmel... Le type d'activité de ces laïcs
est assez varié mais ces noms ne doivent pas occulter que, d'une manière générale, elle a pour
base ce qu'on appelle les "œuvres", c'est-à-dire des institutions de type traditionnel à base
paroissiale. La théologie des laïcs en vigueur considère que c'est la hiérarchie qui est
détentrice de la mission et que le laïc peut, dans le meilleur des cas, participer, collaborer à
cette mission. Il est un ministre instrumental de la hiérarchie. Cette théologie vise largement à
protéger l'Eglise des atteintes du siècle et à cultiver une contre-culture. Cette période est aussi
appelée celle de la "préservation" et de la "conservation".
B - La vocation
Deux éléments essentiels sont à relever ici.

Service National des Vocations - 106, rue du Bac - 75341 PARIS Cedex
Tél. 01 49 54 05 10 - Fax 01 45 48 48 70 - E-Mail : snv@cef.fr
Tout d'abord, avant cette période, l'existence chrétienne est déjà considérée comme appelée.
La désignation de toute vie chrétienne comme une existence appelée, comme une vocation,
précède en effet largement le XIXe siècle et le début du XXe. Dans son commentaire de
Matthieu 22, saint Thomas défendait déjà cette thèse en citant à l'appui Jean Chrysostome :
"Allez par les chemins... les chemins sont toutes les professions de ce monde, comme celles
de philosophe, de soldat, etc. Il dit "Allez par les chemins..." pour appeler à la foi les hommes
de toute condition [ 2 ]."
Et Y. Congar fait d'ailleurs remarquer : "Il est notable que ce sont surtout les religieux
prêcheurs, voire les spirituels et les mystiques, qui ont formulé l'idée de cette vocation, pour
chacun, dans sa condition, et de la sanctification dans le devoir d'état accompli "au nom de
Dieu", c'est-à-dire en obéissance aimante à sa sainte volonté. On trouve, en particulier, chez
Eckhart et chez Tauler, l'idée même que nous exposons : l'homme, lorsqu'il s'est converti à
Dieu, reçoit à nouveau de lui le monde, qui lui est rendu comme un devoir et un service.
Tauler parlait expressément ici d'appel ou vocation (ruof) de Dieu [ 3 ]." Il convenait de
rappeler ce fait majeur qui contraste avec l'emploi du terme "vocation" pour les laïcs au début
du XXe siècle.
Il est difficile de trouver à cet époque des textes où il est question de la vocation propre des
laïcs, ou même des emplois de la catégorie de vocation pour des non-prêtres ou des non-
religieux. Un dépouillement systématique de la Documentation catholique de 1919 à 1929
révèle que, dans les tables, il s'agit toujours de vocation sacerdotale et que les textes qui
traitent des laïcs ne parlent jamais de vocation.
Voici en revanche ce que l'on trouve en termes de mission des laïcs dans une lettre
quadragésimale de Mgr Landrieux, évêque de Dijon en 1920: "Les laïcs ont leur rôle dans la
paroisse. Autant il importe que le curé garde son rang, le premier, puisqu'il est pasteur du
bercail, chef de famille, autant il est sage d'y réserver aux fidèles la leur, avec confiance. Ils
doivent collaborer, coopérer comme membres de la communauté. (...) Nous aurions peut-être
quelque reproche à nous faire sur ce point. Nous n'avons pas toujours su les intéresser à nos
affaires ni leur faire comprendre que leurs intérêts religieux ne font qu'un avec les nôtres. (...)
Le curé gouverne perpétuellement, et les dévouements qui le secondent sont subordonnés,
comme en famille, filialement [ 4 ]."
D'une autre manière, dans cette conférence de l'abbé J. Leclercq, intitulée "Du rôle du prêtre
et du laïc dans les œuvres [ 5 ] ", on perçoit le caractère subordonné du laïc mais également
son intégration implicite dans une théologie de l'appel : "Etre prêtre, c'est une carrière, c'est
même plus qu'une carrière, c'est un état ; pour le prêtre, son sacerdoce correspond à ce qu'est
pour un laïc sa profession et son foyer." Ainsi donc, si on ne trouve pas de mention explicite
d'une vocation, il apparaît que l'existence laïque est déjà entendue comme une existence
appelée.
II - La période de la théologie du laïcat
A - La théologie des laïcs en vigueur
La seconde théologie des laïcs, qui mérite davantage le titre de théologie du laïcat, est celle
qui naît justement d'une réflexion théologique renouvelée dans les années 1950-19606 sous la

Service National des Vocations - 106, rue du Bac - 75341 PARIS Cedex
Tél. 01 49 54 05 10 - Fax 01 45 48 48 70 - E-Mail : snv@cef.fr
plume des grands artisans du concile Vatican II : Y. Congar, K. Rahner [ 7 ], Mgr Philips,
Mgr J. Leclercq et E.Schillebeeckx [ 8 ]. Cette théologie repose sur une division fondamentale
entre le monde et l'Eglise, l'ad extra et l'ad intra, voire entre le temporel et le spirituel. Au
risque de caricaturer, on peut dire que ces auteurs vont réserver l'Eglise, l'ad intra et le
spirituel, au clergé et le monde, l'ad extra et le temporel, aux laïcs. Cette théologie, dont on
perçoit davantage les limites a posteriori, a tout de même permis un acquis de taille en
attribuant au laïc une détermination positive : son domaine de prédilection est le monde. On
dépasse ainsi la description uniquement négative qui consiste à ne voir dans le laïc que le non-
clerc. Le laïc se trouve pleinement associé à la mission de l'Eglise, avec une détermination
particulière. Ainsi que le disait Y. Congar dans ses Jalons pour une théologie du laïcat : "Pour
le laïc, chrétiennement parlant, ce qu'il s'agit de référer à l'Absolu c'est la réalité même des
éléments de ce monde [ 9 ]." Cette bipolarité entre le monde et l'Eglise est nuancée et l'on
reconnaît qu'à l'intérieur de l'Eglise, le laïc peut être amené à une contribution active, mais
toujours en vertu de son insertion dans le temporel [ 10 ]. C'est cette théologie qui prévaut
dans l'Action Catholique et qui provoquera d'ailleurs la crise du mandat où se joue justement
la régulation entre la responsabilité de la hiérarchie et celle des laïcs dans la mission.
B - La vocation
Il est intéressant de remarquer que les Jalons pour une théologie du laïcat d'Y. Congar
possèdent huit pages explicitement consacrées à la "vocation". Ces pages s'attachent d'abord à
montrer que toute existence chrétienne est une existence appelée, avec le slogan suivant : "On
peut dire : tout est vocation comme Bernanos dit : "Tout est grâce" [ 11 ]." Et Congar de
poursuivre : "Tout homme a une vocation parce qu'il y a sur chacun une volonté de Dieu
ordonnée à la réalisation de ce dessein. Cette volonté peut se manifester d'une façon
particulière mais, à l'ordinaire, elle se traduit pour chacun dans les goûts qu'il tient de son
tempérament, de son éducation, dans les circonstances de sa vie, dans l'appel que,
expressément ou tacitement, lui adressent les autres hommes, etc. [ 12 ] "
Mais Y. Congar n'en reste pas là, il va développer une théorie de la vocation parfaitement
assortie à sa théologie du laïcat. Il distingue, en effet, l'ordre créationnel de l'ordre
vocationnel. L'ordre créationnel correspond pour lui aux onze premiers chapitres de la
Genèse, où Dieu se manifeste comme cause de toutes choses. Avec le chapitre 12 et
l'invitation de Dieu lancée à Abraham de sortir de son pays, commence l'ordre vocationnel,
"celui du propos de grâce dont l'histoire remplit l'Ecriture et qui se réalise aujourd'hui dans
l'Eglise [ 13 ]." Et notre auteur de poursuivre : "Il nous semble que cette distinction des deux
ordres a son application dans la question de la vocation et qu'elle est de nature à y apporter
une certaine lumière. On verrait ainsi une vocation au sens large, celle qui relève de l'ordre
créationnel et de la Providence générale de Dieu, puis une vocation au sens strict, ordonnée
proprement et directement à la réalisation du propos de grâce, relevant d'une intervention
spéciale de Dieu [ 14 ]." Congar ne dira jamais explicitement que l'ordre créationnel est du
ressort de la vocation de laïc et l'ordre vocationnel de celle du clerc, mais plus subtilement il
dit que "les vocations pour le service direct du propos de grâce" sont plus "impérieuses",
qu'elles sont "organisées socialement dans l'Eglise" et "constituent en un état sacré
particulier". Congar ne rejette pas le terme de "vocation" pour l'ordre créationnel, il se
réclame même "d'une conception très positive des vocations créationnelles du chrétien." Voilà
bien une théologie de la vocation totalement assortie à celle du laïcat. Y. Congar poursuit:
"On peut parler, comme on l'a fait, de fonction adamique de création et de fonction christique
de rédemption, à condition, d'abord, de bien marquer les liens de la première à la seconde, et

Service National des Vocations - 106, rue du Bac - 75341 PARIS Cedex
Tél. 01 49 54 05 10 - Fax 01 45 48 48 70 - E-Mail : snv@cef.fr
ensuite de ne pas les distribuer respectivement sur les laïcs et sur les clercs: car si les tâches
créationnelles ou la fonction adamique leur incombent plus spécialement, elles trouvent leur
sens final dans le Christ, et n'empêchent pas les laïcs d'avoir leur part dans la fonction de
rédemption et dans les tâches d'Eglise, comme nous pensons l'avoir montré [ 15 ]."
On ne peut ici discuter de la pertinence de cette distinction. Qu'il nous suffise de souligner
l'analogie de structure entre la théologie du laïcat et celle de la vocation. D'un côté, on trouve
une distinction entre l'Eglise et le monde et, de l'autre, entre l'ordre vocationnel et l'ordre
créationnel. Dans l'un comme dans l'autre, Y. Congar perçoit les risques qu'il y aurait à durcir
cette distinction jusqu'à en faire une séparation.
III - La période du concile Vatican II et ses suites
A - La théologie des laïcs en vigueur
Dès 1957, G. Philips [ 16 ] va élargir cette théologie qui aboutira au Concile. D'abord il inclut
le laïc dans la vocation générale partagée par tout chrétien, y compris les prêtres, qui consiste
à "témoigner d'une vie chrétienne intégrale" et, dans un second temps, il le caractérise par sa
spécification dans le domaine du temporel.
Mais le troisième type de théologie n'est qu'en germe avant le Concile. C'est de celui-ci qu'elle
jaillira, notamment de la constitution Lumen gentium, même si tous les documents du concile
intéressent naturellement les laïcs. Il faut bien reconnaître qu'à Vatican II la théologie du
laïcat connaît un éclatement sans précédent.
Le canoniste autrichien H. Heimerl [ 17 ] a proposé une typologie des différents concepts de
laïcs que l'on trouve dans le chapitre IV de Lumen gentium, typologie qui a été largement
reprise par d'autres commentateurs. Tout d'abord le concept ecclésial de laïc se construit sur
un élément générique qu'il partage avec tout chrétien : il est membre du Peuple de Dieu. On
retrouve cette base commune au début du n° 31 de LG : "Sous le nom de laïcs, on entend ici
l'ensemble des chrétiens qui (...) exercent pour leur part la mission qui est celle de tout le
peuple chrétien." A cette base générique viennent s'ajouter des éléments spécifiques qui
distinguent différents concepts du laïc.
Un concept de laïc négatif et "unipolaire" : le laïc est ici défini comme celui qui n'est
pas un clerc. Il est "unipolaire" car il ne s'oppose qu'à une seule catégorie
contrairement à celui qui suit.
Un concept de laïc négatif et "bipolaire" : le laïc est ici non seulement celui qui n'est
pas clerc, mais également pas religieux. On trouve aussi cette définition dans le début
du n° 31 de LG : "Sous le nom de laïcs, on entend ici l'ensemble des chrétiens qui ne
sont pas membres de l'ordre sacré et de l'état religieux sanctionné dans l'Eglise (...)."
Un concept positif essentiel : le laïc possède dans l'Eglise un rôle positif et actif. "A sa
manière le laïc collabore avec le sacerdoce officiel pour le culte commun de l'Eglise, il reçoit
les sacrements en y coopérant personnellement, il travaille en commun avec la hiérarchie qui
commande et dirige, à l'édification du corps du Christ [ 18 ]." On trouve cela dans le concile :
"Les pasteurs sacrés savent bien l'importance de la contribution des laïcs au bien de l'Eglise

Service National des Vocations - 106, rue du Bac - 75341 PARIS Cedex
Tél. 01 49 54 05 10 - Fax 01 45 48 48 70 - E-Mail : snv@cef.fr
entière (LG 30)."
Un concept positif existentiel : "Le caractère séculier est le caractère propre et particulier des
laïcs. (...) La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à
travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu (LG 31b)."
Même si cette typologie est discutable - et elle l'a été - H. Heimerl nous permet de découvrir
que le chapitre IV de Lumen Gentium ne comporte pas une théologie unifiée du laïcat. On y
trouve des traces de la vision reposant sur la bipolarité constitutive de la théologie des années
50-60 dans la ligne des Jalons de Congar mais également une amorce d'une nouvelle
théologie.
Nous notons également que le n°31 de Lumen Gentium ne propose pas une définition mais
une description du laïc. La Relatio, après avoir précisé que le concile n'entendait pas ici
dirimer des conflits d'écoles ou d'opinions, ajoute on ne peut plus clairement : "Ulterius
Concilium non proponit definitionem 'ontologicam' laici, sed potius descriptionem
'typologicam' [ 19 ]." Il convient donc de ne pas figer ce qui n'est qu'une description et de lui
garder son caractère existentiel, pour reprendre le mot de Heimerl [ 20 ].
La description de LG 31, pour ne pas porter en elle-même de contradiction, suppose un
changement de la relation de l'Eglise à la sécularité. Cette dernière ne peut plus être le
"dehors" de l'Eglise, il convient qu'elle soit intégrée dans une vision globale de la mission de
l'Eglise. Ce n'est plus l'opposition clerc-laïc qui est structurante mais l'intégration de tout
chrétien dans la mission de l'Eglise pour le monde.
B - La vocation
Les répercussions sur la manière de concevoir la vocation sont nettes. On va les trouver aussi
bien dans le concile Vatican II que dans l'exhortation apostolique post-synodale de Jean-Paul
II sur la "vocation et la mission des laïcs dans l'Eglise et dans le monde", Christifideles laici,
du 30 décembre 1988.
Il convient d'abord de remarquer ici une explosion dans l'emploi du terme "vocation". Il est
employé une quinzaine de fois dans Lumen gentium aussi bien pour désigner la vocation en
général, la vocation à la sainteté, la vocation sacrée, la vocation propre aux laïcs, la vocation
des époux. Dans Christifideles laici, il est employé soixante-quatorze fois avec la même
diversité d'acception. Pour ce qui est des termes "appel" et "appeler", on les trouve une
quarantaine de fois dans Lumen gentium et plus de quatre-vingt fois dans Christifideles laici.
a) Une vocation chrétienne en général
Il est question dans ces textes d'une vocation chrétienne en général qui correspond à la
définition générique du laïcat. La nouveauté chrétienne est le fondement et le titre de l'égalité
de tous ceux qui sont les baptisés dans le Christ, de tous les membres du Peuple de Dieu,
comme le rappelle Lumen gentium 32 : "Commune est la dignité des membres du fait de la
régénération dans le Christ; commune la grâce d'adoption filiale ; commune la vocation à la
perfection ; il n'y a qu'un salut, une espérance, une charité sans division." En vertu de cette
dignité baptismale commune, le fidèle laïc est co-responsable, avec tous les ministres
ordonnés et avec les religieux et les religieuses, de la mission de l'Eglise."
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%