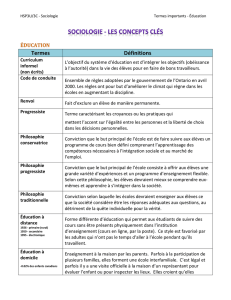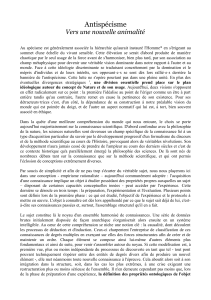Word - Christophe Chomant

Université de Rouen
UFR de sciences de l’éducation
Année 2002
THÈSE DE DOCTORAT
Discipline : sciences de l’éducation
présentée et soutenue par
Christophe CHOMANT
pendant l’année universitaire 2002-2003
Qu’est-ce qu’une école « juste » ?
Les éclairages de la neurobiologie cognitive et de l’histoire des idées
« d’égalité » scolaire, sur les champs de la réussite en classe, de la mobilité
sociale, de l’anthropologie des valeurs et croyances, et de la philosophie
politique
Directeur de recherche :
Monsieur le Professeur Jacques NATANSON

2
Remerciements
Je remercie vivement ici bien sûr en tout premier lieu Monsieur le Professeur Jacques
Natanson, directeur de recherche, qui a eu la patience d’attendre et accompagner un travail
initié depuis de nombreuses et longues années, et l’ouverture d’esprit et le courage d’accepter
en sciences de l’éducation un travail d’abord faisant appel à des notions de biologie, ensuite
faisant se rencontrer et se recouper plusieurs disciplines différentes.
Je remercie également Messieurs les professeurs Jean-Claude Forquin et Raymond
Boudon, qui m’ont éclairé par leur enseignement lumineux, passionné et passionnant, par
leurs ouvrages, et qui m’ont encouragé dans la poursuite de ces travaux.
Je remercie bien sûr les nombreux auteurs, d’Aristote à Rawls, en passant par Ruse et
Lieury, lus et utilisés pour ces travaux, généralement recensés dans les notes de recherche, et
qui ont permis de mener à bien ce travail.
Je remercie mon père, médecin et biologiste, nominaliste, matérialiste et humaniste en
diable, par ailleurs « déraciné social » et contradicteur vivant des thèses bourdieusiennes,
d’avoir sû me détourner de certaines dérives dualistes, holistes ou spéculatives qui hantent ici
et là le champ des sciences humaines.
Je remercie ma femme, pour son écoute, toujours curieuse et attentive, sa verve et sa
critique éclairantes et fructueuses, et ses encouragements dans les moments de fatigue.
Je remercie mes enfants d’avoir enduré avec beaucoup de stoïcisme et de philosophie les
longs mois et années passés par leur père sur un clavier d’ordinateur.
Je remercie enfin ceux, amis, parents, collègues, proches... que la place ici ne me
permettrait pas de citer tous.

3
Structure générale
Introduction 7
Table des matières
Introduction 7
Le sujet de recherche 7
La question de recherche 7
Mobiles du sujet 8
Clarifications épistémologiques sur la connotation politique du sujet de recherche 8
Un sujet brûlant 8
Une thèse scientifique ne doit conforter les opinions ni de « droite » ni de « gauche » 8
Pourquoi la neurobiologie ? 10
La neurobiologie, exclue des sciences de l’éducation 10
La neurobiologie clarifiant les débats politiques sur l’école 11
Le savoir précède la sagesse 12
Postures philosophiques, épistémologiques et méthodologiques 14
Le matérialisme 14
Le nominalisme 15
Les fondateurs du nominalisme : Guillaume d’Ockham et Max Stirner 17
L’empirisme 18
La sociologie de l’action 19
Un certain naturalisme 20
La « philosophie de l’esprit » 23
Un agnosticisme idéologique 23
Le non-dogmatisme 24
Le discernement de l’éthique et de la science, du « bien » et du « vrai » 25
Discernements et mélanges du « vrai » et du « bien » 25
Le non-finalisme 26
Un certain positivisme 28
Le positivisme logique du Cercle de Vienne 29
La philosophie analytique 30
L’anthropologie théorique de la connaissance 31
Le « post-modernisme » 31
Non-présupposés et non-affiliations 32
Plan et progression 32

4
« Des décennies de recherche en génétique ont (...) montré que les individus naissent avec des
patrimoines génétiques différents, ce qui explique la plupart des différences de capacité
intellectuelle entre individus. (…) Dame nature n’est pas équitable. Les individus ne sont pas
égaux quant à leur potentiel intellectuel. (…) Ce n’est (…) pas une surprise que le QI soit un bon
élément prédictif de la réussite scolaire, (…) que des différences d’aptitudes intellectuelles
amènent des inégalités sociales. (…) Il n’existe aucune ingénierie sociale qui puisse niveler les
différences de capacités intellectuelles entre individus. (…) Seule une approche plus réaliste des
différences intellectuelles entre individus permettrait à la société de mieux tenir compte de ces
différences et de réduire, si cela est possible, les inégalités qu’elles engendrent. »
Linda Gottfredson,
neurobiologiste
« Oui, on peut reconnaître la part de l’inné et faire droit aux découvertes de la génétique sans
nier la liberté et la responsabilité humaine. (...) Au lieu de dissimuler par tous les moyens ce qui
serait censé gêner l’égalitarisme démocratique, il vaudrait mieux, en effet, se donner la peine de
penser démocratiquement d’éventuelles inégalités. (...) La démocratie tient plus par la vérité,
quelle qu’elle soit, que par l’organisation de mensonges, fussent-ils pieux. (...) Ce qui est
démocratique, ce n’est pas l’affirmation dogmatique d’une égalité factuelle entre les hommes (...),
c’est le fait que cette inégalité, fût-elle avérée, ne se traduit pas par l’attribution a priori de
privilèges juridiques ou politiques, parce que la dignité de l’être humain est une donnée morale. »
Luc Ferry,
philosophe

5
Pour Jacques Natanson,
Raymond Boudon
et Jean-Claude Forquin,
professeurs qui ont marqué mon cursus.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%