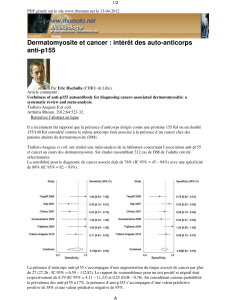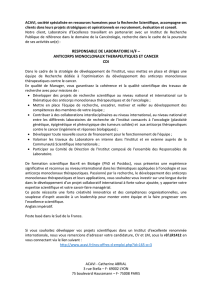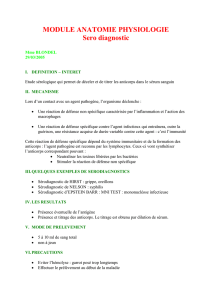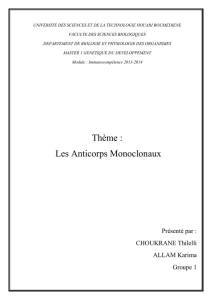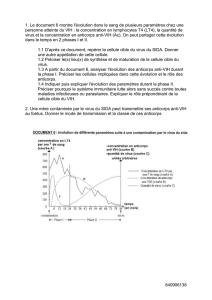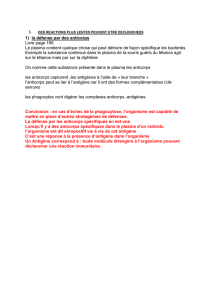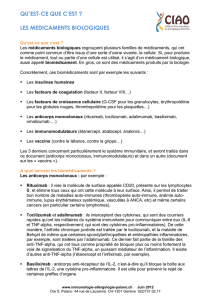II-Optimisation des anticorps thérapeutiques

Cibles et mécanismes d’action des anticorps thérapeutiques
et protéines de fusion
Hervé Watier
Jean-Michel Bidart, Olivier Lambotte, Hélène Moins-Tesserenc, Gilles Thibault,
I-Introduction ______________________________________________________________ 2
II-Optimisation des anticorps thérapeutiques ____________________________________ 2
III-Anticorps thérapeutiques neutralisants _______________________________________ 3
IV-Anticorps thérapeutiques antagonistes _______________________________________ 4
V-Anticorps thérapeutiques cytolytiques ________________________________________ 5
VI-Biomédicaments anti-TNF __________________________________________________ 7

I-Introduction
Dès 1891, l’emploi de sérum de chevaux immunisés a permis de développer l’utilisation
thérapeutique de ce qu’on ignorait encore être des anticorps. A cette époque commence la
sérothérapie anti-diphtérique, suivie, entre autres, de la sérothérapie anti-tétanique, anti-
pesteuse ou anti-méningococcique. La purification de la fraction immunoglobulinique permet
ensuite d’améliorer la tolérance de ces produits. Par la suite des fractionnements encore
plus précis ont été effectués, allant parfois jusqu’à la production de fragments Fab et F(ab)’2
à partir de sérum ou de plasma, et dès que possible le recours à des plasmas humains a été
développé. Ces préparations provenant d’individus (animaux ou humains) immunisés,
contiennent des anticorps de nombreuses spécificités. On parle de préparations d’anticorps
polyclonaux.
Dans les années 1970, Georges Kohler et César Milstein ont découvert la possibilité
d’immortaliser et de faire proliférer des clones de cellules produisant chacun un seul type
d’anticorps. Ces anticorps dits monoclonaux reconnaissent un seul épitope et leur
préparation utilise la technologie des hybridomes. Cette technologie, d’abord développée
chez la souris, a ensuite permis, grâce au génie génétique, de produire des anticorps
monoclonaux humanisés puis humains. Ces progrès ont révolutionné ce domaine
thérapeutique à partir de la fin des années 1990.
On parle pour ces anticorps, ainsi que pour les molécules apparentées appelées protéines
de fusion à Fc, de biomédicaments.
II-Optimisation des anticorps thérapeutiques
Les immunoglobulines sont des protéines, donc potentiellement immunogènes. Toute
administration de protéine thérapeutique comporte ainsi un risque d’immunogénicité. Celle-ci
dépend du biomédicament lui-même selon le degré de divergence épitopique entre la
protéine injectée et les protéines endogènes. Les conditions d’administration et le statut
immunitaire du patient influent également sur ce paramètre. La survenue d’anticorps anti-
biomédicament peut entraîner une diminution de son efficacité, par neutralisation et/ou
accélération de sa clairance. Par ailleurs, des réactions immunitaires indésirables peuvent
survenir. Il peut s’agir d’anaphylaxie (hypersensibilité de type I) ou de maladie sérique
(hypersensibilité de type III).
L’efficacité et la tolérance de la sérothérapie ont dans un premier temps été améliorées par
le remplacement des sérums de cheval par des préparations polyclonales issues de
volontaires vaccinés ou de convalescents.
L’échec relatif des anticorps monoclonaux thérapeutiques murins, dans les années 1980, lié
à leur immunogénicité, a ensuite poussé au développement d’anticorps monoclonaux rendus
plus humains grâce au génie génétique. Les différentes étapes de cette humanisation ont

conduit au remplacement progressif de la quasi-totalité des chaînes d’immunoglobulines
monoclonales murines par des structures humaines réduisant considérablement le potentiel
immunogène de ces biomédicaments. Les suffixes momab, ximab, mumab, zumab retracent
les progrès effectués dans la production respectivement d'anticorps monoclonaux murins,
chimériques, humanisés puis humains (Figure 1). A chaque progrès, la diminution de
l'immunogénicité de ces biomédicaments a augmenté leur durée d'action et leur efficacité in
vivo.
Cependant, quel que soit le degré d’humanisation, et même si l’anticorps dérive de gènes
d’immunoglobulines humains, l’idiotype reste issu d’une recombinaison génétique unique et
garde un certain potentiel d’immunogénicité. Autrement dit, tout anticorps humain reste
immunogène, ne serait-ce que par son idiotype.
Par ailleurs, dès l’utilisation d’anticorps monoclonaux murins modifiés pour posséder une
portion Fchumaine, la diminution de l’immunogénicité a été accompagnée de nouvelles
propriétés de ces biomédicaments. En effet, cette portion Fc entraîne une augmentation de
la demi-vie de l’anticorps par liaison aux récepteurs FcRn, et le recrutement d’effecteurs de
l’immunité par liaison au C1q et/ou aux récepteurs FcR des cellules cytotoxiques ou
phagocytaires. Ces propriétés pharmacologiques intéressantes sont également exploitées
dans toutes les protéines de fusion comportant un Fc humain. A noter que les médicaments
de ce type se terminent par le suffixe cept.
III-Anticorps thérapeutiques neutralisants
Si l’anticorps se lie à l’antigène avec suffisamment d’affinité et que l’épitope reconnu
concerne un site critique dans la fonction de l’antigène-cible, l’anticorps exerce une action de
neutralisation. Cette neutralisation concerne des cibles antigéniques solubles, comme des
toxines ou des cytokines, ou des virus ou des récepteurs de virus. Le biomédicament
empêche alors l’interaction entre ces molécules ou ces virus et leur cible cellulaire.
Les immunoglobulines anti-tétaniques, qui sont des IgG humaines polyclonales sont encore
largement utilisées pour la neutralisation de ces toxines microbiennes. Il existe également
une IgG1 monoclonale anti-toxine du bacille du charbon qui pourrait être utile en cas
d’attaque bioterroriste (raxibacumab).
En ce qui concerne la prévention des infections virales, il existe des préparations
polyclonales d’IgG humaines à teneur garantie en anticorps neutralisants anti-hépatite B ou
en anticorps anti-virus de la varicelle. Un anticorps monoclonal neutralisant, le palivizumab,
est dirigé contre la protéine F du virus respiratoire syncytial. Ces anticorps ont une visée
prophylactique, et il est donc important qu’ils aient une demi-vie longue, ce qui explique qu’il
s’agisse d’IgG entières.

L’activité de neutralisation des anticorps peut également être utilisée en situation d’urgence
comme antidote dans le cas d’envenimations, ou de surdosages en médicaments comme les
digitaliques. Ce sont des préparations polyclonales animales (cheval, mouton), fractionnées
et utilisées sous la forme de fragments Fab ou F(ab’)2 d’IgG.
Des anticorps monoclonaux ciblant et neutralisant des autoantigènes ont aussi été
développés. Un bon exemple est celui des anticorps dirigés contre le VEGF (Vascular
Endothelial Growth Factor). Ce sont des IgG1 entières monoclonales dans le bévacizumab
utilisé en cancérologie, tandis que le ranibizumab, utilisé en injections vitréennes dans la
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), est un fragment Fab. D’autres anticorps
monoclonaux recombinants neutralisant des cibles solubles sont actuellement utilisés
(Tableau 1).
IV-Anticorps thérapeutiques antagonistes
Cibler spécifiquement un récepteur membranaire, et bloquer la liaison de son ou de ses
ligands ou son fonctionnement, n’est devenu réellement possible qu’avec les anticorps
monoclonaux. Plusieurs biomédicaments ont reçu une autorisation de mise sur le marché et
sont utilisés en thérapeutique. Ils peuvent être regroupés en anticorps anti-récepteurs de
cytokines et anti-récepteurs de facteurs de croissance, anticorps anti-intégrines (molécules
d’adhésion, cf livre L2) et biomédicaments interférant avec les synapses immunologiques.
Il y a six anticorps anti-récepteurs de cytokines ou anti-récepteurs de facteurs de
croissance:
- deux anticorps IgG1 dirigés contre la chaîne de l’IL-2R (CD25), le basiliximab et le
daclizumab. Ces anticorps inhibent la prolifération lymphocytaire T et sont utilisés
comme immunosuppresseurs en transplantation
- une IgG1 dirigée contre la chaîne du récepteur de l’IL-6, le tocilizumab, limite les
phénomènes inflammatoires et est indiquée notamment dans la polyarthrite
rhumatoïde
- deux anticorps contre le récepteur de l’Epidermal Growth Factor (EGFR), une IgG1
(cétuximab) et une IgG2 (panitumumab) bloquent la croissance tumorale et sont
indiqués dans le traitement des adénocarcinomes coliques et, pour, le cétuximab,
des carcinomes épidermoïdes de la sphère ORL. Comme ils perturbent aussi la
physiologie de l’épiderme, ils entraînent des effets indésirables cutanés
- une IgG1 dirigée contre le récepteur HER-2 (erbB2), le trastuzumab, est indiqué dans
le traitement des tumeurs du sein et de l’estomac surexprimant cet oncogène.
On recense trois anticorps anti-intégrines:

- l’abciximab, un fragment Fab d’IgG1 anti-gpIIbIIIa (intégrine plaquettaire) qui bloque
l’agrégation plaquettaire et qui est utilisé ponctuellement dans les syndromes
coronariens aigus
- l’éfalizumab, une IgG1 anti-LFA-1 (anti-CD11a), qui bloque le trafic transendothélial
des lymphocytes T et réduit les infiltrats inflammatoires. Initialement indiqué dans le
psoriasis, il a été retiré du marché du fait de risques infectieux trop élevés
(leucoencéphalopathie multifocale progressive à virus JC)
- le natalizumab, une IgG4 anti-VLA-4 (CD49d), bloquant également le trafic
lymphocytaire, est indiqué dans la sclérose en plaques. Il comporte les mêmes
risques que l’éfalizumab mais le rapport bénéfice/risque élevé justifie sa prescription.
Enfin, quatre biomédicaments interférent avec les synapses immunologiques:
- l’alefacept est une protéine de fusion entre l’ectodomaine de LFA-3 (CD58) et le Fc
d’une IgG1. En se liant au CD2 des lymphocytes T, l’alefacept empêche l’interaction
CD2-LFA-3. Il est prescrit aux Etats-Unis (pas en Europe) dans le traitement du
psoriasis.
- l’abatacept est une protéine de fusion entre l’ectodomaine de CTLA4 (CD152), un
antigène lymphocytaire T apparenté à CD28 mais doué de propriétés
immunorégulatrices, et le Fc d’une IgG1. Il se lie aux molécules de costimulation
CD80 et CD86 des cellules présentatrices d’antigène avec une plus forte affinité que
CD28. De ce fait, il bloque le second signal et empêche l’activation des lymphocytes
T. Son activité immunosuppressive est mise à profit dans le traitement de la
polyarthrite rhumatoïde
- l’ipilimumab est à l’inverse une IgG1 anti-CTLA4 qui potentialise les réponses
lymphocytaires T. Il est utilisé dans le mélanome pour doper les réponses
immunitaires contre la tumeur, mais des effets indésirables de type auto-immuns sont
assez fréquemment observés
- le bélimumab est une IgG1 anti-BAFF (B-cell Activating Factor belonging to the TNF
Family ou CD257), une cytokine membranaire exprimée par divers types cellulaires et
activant les lymphocytes B par le biais de récepteurs spécifiques. Bloquant certaines
réponses humorales, le bélimumab est indiqué dans le lupus érythémateux
systémique.
V-Anticorps thérapeutiques cytolytiques
Dès lors qu’un anticorps se fixe sur un antigène membranaire, il peut avoir un effet
cytotoxique pour la cellule cible. Cet effet peut être recherché (effet désiré), comme dans le
cas d’une cible cancéreuse, ou non (effet indésirable). Les fragments Fab sont dépourvus
d’effet cytotoxique, il faut donc qu’un fragment Fc soit présent.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%