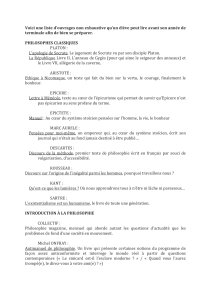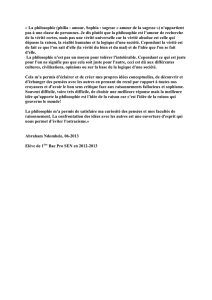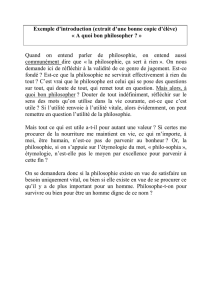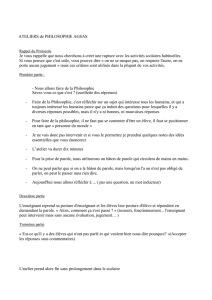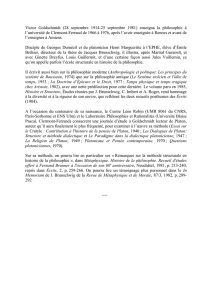La philosophie - Univ

La philosophie.
I. INTRODUCTION
A. Etymologie du mot "philosophie"
philo : aimer + sophie : sagesse = amour de la sagesse
réf. : Phèdre de Platon
Socrate dit : "Celui qui s'attache aux objets vrais et non pas aux apparences, il faut l'appeler
non pas sage mais ami de la sagesse."
Sagesse : avoir le souci de la mesure, le sens des limites, être maître de soi-même ? C'est une
vertu (raison, réflexion).
Le sage est celui qui possède le savoir, la vérité. Ces concepts sont proches de la perfection.
B. Définition de la philosophie.
L'homme ne peut que tendre vers la sagesse. La sagesse est une quête, un but. La
philosophie représente donc une attitude. La vérité est un objectif; ceux qui savent ont aussi
conscience de leur ignorance c'est à dire des limites de leur savoir.
Par exemple, en 1922, Jean Perrin commente la découverte de l'atome (est-il l'élément
le plus petit, ou est-il sécable en d'autres éléments ?). On a pris conscience de la relativité de
tout savoir. Les instruments de mesures ou d'étude changent à chaque époque.
Par exemple Socrate dit qu'il y a des gens qui pensent savoir, qui croient être dans le
vrai, alors que leur savoir n'est pas fondé. Dans la vie quotidienne, on se fie souvent à
l'opinion collective, à ses sens, aux idées reçues. Ce type de savoir immédiat est l'opinion.
Platon dans La république fait la distinction entre le philosophe, ami de la sagesse, et
le philodoxe, ami de l'opinion.
L'opinion est un savoir sans valeur, c'est une connaissance sensible. Par exemple, le
soleil tourne autour de la terre : c'est visible mais faux. Ou il y aurait des hommes supérieurs à
d'autres. Un tel jugement est faussé par un manque de valeurs et entraîne la xénophobie ou
l'ethnocentrisme. On se méfie spontanément de la différence (valeurs, langage, habitudes...).
Faire de la philosophie, c'est remettre en question les opinions qui sont en nous ou qui
ont cours dans la société. (Bergson affirme : "la société est aussi en nous"). Cela consiste à
douter de la valeur de ses connaissances c'est à dire à exercer son sens critique. L'opinion
correspond à des certitudes alors que la philosophie les transforme en problèmes. Faire de la
philosophie, c'est donc s'interroger. Alain dit : "Penser c'est dire non". L'homme de l'opinion
risque d'être esclave d'une religion, d'un parti politique, de l'idéologie dominante. En doutant
on gagne la liberté intellectuelle, on prend ses distances. Le but de la philosophie est de
libérer l'homme sur un plan intellectuel et aussi sur d'autres plans. Camus dans L'homme
révolté dit que l'esclave qui se révolte est celui qui dit non à l'autorité. Ce non est le premier
pas vers la liberté. Kant : "On n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher."
Philosopher c'est examiner tous les problèmes, réfléchir par soi-même.
Descartes dans Le discours dit avoir reçu une culture littéraire, historique,
mathématique, mais il décide de rejeter toutes ces connaissances. Il est donc sceptique. Mais
philosopher c'est aussi chercher à dépasser le scepticisme, c'est reconstruire. Par exemple,
Platon critique sa société mais il reconstruit une cité idéale; Rousseau critique la monarchie et
reconstruit la démocratie. Cependant, philosopher c'est aussi critiquer les philosophes, c'est
une démarche personnelle.

II. LES CRITIQUES ADRESSEES A LA PHILOSOPHIE.
A. La philosophie couperait les hommes de la réalité.
En effet, réfléchir c'est prendre du recul, prendre ses distances. Ce serait donc ne pas
agir, ne pas s'impliquer. Le philosophe se contenterait de contempler le monde. D'après Marx,
"les philosophes jusqu'à présent n'ont fait qu'interpréter le monde. Il s'agit maintenant de le
transformer". Pour lui, le monde c'est la société. Alors, quel est le mode d'action de la
philosophie, comment agit-elle ?
B. Philosophie et science.
On entend par science les mathématiques, la physique, la biologie, la psychologie, la
sociologie, l'économie, la linguistique, c'est à dire les sciences de la nature et les sciences
humaines. La science est une attitude intellectuelle qui ne se définit pas par ses objets. La
science vaut par ses applications. Qu'est-ce qui fait la valeur du savoir scientifique ? D'une
part, la science vaut en elle-même (en tant que savoir) parce qu'elle s'appuie sur des faits,
parce qu'elle vérifie ce qu'elle avance, qu'elle a le souci de la précision (elle utilise l'outil
mathématique). La science est une; c'est le modèle de la vérité. Elle permet de résoudre des
problèmes concrets, pratiques. Avec la technique on a un pouvoir sur le monde et sur les
hommes. La machine représente la libération de la pensée humaine. Avec la science on peut
aussi dominer les hommes (armes, augmentation de production et donc richesse,
conditionnement par les médias...). Ex. : Orwell 1984 : une société totalitaire où les hommes
sont surveillés par des machines. Huxley Le meilleur des mondes.
Une question se pose alors : la philosophie a-t-elle la même valeur ? Quelles sont les
difficultés ? On peut s'interroger sur les applications de la philosophie. Peut-elle résoudre des
problèmes ? Il existe une diversité de philosophies, les philosophes ne sont pas d'accord entre
eux. Par exemple, à la question "qui doit gouverner ?" Platon répond que ce sont les
intellectuels parce qu'ils savent, alors que Rousseau considère que ce doit être le peuple.
C. La philosophie a un caractère anachronique.
Par exemple, pourquoi s'intéresser à Platon, mort il y a vingt-trois siècles ? N'y a-t-il
pas des philosophies dépassées ?
III. JUSTIFICATION.
A. Philosophie et science.
S'il existe une diversité de philosophies, il ne s'agit pas d'un échec mais cela signifie que
certains problèmes restent posés et qu'il existe parfois une pluralité de réponses, de
perspectives. Il y a peut-être des vérités en dehors de la science.
Peut-on aborder tous les problèmes avec une attitude scientifique ? Tous les phénomènes ne
peuvent pas être appréhendés à l'aide d'une méthode scientifique. Par exemple, les
phénomènes de la pensée, les phénomènes psychologiques, ont une dimension subjective
qui n'est saisissable que de l'intérieur (la liberté, par exemple, est un concept). Une science
cherche à quantifier les phénomènes. Or peut-on tout traduire dans le langage
mathématique ? Par exemple, peut-on quantifier la liberté, la passion, l'angoisse...? La
science dit ce qui est; elle s'appuie sur des faits. La méthode expérimentale part des faits et

revient aux faits pour vérifier les hypothèses. Cependant, l'homme s'interroge aussi sur ce
qui devrait être. Par exemple, qu'est-ce qui a de la valeur ?
La science est une forme de pouvoir. C'est un instrument de libération des hommes mais aussi
une source de danger, d'aliénation (armes, applications de la biologie, destruction du
milieu...). La science ne suffit pas. Encore faut-il réfléchir sur ses applications. Avec la
science et la technique, on peut manipuler les hommes, les endoctriner, les priver de leur
liberté... La science ne nous fournit que des moyens mais il faut réfléchir sur les fins qu'on
cherche à atteindre avec ces moyens. Par exemple, à notre époque, un biologiste doit
savoir prendre ses distances par rapport à son savoir. La science et la technique ne sont
pas condamnables en elles-mêmes. C'est l'utilisation qui en est faite. Cela signifie que le
problème se situe en l'homme. Ce problème est celui de la violence. Il serait donc
nécessaire que les hommes fassent preuve de plus de sagesse.
B. La philosophie est-elle anachronique ?
Par exemple, Platon est-il dépassé ?
Les philosophes se posent les mêmes grands problèmes. Par exemple, dans l'antiquité,
on s'interroge sur la vérité, sur la justice, sur les valeurs... Ces questions continuent d'être
actuelles. Elles échappent au temps. Il y aurait un caractère éternel des questions
philosophiques. Toute réponse ou toute philosophie est liée à son époque, à un contexte
culturel mais la question posée échappe à l'époque, au temps. L'unité de la philosophie se
situe au niveau des problèmes posés par la philosophie.
C. Une démarche de l'homme.
D'après Jaspers, il se pourrait que la philosophie soit inutile. Cependant, elle reste une
démarche de l'homme. Il y a en effet en l'homme des forces qui le poussent à réfléchir.
1. Le négatif de l'existence.
Cela nous conduit à nous remettre en question, à prendre conscience de notre
condition. Par exemple, la solitude, la souffrance, la violence, la mort, la déception, l'échec...
nous conduisent à faire un retour sur nous-mêmes. Comme ces expériences sont faites par
tous les hommes, la philosophie devrait être une attitude universelle. Cependant, comme ces
problèmes sont pénibles à évoquer, et comme il n'y a pas toujours de solution, on préfère,
dans la vie quotidienne, vivre dans l'oubli de ces questions.
2. Le doute.
Quand on s'aperçoit que les connaissances que l'on a sont insuffisantes, on est amené à
les rejeter, à douter de leur valeur et à chercher un savoir vrai. Le doute est une expérience
intellectuelle. Il est à l'origine de la réflexion.
3. L'étonnement.
C'est la source psychologique de la réflexion. S'étonner consiste à questionner. Le
Théétète s'émerveille et questionne comme les enfants. "L'habitude est la mort de l'esprit"
(Alain).

IV. CONCLUSION.
Qu'est-ce que la philosophie ?
une remise en question
une réflexion sur les sciences = épistémologie (étude du savoir)
une réflexion sur l'action (politique, art, travail, valeur des buts de l'existence)
une réflexion sur les problèmes métaphysiques (sens de l'existence, liberté...).
La philosophie peut conduire à un comportement.
Le philosophe peut s'engager pour changer la société.
Illustration : Socrate et la philosophie (livre, page 41). Platon juge les valeurs de son
époque. Socrate, porte-parole de Platon, critique l'homme du commun qui ne cherche que
l'argent ou les plaisirs du corps ou les honneurs. Ici, le corps est privilégié. Au contraire pour
le philosophe qu'est Socrate, c'est l'âme qui fait l'humanité de l'homme. Grâce à elle on
distingue le bien du mal. Socrate possède un art d'interroger ses interlocuteurs, la maïeutique
(l'art d'accoucher les esprits). Socrate compare son travail à celui de sa mère qui était sage-
femme. Il aide son interlocuteur à découvrir la vérité qu'il porte en lui-même. Pour les Grecs,
la vérité est présente en tout homme mais elle est voilée.
1
/
4
100%