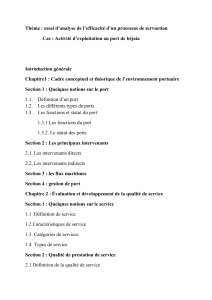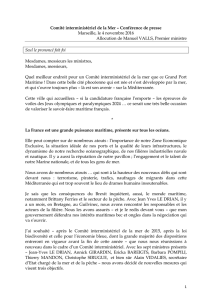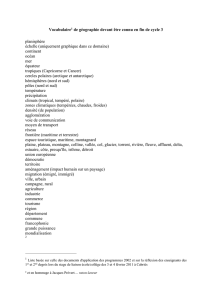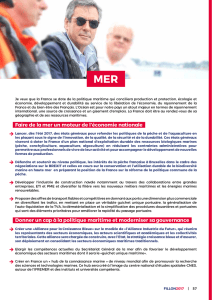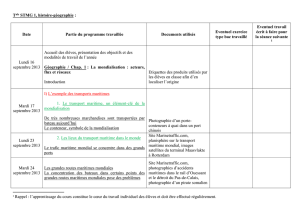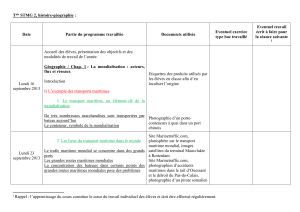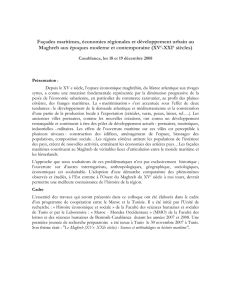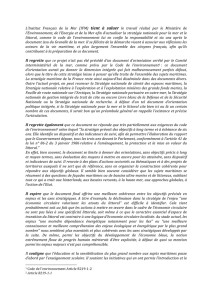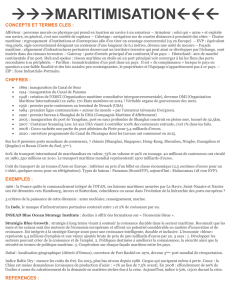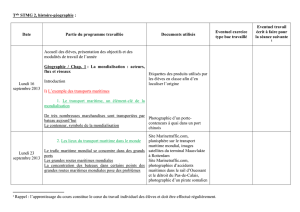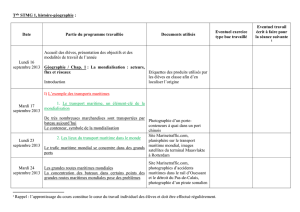[34] Brian Slack, Claude Comtois et Robert McCalla

O
Oc
cé
éa
an
ns
s
e
et
t
g
gl
lo
ob
ba
al
li
is
sa
at
ti
io
on
n
(
(d
de
ep
pu
ui
is
s
1
19
94
45
5)
)
Hubert Bonin, professeur d’histoire économique, Sciences Po Bordeaux et UMR CNRS 5113 GRETHA-
Université de Bordeaux [www.hubertbonin.com]
Ce chapitre synthétique ne peut que venir en complément des chapitres consacrés à des
aspects spécialisés et, parfois, ne manquera pas d’en dupliquer certains points, pourtant
utiles à nos analyses. Par « globalisation », nous entendons le déploiement mondialisé des
activités des acteurs de l’économie maritime, sur terre (ports, logisticiens, chargeurs) et sur
mer (armements maritimes, gestionnaires des flux), et la gestion des institutions publiques
et des firmes (publiques ou privées) à l’échelle internationalisée puis mondiale, donc au-
delà des simples intérêts nationaux des entreprises concernées. Un décideur globalisé
prend en considération les marchés et les flux mondiaux et gère l’entité dont il a la
responsabilité en fonction de ces données et des enjeux géo-économiques : il dispose
d’informations, d’une vision et de mentalités, d’objectifs stratégiques, d’un modèle
économique (business model) à l’échelle de cette mondialisation. C’est en cela que la
globalisation est bien plus large que l’internationalisation
1
; il faut évaluer comment
l’économie-monde maritime a évolué de l’internationalisation à la globalisation, en
fonction des mutations de l’environnement géopolitique, des systèmes productifs et des
technologies, ainsi que de la configuration du commerce mondial
2
.
1. Une internationalisation soumise aux aléas géopolitiques
Le transit maritime est contraint à une relative contraction de son extension internationale
à cause des retombées géopolitiques de la Seconde Guerre mondiale. Les ports chinois se
ferment, là où les compagnies maritimes participaient à l’économie des concessions. Le
Japon vaincu doit replier ses flux orientés vers son « aire asiatique de co-prospérité ». Le
démantèlement progressif des empires coloniaux sape parfois les bases des liaisons
privilégiées entre les métropoles et les colonies : entre les Pays-Bas et la nouvelle Indonésie
d’abord (1948), entre la France et l’Indochine (1954) ou entre le Royaume-Uni et l’Égypte
(1956), notamment ; mais, généralement, la force des relations commerciales fait prévaloir
ces flux classiques, pourtant dans le cadre dorénavant d’une certaine mise en concurrence
des prestataires maritimes. Le déploiement de la puissance américaine devient tel que les
flux reliant l’Amérique latine et les États-Unis deviennent prépondérants, au détriment de
la thalassocratie anglaise ; le transit par le canal de Panama en profite. La constitution
d’une vaste aire économique européenne contrôlée par l’URSS ne manque pas d’imposer
une recomposition dans la vie portuaire en mer Noire ou en mer Baltique et mer du Nord.
Les secousses du Proche-Orient ont perturbé ponctuellement les flux, que ce soit le sort
des oléoducs reliant l’Irak à la Méditerranée, les deux fermetures du canal de Suez
3
en
1956/57 et 1973/77, la guerre entre l’Irak et l’Iran, voire les deux Guerres du Golfe. Des
tactiques de blocus commercial et bancaire ont tenté de briser l’ouverture maritime de
l’Afrique du Sud, puis, récemment, de l’Iran.
1
Dennis Patrick McCarthy, International Economic Integration in Historical Perspective, Londres,
Routledge, 2006.
2
John McCusker (et alii, dir.), History of World Trade since 1450 (deux volumes), Farmington Hills (Mi.),
Thomson-Gale, 2006.
3
Hubert Bonin, History of the Suez Canal Company, 1858-1960. Between Controversy and Utility, Genève,
Droz, 2010. Caroline Piquet, Histoire du canal de Suez, Paris, Perrin, 2009.

2
2. La relance continuelle de l’insertion des économies
dans l’internationalisation
Cependant, sur le long terme, le mouvement d’internationalisation aura surmonté ces
obstacles récurrents, et l’histoire du commerce est d’abord celle de la recomposition
incessante de ses flux internationalisés. Il aura d’abord profité de la réinsertion successive
des pays « fermés » dans le système économique mondial. Cela fut le cas du Japon,
rapidement devenu l’une des locomotives de la croissance à partir du tournant des années
1960, avec ses énormes besoins en matières premières et hydrocarbures et ses amples
exportations – d’où la percée de ses compagnies de transport et transit à l’échelle
interocéanique. La Chine communiste a recouru habilement à la colonie britannique de
Hong Kong pour maintenir des flux orientés vers le monde capitaliste, surtout après la
rupture avec l’URSS en 1960 ; puis son retour au sein du système productif mondial depuis
les années 1980/90 a bouleversé la donne
4
, grâce aux importations de produits
manufacturés, de pétrole ou de minerais (Australie, Afrique) et au tsunami de ses
exportations de produits de consommation. Depuis les années 1960/80, les pays « sous-
développés » ont brisé le carcan colonial en diversifiant leurs ventes de produits de base et
leurs achats de produits manufacturés. Ceux d’entre eux qui sont devenus des « pays
émergents » ont rejoint les grands utilisateurs des services maritimes. La percée
déterminante de la façade Pacifique nord-américaine
5
(Long Beach/Los Angeles,
Oakland/San Francisco, Seattle, Vancouver) a stimulé les flux par le canal de Panama et les
importations d’Asie.
Les ports de toutes ces régions économiques ont dès lors accueilli massivement
hydrocarbures, denrées et minéraux destinés à nourrir cette croissance. L’économie
minière et celle des hydrocarbures
6
, sans cesse renouvelées sur tous les continents grâce à
l’exploitation de nouveaux gisements et au boum de la demande des pays en forte
croissance (Japon et, depuis les années 1990/2000, la Chine), ont stimulé la navigation
intercontinentale. Cela explique la conception de navires de grande dimension, de
pétroliers (tankers, puis supertankers
7
), soit en direct depuis les gisements, soit en relais
d’oléoducs ou gazoducs (à travers l’isthme de Suez, par exemple), de minéraliers géants
(capesize) et vraquiers, cargos aptes à répandre à travers le monde les produits semi-finis
(produits chimiques, ciment) élaborés dans les nouveaux pôles de production ou orientés
vers les pôles de consommation
8
.
Un immense phénomène de compensation commerciale entre les « sous-régions » du
système économique globalisé caractérise la troisième révolution industrielle
9
depuis le
4
Barry Eichengreen, Yung Chul Park & Charles Wyplosz, China, Asia, and the New World Economy, Oxford,
Oxford University Press, 2008.
5
James Flanigan, « Global trade, local industry », Smile Southern California, You’re the Center of the
Universe. The Economy and People of a Global Region, Stanford, Stanford General Books-Stanford
University Press, 2009.
6
Imperial Oil Limited, Sous le pavillon Esso: l’histoire des marins et des pétroliers de l’Impériale, 1899-
1980, Toronto, Compagnie pétrolière impériale, 1980. Esso Mariners: A History of Imperial Oil's Fleet
Operations from 1899-1980. James Bamberg, History of the British Petroleum Company, volume III :
British Petroleum and Global Oil, 1950-1975. The Challenge of Nationalism, Cambridge, Cambridge
University Press, 2000. Jan Luiten van Zanden, Joost Jonker, Stephen Howarth & Keetie Sluyterman, A
History of Royal Dutch Shell, Oxford University Press/Boom Uitgeverij, 2007. Steve LeVine, The Oil and the
Glory: The Pursuit of Empire and Fortune on the Caspian Sea, New York, Random House, 2007.
7
Raymond Solly, Tanker: The History and Development of Crude Oil Tankers, Londres, Chatham, 2007.
John Newton, A Century of Tankers. The Tanker Story, Oslo, Intertanken, 2002.
8
Michael Corkhill, Chemicals Tankers: The Ships and their Cargoes, Londres, Fairplay Publications, 1976.
9
Giovanni Dosi & Louis Galambos (dir.), The Third Industrial Revolution in Global Business, collection
« Comparative Perspectives in Business History », Cambridge, Cambridge University Press, 2013.

3
tournant des années 1980, dans le cadre d’un nouveau système productif mondial
10
. Les
firmes multinationales
11
puis transnationales
12
ont dessiné de vastes espaces de production
et d’échanges à l’échelle de grands groupes de pays : ils constituent de plus en plus des
nœuds de relations maritimes intégrés, reliant des pôles de production complémentaires,
entre lesquels circulent les composants et pièces à assembler en autant de flux
intermédiaires. La recomposition incessante de la division internationale du travail et des
processus de production au sein de chaque branche d’activité redessine souvent les routes
maritimes. L’essaimage de l’industrie automobile américaine (années 1950/70) puis
japonaise (depuis les années 1970) sur tous les continents a nourri des flux de voitures
achevées mais aussi de composants, tandis que les fabricants ont exporté des véhicules en
pièces détachées à assembler sur le lieu d’importation. Le transfert du raffinage du pétrole
au plus près des sites de production, depuis les années 1970/80, a suscité des inversions de
flux, en ajoutant au pétrole brut de plus en plus de produits raffinés (essence, gazole,
naphte, etc.), comme le prouve le transit par le canal de Suez. Mais la puissance du
raffinage et de la pétrochimie des États-Unis (sur le golfe du Mexique) nourrit de grosses
exportations vers l’Amérique latine, notamment le Mexique. Paradoxalement, le boum de
l’industrie aéronautique suscite des flux maritimes pour le transport de pièces et blocs
d’avions, de moteurs et d’équipements intérieurs entre les diverses usines spécialisées dans
l’élaboration de tel ou tel bloc (comme au sein d’Airbus en Europe, ou, pour Boeing, entre
le Japon et les États-Unis).
Le remodelage des processus productifs s’intensifie avec la troisième révolution
industrielle. Le « toyotisme » (théorisé par William Edwards Deming) prône le « zéro
stock » et le « juste à temps », une externalisation maximale des composants auprès des
équipementiers et sous-ensembliers, d’où l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement
(supply chain management) au nom du « sans délai » et de la « flexibilité » dans la chaîne
logistique maritime, puis des ports aux zones d’entreposage et de production
13
, en monde
d’industries et de services intégré
14
, parfois qualifié de « post-industriel »
15
, où les secteurs
secondaire et tertiaire sont en osmose. Or nombre d’usines ne se contentent plus de vendre
dans leur aire de proximité puisqu’elles sont des pivots d’une diffusion transocéane,
insérées dans un mouvement d’échanges intercontinentaux de produits, sans plus de
rapport avec le pays d’origine de la marque : des modèles BMW fabriqués aux États-Unis
sont exportés dans le monde entier ; les usines britanniques Nissan font embarquer les 4/5
de leur production vers des outre-mers ; les usines de Toyota à Valenciennes (France) et en
Tchéquie envoient leurs voitures sur Zeebrugge pour rejoindre Halifax (Canada), Porto
Rico, New York, Jacksonville (Floride) et Long Beach (par Panama)
16
.
La Chine
17
, bien sûr, l’Asie du Sud-Est, avec une compétition interne pour attirer telle ou
telle spécialité manufacturière, Singapour
18
et Hong Kong (et ses zones franches), et le
10
Robert Boyer & Michel Freyssenet, The Productive Models. The Conditions of Profitability, Londres & New
York, Palgrave-McMillan, 2002.
11
Geoffrey Jones, Multinationals and Global Capitalism: From the Nineteenth to the Twenty-First Century,
Oxford, Oxford University Press, 2005.
12
John Dunning, Multinational Enterprises and the Global Economy, Wokingham, Addison-Wesley, 1992.
John Dunning, The Globalization of Business, Londres, Routledge, 1993.
13
Paul Larson & Arni Halldorsson, « Logistics versus supply chain management: An international survey »,
International Journal of Logistics: Research & Application, 2004, volume 7, n°1, pp. 17-31.
14
Thomas Friedman, The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century, 2005.
15
Daniel Cohen, Trois leçons sur la société post-industrielle, Paris, La République des idées/Seuil, 2006.
16
Olivier Cognasse, « Logistique. Toyota envoie son made in France à l’Oncle Sam », L’Usine nouvelle, 16 mai
2013, pp. 32-33.
17
Barry Eichengreen, Yung Chul Park & Charles Wyplosz, China, Asia, and the New World Economy,
Oxford, Oxford University Press, 2008.

4
Japon constituent ce que F. Gipouloux appelle « la Méditerranée asiatique »
19
; et le trafic
intra-asiatique constitue en soi un système maritime ample
20
. Le Moyen Orient, avec ses
émirats et royaumes, la Turquie et ses « marches » en Asie centrale et caucasienne,
diverses façades latino-américaines ou nord-américaines, le Maghreb, sont aussi essentiels
à la globalisation que les sous-ensembles européens. Cet entrecroisement des mini-
systèmes de production avec l’animation d’une économie de marché globalisée a déclenché
la révolution d’une intensification des échanges maritimes (et aériens), un nouveau mode
de gestion du transport et de logistique et des firmes d’armement maritime.
3. Vers la globalisation de la gestion du commerce
L’économie maritime a longtemps reposé sur des maisons de négoce, souvent familiales,
ancrées dans leur pays d’origine et en liaison avec un petit nombre de ports, de chargeurs
et de sociétés publiques (pays communistes, puis aussi pays du Tiers-Monde socialisants)
ou privées d’exportation de denrées ou de minéraux. Une révolution a entraîné ce secteur à
partir des années 1970 : la taille géographique, quantitative et financière des marchés est
devenue telle que nombre de négociants ont disparu ou ont dû fusionner. De grands
groupes ont émergé, en Occident, au Japon, puis en Russie et en Chine
21
: Archer Daniels
Midland-ADM (USA), Bunge (Argentine), Cargill (USA), Glencore (Suisse), Louis Dreyfus
Commodities (France) – avec 230 000 salariés à eux cinq en 2013 –, Marubeni (Japon),
etc. Ces acteurs (depuis Genève ou Chicago, pour beaucoup) de la globalisation de
l’économie de marché exercent une influence certaine sur la vie des flux maritimes. Les
Bourses de denrées (Chicago, New York, Londres, etc., avec leurs marchés à terme) et leurs
courtiers (traders) et, tout en amont de la chaîne, le financement du négoce (trade
finance) par les firmes bancaires déterminent la vie des flux maritimes tout en aval, au sein
d’une économie globalisée.
Aussi imposant soit-il techniquement, chaque cargo est un pion sur la carte du négoce
mondial. Le jeu des cours détermine plus ou moins le rythme des échanges internationaux,
selon le prix du fret au jour le jour (« prix spot »). Nombre de navires sont réorientés en
cours de navigation vers tel ou tel port en fonction de l’évolution soudaine de la demande
et des prix. Cargill affrète 500 navires en 2012, puisque les négociants supervisent toute la
chaîne logistique, quasiment du silo de collecte au silo du port de destination. Et certaines
possèdent une filiale de vraquiers et cargos, comme Louis Dreyfus Armateurs
22
, qui, en
18
Hafiz Mirza, Multinationals and the Growth of the Singapore Economy, Beckenham, Crown Helm, 1986.
Rajeswary Ampalavanar Brown, Capital and Entrepreneurship in Southeast Asia, Londres, McMillan, 1994.
Gregg Huff, The Economic Growth of Singapore: Trading Development in the 20th Century, Cambridge,
Cambridge University Press, 1997. Donald Freeman, The Straits of Malacca: Gateway or Gauntlet?,
Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2003.
19
François Gipouloux, La Méditerranée asiatique. Villes portuaires et réseaux marchands en Chine, au
Japon et en Asie du Sud-Est, XVIe-XXIe siècles, Paris, CNRS Éditions, 2009.
20
François Gipouloux, Gateways to Globalisation: Asia’s International Trading and Finance Centres,
Cheltenham, Elgar, 2011. Stephen Roach, The Next Asia. Opportunities and Challenges for a New
Globalisation, Hoboken (New Jersey), John Wiley & Sons, 2010. Andre Gunder Frank, Re-Orient: Global
Economy in the Asian Age, Berkeley, University of California Press, 1998.
21
Jacob Price, Overseas Trade and Traders, Aldershot, Variorum, 1996. Stephanie Jones, Two Centuries of
Overseas Trading, Londres, MacMillan, 1986. Geoffrey Jones, The Multinational Traders, Londres,
Routledge, 1998. Geoffrey Jones. Merchants to Multinationals: British Trading Companies in the
Nineteenth and Twentieth Centuries, Oxford, Oxford University Press, 2000 & 2004. Sinichi Yonekawa
(dir.), General Trading Compagnies: A Comparative and Historical Study, Tokyo, United Nations
University press, 1990. Philippe Chalmin, Négociants et chargeurs. La saga du négoce international des
matières premières, Paris, Économica, 1985.
22
Sabine Delanglade, « Le voyage au long cours de Louis Dreyfus », Les Échos, 5 septembre 2013, p.12.
Antoine Boudet, « Louis Dreyfus Armateurs prêt à prendre de nouveaux paris », Les Échos, 17 octobre 2013,
p. 16.

5
2012, possède une soixantaine de navires et en affrète une seconde soixantaine. Parfois,
ces maisons gèrent en sus des entrepôts et des ports de transit des pondéreux, comme
GrainCorp (gestionnaire en 2013 de sept des huit ports céréaliers de la côte Est de
l’Australie).
4. Vers la globalisation du transit maritime
Plusieurs étapes ont marqué l’intensification du transit maritime. Le bloc de compétences
classique a prospéré pendant les Trente Glorieuses, dans les années 1945-1975 : courtiers
maritimes, spécialistes du transit au sein des chargeurs, multiples transitaires dans les
anciens empires coloniaux et les ports métropolitains, consignataires, etc. Tous ont
accompagné l’expansion commerciale à l’échelle du monde capitaliste et notamment les
flux concernant les États-Unis, l’Europe de l’Ouest, avec ses sites portuaires modernisés
(équipement des quais en grues, entrepôts frigorifiés, nœuds ferroviaires, grandes zones et
entrepôts pour le fret routier), puis aussi le Japon.
Depuis les années 1980, la performance du système toyotiste repose sur l’efficacité de la
chaîne logistique, des lieux de production aux lieux de stockage et de redistribution, pour
la masse des produits élaborés dans les sous-régions à bon prix de main-d’oeuvre. Depuis
le tournant du XXIe siècle, la filière logistique est devenue l’axe majeur de la révolution
commerciale causée par le système Internet. Malgré la concurrence des « intégrateurs »
utilisant le fret aérien puis le transport routier, l’alimentation en amont des énormes
entrepôts gérant les flux à l’échelle d’une sous-région globalisée s’effectue massivement par
mer (produits électroniques et électroménagers, habillement ; jouets du groupe Mattel,
avec un entrepôt à Marseille-Fos pour toute l’Europe du Sud, réceptionnant 3 000
conteneurs en 2012). L’exigence du transport multimodal s’impose de ou vers l’hinterland,
dans le cadre d’une gestion verticale intégrée : des câbles d’acier Arcelormittal quittent
l’usine de Bourg-en-Bresse par route, puis joignent Marseille-Fos sur la Saône et le Rhône
par barges, puis Shenzhen en Chine par cargo, sous l’égide du commissionnaire de
transport Geodis-Wilson
23
.
La filière logisticienne s’érige en levier de la troisième révolution industrielle de l’amont à
l’aval (transport, entreposage, transit/freight forwarding). Cela explique le processus
d’intégration au sein de groupes transnationaux, comme la Suisse Panalpina, passée
depuis 1954 des flux rhénans à la mondialisation (15 000 salariés en 2007, avec 500
agences en direct dans 90 pays). La Française SDV-Bolloré, qui a réuni SCAC, SAGA et
Transcap dans les années 1990, traite 700 000 conteneurs par an au tournant des années
2010 : elle est spécialiste du transit Nord-Sud (entre l’Europe et l’Afrique), face aux
concurrents nord-américains et asiatiques orientés le Nord-Nord (entre pays développés
de tous continents), tandis qu’a percé le Sud-Sud (de l’Asie ou du Brésil émergents vers les
pays en voie développement). Plusieurs grands armements maritimes disposent d’une
maison sœur de logistique, dans une stratégie d’intégration verticale (comme Mitsui-MOL
ou Maersk). Des intermédiaires spécialisés résistent : les Bourses de fret traitent les appels
d’offres des chargeurs. Ils proposent à ces derniers, devenus adeptes de l’externalisation
dans les années 1980/90 – en perdant une partie de leur savoir-faire historique –, une
gestion complète (total solutions providers grâce à des progiciels de gestion et
d’optimisation du transport) du processus de transport de port à port et également en-deçà
ou au-delà pour le transport terrestre (avec des licences de non vessel operating common
carriers). La supervision de tels systèmes de flux justifie l’assimilation de la gestion
numérisée du suivi des marchandises et conteneurs.
23
Olivier Cognasse, « Le voyage au long cours des câbles d’Arcelormittal », L’Usine nouvelle, 31 octobre
2013, p. 42.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%