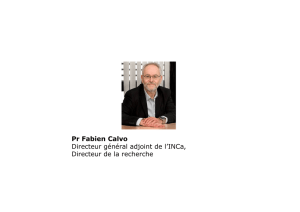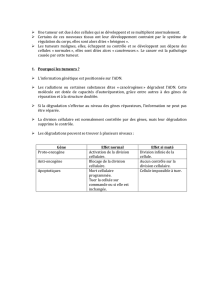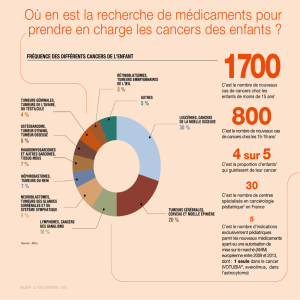CR_Montauban - Canceropole-GSO

CGSO – Recherche translationnelle dans le cancer du sein – Montauban – 3&4 juillet 2009
Cancéropôle GSO : rencontres & échanges autour de
la Recherche Translationnelle dans le Cancer du Sein
3&4 Juillet 2009 - Montauban
SYNTHESE
En annexes se trouvent les liens suivants :
Communications scientifiques présentées
Programme
Liste des Participants
I. Introduction
Ces rencontres sont une initiative conjointe de 3 Axes du Cancéropôle GSO :
- L’Axe 1, « Signalisation cellulaire et cibles thérapeutiques », représenté par son
coordonnateur Serge Roche et Gilles Freiss, coordonnateur du Réseau ResisTH et référent du
thème fédérateur « Cancers hormonaux-dépendants ». Le réseau ResisTH (Resistance aux
thérapies anti-hormonales) a souhaité se réunir à l’occasion de la fin de son financement et ces
rencontres lui ont permis de rencontrer la communauté GSO intéressée par sa thématique,
- L’Axe 2, « Instabilité génétique, cycle cellulaire et épigénétique », représenté par Charles
Theillet,
- L’Axe 3, « Facteurs prédictifs de la réponse thérapeutique », représenté par Marc Debled.
Des rencontres similaires avaient été organisées en octobre 2007 à Labourgade (voir le
programme) et les retours positifs des participants ont motivé cette seconde réunion.
L’objectif des rencontres translationnelles dans le cancer du sein est de faciliter dans un premier
temps le dialogue entre chercheurs biologistes et cliniciens, à l’exemple des collaborations étroites
initiées par le réseau ResisTH. Ceci afin de faciliter dans un second temps leur réunion sur des projets
partagés. L’organisation des ces journées a été possible grâce au soutien financier du réseau ResisTH,
de Lilly France et d’Astrazeneca.
II. Session « Tyrosine kinase et cancer du sein » Modérateur : Gilles Freiss
Peter Coopman (CRBM, Montpellier – Chef de l’équipe « Morphogenèse et signalisation cellulaires ») a
présenté le rôle suppresseur de tumeur de la tyrosine kinase Syk dans le cancer du sein. Il est observé
une perte d’expression de Syk pendant la progression tumorale faisant de cette tyrosine kinase un
facteur de mauvais pronostique. Syk inhibe la croissance tumorale et la capacité métastatique in vivo
et sa réexpression provoque une division cellulaire défectueuse. L’équipe s’intéresse à l’activité de Syk
au niveau subcellulaire (impact sur la mitose, l’adhésion intercellulaire et la polarisation épithéliale) et
recherche ses substrats (50 nouveaux substrats identifiés par la technique SILAC dont CDK1). Les
travaux tentent d’élucider les mécanismes moléculaires responsables de la perte d’expression de Syk
(régulation épigénétique ?, régulation négative de l’expression de Syk par Snail). Les travaux en
perspective de l’équipe comportent l’invalidation conditionnelle de Syk dans la glande mammaire chez
la souris. Des études cliniques devraient également permettre d’étudier l’expression différentielle de
Syk comme marqueur de sous-types de cancer du sein et de voir son implication dans les mécanismes
de résistance.
Serge Roche (CRBM, Montpellier – Chef de l’équipe « Tyrosine Kinase et Cancer ») a présenté
l’implication des tyrosines kinases de la famille Src (SFK) dans le cancer du sein. Les SFK sont
dérégulées dans 50% des cancers du sein et elles sont impliquées dans la croissance tumorale,
l’angiogenèse et la progression métastatique. La tyrosine kinase Src a une activité oncogénique dans les
cellules de cancer du sein. 2 substrats de Src sont étudiés :
- La protéine Abl : un signal oncogénique Src/Abl est observé dans les cellules de cancer du sein
« triple négatif » (ou « basal like »), faisant de leurs inhibiteurs de potentiels agents
thérapeutiques. Le signal oncogénique de Src est en cours d’identification par phospho-
protéomique quantitative (méthode SILAC).
- La protéine Tom1L1 : Tom1L1 est surexprimée dans le cancer du sein HER2+ et cette
surexpression est corrélée à une mauvaise survie. La signalisation Tom1L1 favorise l’activité

CGSO – Recherche translationnelle dans le cancer du sein – Montauban – 3&4 juillet 2009
invasive HER2 et les travaux démontrent que les protéines du trafic vésiculaire sont des
régulateurs importants de la tumorigenèse. Les fonctions de Tom1L1 sont en cours de validation
dans des modèles murins.
Bruno Robert (IRCM, Montpellier – Equipe A. Pèlegrin « Immunociblage et radiobiologie en oncologie »)
a présenté la dynamique positive et le dialogue entre biologistes et cliniciens ayant permis de passer de
la preuve de concept à l’essai clinique dans le cadre du développement d’une association
thérapeutiques d’anticorps anti-HER.
Les effets thérapeutiques lors du ciblage EGFR/HER2 pour le traitement du cancer du pancréas sont en
cours d’étude clinique. L’étude « THERAPY » a démarré et a pour objet l’étude d’une combinaison
d’anticorps anti-HER1 et anti-HER2 dans le traitement des adénocarcinomes pancréatiques
métastatiques. Une première étape consiste à tester la dose recommandée de l’association, au CRLC de
Montpellier. Une seconde étape, nationale, évaluera le taux de réponses objectives. Un second essai de
phase I-II, « GATE », évaluera l’association gemcitabine, trastuzumab et erlotinib en 1ère ligne de
traitement de patients atteints d’un adénocarcinome du pancréas métastatique.
Les mécanismes d’action sont en cours d’étude, notamment le rôle de l’ADCC et un rôle direct sur la
signalisation des récepteurs. L’association anti-EGFR/anti-HER2 va aussi être testée dans d’autres
pathologies et en utilisant d’autres inhibiteurs HER.
III. Session « Tyrosine kinase et cancer du sein – HER2 » Modérateur : Philippe Fort
Stéphan Vagner (CPTP, Toulouse – Chef de l’équipe « Altérations de l'expression post-transcriptionnelle
des gènes dans les cancers ») a présenté l’implication du complexe d’initiation de la traduction eIF4F
dans la réponse au trastuzumab (Herceptin®, anticoprs anti-HER2/neu). Les travaux ont montré que le
trastuzumab inhibe la phosphorylation de 4EBP dans certaines lignées cellulaires de cancer du sein
surexprimant HER2. Le trastuzumab inhibe l’initiation de la translation de la plupart des ARNm et les
cellules BT-474 surexprimant 4E et leur xénogreffes sont résistantes au trastuzumab. La question qui se
pose maintenant est de savoir si le niveau d’eIF4E détermine la sensibilité des tumeurs au trastuzumab.
Yann Bergé (Institut Claudius Regaud, Toulouse) a présenté les mécanismes de résistance au
trastuzumab par des données bibliographiques ainsi que les résultats d’une étude rétrospective sur 63
patientes consécutives traitées à l’Institut Claudius Regaud par une chimiothérapie néoadjuvante
associée au trastuzumab entre décembre 2003 et juillet 2008. Cette étude montre qu’eIF4E et HER2
sont des facteurs prédictifs de réponse au trastuzumab en schéma néoadjuvant mais ces conclusions
sont à valider de façon prospective dans une étude clinique.
Ali Badache (Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, Chef de l’équipe « Migration des
cellules tumorales ») a présenté ses travaux sur la signalisation Erb2 et la migration des cellules
tumorales. L’équipe a identifié précédemment certaines tyrosines de ErbB2 indispensables à la
migration cellulaire. Par une recherche systématique des protéines interagissant avec ces phospho-
tyrosines, une protéine nouvelle baptisée Memo (pour Mediator of ErbB2-driven motility) a été mise en
évidence. Memo, suite à son recrutement au récepteur, contribue à la migration cellulaire induite par
ErbB2. Les résultats de l’équipe indiquent que Memo contrôle la réorganisation du réseau de
microtubules qui accompagne l’activation de ErbB2. Les travaux actuels portent sur les mécanismes
moléculaires par lesquels Memo connecte les récepteurs membranaires au cytosquelette et active la
motilité cellulaire.
L’équipe cherche également à déterminer la contribution des voies de signalisation médiées par
l’activation des récepteurs à tyrosine kinase au processus de migration cellulaire. L’identification des
gènes, impliqués dans la motilité cellulaire par une approche originale de transcriptomiques couplé à
l’expression de formes mutées de HER2 a permis d’identifier de nouveaux régulateurs de la migration
.Une meilleure connaissance des réseaux de signalisation impliqués dans le processus de migration
cellulaire pourrait dévoiler de nouvelles cibles pour des thérapies anti-métastatiques plus spécifiques
et plus efficaces.
Gilles Thomas (Fondation Synergie Lyon Cancer) nous a présenté les travaux de séquençage complet des
cancers du sein HER2+ menés par « l’International Cancer Genome Consortium » (ICGC), et plus
spécifiquement par le « Breast Cancer Consortium » (BCC) de l’ICGC coordonné par Michael Stratton
(Sanger Institute, UK). L’objet de l’ICGC est d’obtenir une description complète de tous les
changements d’intérêt au niveau génomique, transcriptomique et épigénétique de 50 types ou sous-
types de tumeurs. La contribution française au BCC est soutenue par l’INCa et coordonnée par Gilles
Thomas. Le groupement collaboratif français a été initié en novembre 2008 et se compose de 4

CGSO – Recherche translationnelle dans le cancer du sein – Montauban – 3&4 juillet 2009
centres : i) le CRLC de Montpellier ii) le CRLC de Marseille, iii) l’Institut Curie et iiii) le CRLC de Lyon. 5
centres additionnels le complèteront à l’automne. L’approbation par un comité d’éthique en mai 2009
de l’utilisation des données et échantillons de l’étude SIGNAL2 va permettre le démarrage des travaux
d’ici peu.
IV. Session « Classification clinique ou moléculaire » Modérateur : Hervé Bonnefoi
Charles Theillet (IRCM, Montpellier) participe au programme "Cartes d'Identité des Tumeurs (CIT)"®,
initié et financé par la 'Ligue Nationale contre le Cancer'. Ce programme vise à caractériser de
multiples types de tumeurs grâce à l'analyse pangénomique de l'expression des gènes couplée à celle
des altérations chromosomique. Charles a présenté les premiers résultats de ses travaux dont l’objet
est le profilage des cancers du sein. Une proposition de classification moléculaire a été présentée et
propose l’existence de 6 sous-types moléculaires : Normal breast like, Basal like, Luminal A, Luminal B,
Lunimal C et Apocrine. Ces différents sous-types moléculaires se distinguent par des signatures
d'expression qui leur sont caractéristiques mais aussi par des profils d'anomalies génomiques
spécifiques. Ces données suggèrent qu’ils définissent des entités biologiques distinctes. Ils se stratifient
de manière assez stricte selon l'expression des récepteurs aux hormones stéroïdes AR (androgene
receptor), ER et PR, avec un sous-type AR-/ER-/PR-, un sous-type AR+/ER-/PR- présentant 65% de
tumeurs HER2+, 2 sous-types ER+/PR+ et 2 sous-types ER++/PR++. La cohérence observée dans la
répartition des caractéristiques clinico-biologiques entre les sous-types moléculaires est un élément en
faveur de la robustesse de la classification. Des différences ont été observées en termes de tropismes
métastatiques, certains sous-types ne présentant que des métastases osseuses et pas de métastases au
cerveau et réciproquement. De plus, différentes voies d'activation oncogéniques ont pu être associées
préférentiellement à certains sous-types. Les principales sont WNT, RAS et MYC. Chacune dans un sous-
type particulier. Ces données encore en cours d'analyse ouvrent d'importantes perspectives en termes
de définition des groupes de bon et mauvais pronostic et de prise en charge des malades du cancer du
sein. Elles suggèrent entre autre que l'on puisse s'appuyer sur cette classification pour définir les
malades à risque élevé, moyen et bas de récidive et ajuster les traitements en regard.
Gaëtan Mc Grogan (Institut Bergonié, Bordeaux – Département Pathologie) a proposé sa vision de
pathologiste sur la transposition de la classification moléculaire des cancers du sein à la pathologie
clinique. Il a posé la question de la place du pathologiste dans le contexte du développement des
signatures moléculaires. Gaëtan conclue que la classification moléculaire des cancers du sein a permis
le démembrement du groupe des carcinomes canalaires infiltrants en plusieurs groupes définis par i)
une évolution clinique différente, ii) des modèles d’expression génique différents et iii) des cibles
thérapeutiques différentes. L’approche simple des pathologistes permet de repréciser certains groupes
moléculaires et de sélectionner des tumeurs à grande échelle pour leur étude moléculaire.
Michel Longy (Institut Bergonié, VINCO, Bordeaux) a présenté la sensibilité des tumeurs BRCA. Les
gènes BRCA1 et BRCA2 sont les principaux gènes de prédisposition aux cancers du sein et de l’ovaire. Ils
sont responsables d’une majoration considérable du risque de survenue de ces cancers. Les pertes de
fonction de BRCA1 ou BRCA2 engendrent des défauts de réparation des cassures doubles brins par
recombinaison homologue. Un grand espoir repose actuellement sur le développement des inhibiteurs
de PARP-1. PARP-1 est la Poly (ADP-ribose) Polymérase 1, une enzyme impliquée dans la réparation des
altérations de l’ADN, notamment celles induites par la chimiothérapie. Les inhibiteurs de PARP-1
inhibent la réparation de l’ADN, et favorisent donc la mort cellulaire. Leur action est synergique avec
les chimiothérapies qui altèrent l’ADN, notamment les sels de platine. Plusieurs molécules inhibant
l’activité PARP sont actuellement en cours de développement clinique notamment dans les cancers du
sein et de l’ovaire chez les patientes porteuses de mutations BRCA.
V. Session « Hormonothérapie » Modérateur : Florence Dalenc
Marc Debled (Institut Bergonié, Bordeaux – Département d’Oncologie Médicale) a présenté l’étude
HORGEN, dont l’objectif principal est le profilage d’expression génique de réponse à un inhibiteur de
l’aromatase ou au Fulvestrant (2 bras d’étude). Cette étude est co-financée par l’INCa (150k€) et
Astrazeneca (150k€). L’étude vise à analyser le transcriptome des biopsies tumorales pour définir les
signatures moléculaires prédictives de la réponse à chacun des traitements endocriniens. Le
transcriptome tumoral est comparé avant et après traitement pour identifier les gènes mis en jeu dans
la réponse à chacun des traitements (profilage d’expression à Montpellier à l’IRCM (C. Theillet) et
l’IGMM (J. Tazi)). Les inclusions sont font actuellement sur 3 centres, l’institut Bergonié, l’Institut

CGSO – Recherche translationnelle dans le cancer du sein – Montauban – 3&4 juillet 2009
Claudius Regaud et le Centre Léon Bérard de Lyon. 128 patientes doivent être recrutées sur 2 ans, 64
par bras. Au 30 juin 2009, 41 inclusions ont eu lieu : il y a eu 3 sorties prématurées d’étude (rechute
locale avant 6 mois de traitement) et 1 SAE (Serious Adverse Event), considéré comme non lié à l’essai
et résolu sans séquelle. Une étude au même design se déroule actuellement en Ile-de-France,
CARMINA02.
Mélanie White-Koning (Institut Claudius Regaud, Toulouse - EA3035 « Groupe de pharmacologie Clinique
et expérimentale des médicaments anticancéreux ») a présenté les facteurs génotypiques et exogènes
influençant l’hormonothérapie des cancers du sein. Les polymorphismes observés notamment au niveau
des cytochromes induisent des différences de métabolisation ayant des impacts en clinique. Au niveau
exogène, la qualité de la fonction hépatique ainsi que les interactions médicamenteuses peuvent
influencer l’efficacité des hormonothérapies.
Le protocole PHACS pour « Pharmacologie de l’Hormonothérapie Adjuvante dans le Cancer du Sein » a
été sélectionné au PHRC 2009. Il a pour objectif principal d’évaluer les corrélations entre les
paramètres pharmacocinétiques et pharmacogénétiques des traitements hormonaux des cancers du
sein. Il rassemble pour une première fois tous les éléments de génétiques, PK, traitements associés et
observance dans une seule étude. Cet essai multicentrique implique les 5 villes du GSO (CLCCs de
Toulouse, promoteur, Bordeaux et Montpellier, CHU de Limoges et de Nîmes) et vise à recruter 2000
patientes en 2 ans.
Marc Poirot (CPTP, Toulouse – Chef de l’équipe « Métabolisme, oncogenèse et différenciation
cellulaire») a présenté le métabolisme des stérols dans les cellules tumorales mammaires comme un
nouvel acteur dans le contrôle de la sensibilité et de la résistance au tamoxifène. Les ligands des
« AntiEstrogen Binding Site » (AEBS) modulent le métabolisme du cholestérol. Les ligands d’AEBS
induisent la différenciation de cellules tumorales mammaires et induisent l’apoptose et l’autophagie
dans les lignées cellulaires MCF-7. Cet effet cytotoxique s’explique par une induction de perturbation
de l’activité mitochondriale, une stimulation de la production de ROS et une induction des
caractéristiques de macro-autophagie. Les ligands d’AEBS induisent l’apoptose et l’autophagie dans les
MCF-7, l’inhibition de l’autophagie sensibilise les cellules aux ligands d’AEBS et la vitamine E bloque les
effets antiprolifératifs et cytotoxiques des ligands d’AEBS.
VI. Session « Récepteurs des œstrogènes – interaction transcriptionnelle » Modérateur :
Vincent Cavaillès
Kerstin Bystricky (Université de Toulouse, LBME/CNRS - équipe »Chromatine et expression génique ») a
présenté des éléments de régulation épigénétique des gènes cibles du récepteur aux oestrogènes
(ERalpha) en étudiant 3 aspects : la localisation cellulaire, le comportement au cours du cycle
cellulaire et la régulation transcriptionnelle. En particulier, i) ces récepteurs liés à l’œstradiol ou aux
SERD s’accumulent dans de nombreux foci intranucléaires qui colocalisent avec le protéasome. ii)
L’hydroxy-tamoxifène (OH-TAM) et le Fulvestrant synchronisent les MCF-7 en G1, répriment
l’expression des gènes cibles du RE et ont un effet anti-prolifératif prononcé en phase S. iii) L’effet
stimulant de l’azacytidine ou de l’histone désacétylase Trichostatin A, seuls ou en combinaison, qui
permet de transcrire des gènes cibles du récepteur mis en silence dans les cellules ER négatives, est
transitoire (3 à 4 jours).
Florence Dalenc (Institut Claudius Regaud, Toulouse – Département d’Oncologie Médicale) a présenté
les inhibiteur des Histones déacétylases (HDACi) comme un traitement potentiel du cancer du sein. Les
HDACi favorisent la différenciation cellulaire (cellules leucémiques et cancer du sein) et l’un deux, le
SAHA® (Vorinostat) a aujourd’hui une AMM dans les lymphomes T cutanés réfractaires. D’autres HDACi
sont en cours de développement clinique dans d’autres indications (mélanomes, sarcomes, lymphomes
T, leucémies…).
Dans les cancers du sein, les perspectives thérapeutiques reposent sur i) une association avec des
cytotoxiques (existence d’une synergie d’action entre les HDACi et certains cytotoxiques) ii) une
association avec une hormonothérapie pour les tumeurs RE+ et pourquoi pas pour les tumeurs RE–
(étude clinique de preuve de concept en cours initiée par le réseau ResisTH), iii) une association avec
des thérapies anti-HER pour les tumeurs HER2+++ ou basales (les associations SAHA/trastuzumab et
SAHA/docétaxel ont un effet synergique in vitro).
Jean-Marc Vanacker (Lyon) : le principal modèle d'étude de l’équipe est le récepteur ERRα dit
« orphelin », proche en séquence des récepteurs des œstrogènes, mais non modulé par ces hormones et
possédant de nombreux niveaux d'interférence dans les signaux stéroïdiens. Une forte expression de

CGSO – Recherche translationnelle dans le cancer du sein – Montauban – 3&4 juillet 2009
ERRα est corrélée à un mauvais pronostic et une forte agressivité des cancers du sein, des ovaires, de la
prostate et du colon. La modulation de ERRα bloque la prolifération cellulaire (réduction de la
tumorigénicité chez la souris nude, induction de p21 indépendamment de p53). L’équipe étudie
actuellement le rôle de ERRα sur l’activité invasive cellulaire. Il montre que l’inhibition de l’expression
de ERRalpha affecte la migration cellulaire directionnelle sans affecter leur activité motile. En accord
avec ces observations, ERRalpha modifie l’activité des RhoGTPases qui sont des régulateurs essentiels
de la migration dirigée. La modulation de ERRα pourrait ainsi être bénéfique dans la prise en charge
des cancers agressifs.
VII. Session « Diffusion métastatique » Modérateur : Nicole Tubiana-Mathieu
Pierre Savagner (IRCM, Montpellier – Equipe C. Theillet « Identité et plasticité tumorale ») : Les
carcinomes mammaires humains peuvent être classés en fonction de leur profil d’expression génique en
plusieurs familles distinctes, caractérisées par l’expression de phénotypes cellulaires spécifiques
évoquant des étapes de différenciation cellulaire et des voies de signalisation préférentielles. On
retrouve notamment les voies Wnt, Notch, SHH, Myc. L’équipe a caractérisé en aval de la plupart de
ces voies d'activation le rôle de Slug, un facteur de transcription impliqué dans le contrôle du
phénotype cellulaire, surexprimé dans certaines tumeurs mammaires. Il est suggéré que Slug agit au
niveau de la maintenance et de l'activation de cellules de type progénitrices/souches, pendant le
développement et les modulations cycliques de la glande mammaire, mais aussi au cours de la
progression tumorale et métastatique.
Les travaux de Richard Iggo (Institut Bergonié, VINCO, Bordeaux) se basent sur les résultats de l’étude
EORTC 10994 et l’observation que des tumeurs mutées pour p53 sont résistantes aux anthracyclines
mais sensibles aux taxanes. Ces recherches pointent l’importance des modèles de régression choisis
pour une significativité des résultats. Le stroma (tissu nourricier et de soutien des cellules tumorales)
protègerait ainsi les cellules tumorales du FEC (5FU, Epirubicin, Cyclophosphamide), avec un effet
peut-être dû à l’activation des voies Wnt et TGFβ. Les médicaments ciblés anti-stroma pourraient ainsi
contrer la résistance au FEC mais l’effet doit être validé dans un modèle animal.
VIII. Session « Chimiosensibilité » Modérateur : Marc Debled
Philippe Fernandez (CHU Bordeaux) a présenté l’intérêt de la TEP au 18 Fluoroestradiol pour prédire la
réponse à l’hormonothérapie du cancer du sein localement avancé métastatique. On sait depuis 1988
que la fixation du FES chez des patientes ayant un cancer du sein ER+ est corrélée à l’expression des
récepteurs in vitro. La TEP-FES permet d’évaluer l’hétérogénéité fonctionnelle des ER, de prédire la
réponse au tamoxifène et peut prédire la réponse à l’hormonothérapie.
Une proposition de protocole a été présentée, soutenue par le service de médecine nucléaire du CHU
de Bordeaux et le groupe d’imagerie du CGSO. Après discussion avec les cliniciens présents, le
protocole initialement présenté a été amendé. Il vise désormais à réaliser une « TEP-FES
observationnelle pour évaluer sa valeur prédictive dans la réponse à l’hormonothérapie de 2ème
ligne vs chimiothérapie ».
Le groupe souhaiterait compléter puis présenter ce protocole à un PHRC. Il lance ainsi un
appel à collaboration aux services cliniques intéressés par le projet et qui pourraient le
porter.
Henri Roché (Institut Claudius Regaud, Toulouse – Département d’Oncologie Médicale) a présenté des
éléments sur la chimiosensibilté des cancers du sein. L’anticipation de l’efficacité d’une
chimiothérapie dépend du type tumoral (déterminé par classification moléculaire et type histologique)
et de facteurs prédictifs, qui peuvent être i) traditionnels ou de Niveau 1 (uPA/PAI1), ii) des signatures
génomiques ou de Niveau 2 (facteurs de prolifération, RE-) ou iii) des cibles spécifiques ou de Niveau 2
(topoII, p53…). L’utilisation des facteurs prédictifs de niveau 3 est recommandée. La conclusion qui est
faite est que les chimiothérapies ne sont toujours pas utilisées au mieux et la question se pose de leur
utilisation uniquement pour leur effet propre et la manière de les combiner avec des thérapeutiques
ciblées.
Gwendal Lazennec (Inserm U844 – Chef de l’équipe « Chimiokines, cellules souches mésenchymateuses
et cancer ») a présenté les mécanismes de contrôle de l'expression de la chimiokine CXCL8 dans les
cancers du sein ER-positifs et négatifs. IL-8 est une chemokine dont la sécrétion est négativement liée
au statut ER. Elle promeut l’invasion mais pas la prolifération. Les cytokines sont plus abondantes dans
les tissus de cancers du sein et les cancers de haut grade expriment des taux élevés de cytokines. L’IL-8
 6
6
 7
7
1
/
7
100%