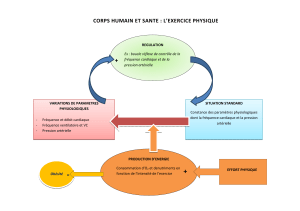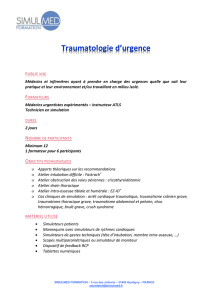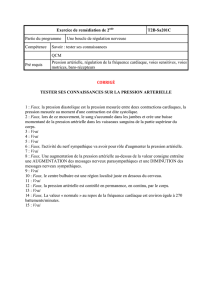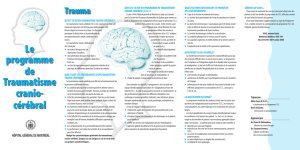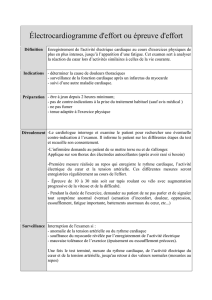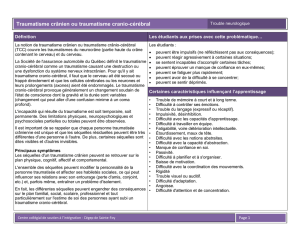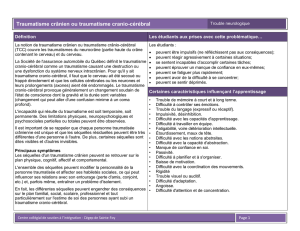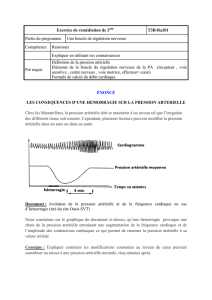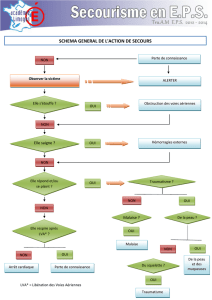Lire l`article complet

prise en charge des traumatisés crâniens : les priorités
par P. Adnet* et R. Gauzit**
* Service d'Accueil et d'Urgences du CHRU de Lille, Hôpital R.-Salengro, 59037 Lille Cedex.
** Médecin Anesthésiste-Réanimateur DAR, Hôpital Jean-Verdier, 93143 Bondy Cedex.
L'aggravation en chaîne des lésions initiales du cerveau (contusion, attrition,
cisaillement) débute immédiatement après le traumatisme crânien. L'origine de cette
agression cérébrale secondaire est soit intra-, soit extracrânienne (tableau n° 1). S'il
n'est pas possible à l'heure actuelle de protéger directement le cerveau par
l'utilisation de médicaments spécifiques, il est réaliste, en revanche, de concentrer
ses efforts sur l'amélioration de la prise en charge initiale des patients victimes d'un
traumatisme cranio-cérébral (TCC) grave. L'objectif est de diminuer l'incidence des
agressions cérébrales secondaires d'origine systémique qui alourdissent la
morbidité* et la mortalité*. Contrôler les agressions cérébrales secondaires d'origine
extracrânienne passe par l'amélioration des traitements symptomatiques initiaux qui
doivent être débutés dès la prise en charge du patient, poursuivis pendant le
transport, à l'arrivée dans un service d'urgences, lors de la réalisation d'examens
complémentaires puis à l'admission dans un service spécialisé. Cette notion de
"chaine de protection cérébrale continue", doit être respectée en permanence. Notre
exercice quotidien nous montre à l'évidence qu'il existe de nombreuses périodes à «
risque » lors, par exemple, des transferts extra- et intrahospitaliers ou encore
pendant la réalisation d'examens complémentaires (angiographie, scanner) : le
patient peut alors perdre tout ou partie de ses chances de récupération.
Physiopathologie appliquée
Au niveau du point d'impact (choc direct ou par contre-coup), les lésions cérébrales
vont de la simple commotion qui récupère intégralement à l'attrition associant
destruction des axones et hémorragies. Les lésions des zones de pénombre
(situées autour des points d'impacts traumatiques directs) sont faites
d'extravasations vasculaires, d'obstructions des microvaisseaux.
Le débit sanguin cérébral (DSC) après un traumatisme crânien est pratiquement
toujours diminué initialement jusqu'à la 6è heure) et se situe au-dessous du seuil

critique d'ischémie pour un tiers des patients (33 %). Secondairement (après la 6e
heure), l'incidence de l'ischémie diminue rapidement (rééquilibration du DSC)
montrant qu'une prise en charge tardive est peu utile. Il faut donc considérer tout
patient victime d'un traumatisme cranio-cérébral en état d'ischémie cérébrale ; aussi,
rétablir et/ou maintenir une pression de perfusion cérébrale donc une pression
artérielle normale est une priorité absolue qui doit être prise en charge comme un
arrêt cardio-circulatoire.
Principaux mécanismes responsables des agressions cérébrales secondaires
Hypotension artérielle
C'est l'agression cérébrale secondaire de loin la plus fréquente et la plus délétère.
On sait depuis vingt ans que la mortalité d'un patient traumatisé crânien double s'il
présente à l'admission dans un service d'urgence une pression artérielle systolique <
90. L'hypotension est responsable, à elle seule, de 60 % des décès si elle n'a pas
été corrigées temps par une équipe d'urgence extrahospitalière. Dans ces
conditions, il semble raisonnable de viser un objectif tensionnel d'au moins 120
mmhg. L'hypotension peropératoire est tout aussi néfaste.
Hypoxémie*
En cas d'hypoxémie entre le lieu de l'accident et l'arrivée à l'hôpital, un taux
d'évolution défavorable de 50 % est observé. Le pronostic est encore plus sombre
s'il existe une hypotension artérielle associée (75 % de mortalité). L'hypoxémie est
souvent liée à une mauvaise libération des voies aériennes supérieures. En 1993,
en France, seulement 40 % des patients comateux étaient transportés intubés et il
est logique de penser que la médicalisation des équipes de secours a diminué
considérablement la fréquence des épisodes hypoxiques.
Hypercapnie*
La grande majorité des patients comateux (score de Glasgow < 8) sont
hypercapniques avant les gestes de libération des voies aériennes supérieures
avec ou sans intubation trachéale. Le traumatisme cranio-cérébral est presque
toujours associé à une hypoventilation, elle-même corrélée à la profondeur du
coma. L'obstruction partielle des voies aériennes supérieures en est la principale
cause. L'hypoventilation centrale se voit plus rarement et doit faire rechercher une
lésion de la moelle cervicale. Une souffrance médullaire aiguë de niveau supérieur
à C4 se traduit par un tableau de choc spinal associant une hypotension artérielle
associée à une bradycardie sinusale, une paralysie flasque, une détresse
respiratoire avec hypercapnie, une rétention aiguë d'urine.
Hypocapnie*
Pour une pression artérielle normale, la réponse du débit sanguin cérébral (DSC)
est presque linéaire entre 20 et 80 mmhg de pression artérielle en gaz carbonique a
(PaCO2) : réduire de moitié la PaCO2 de 40 à 20 mmHg divise par deux le DSC. De
même, doubler la PaCO2 de 40 à 80 mmHg double le DSC. L'hyperventilation
diminue la pression intracrânienne mais risque d'augmenter l'ischémie cérébrale en

diminuant le DSC. Aussi, la réduction spontanée du DSC qui accompagne le
traumatisme cranio-cérébral dans au moins 30 % des cas contre-indique
l'hyperventilation systématique. En pratique, une hypocapnie modérée de sécurité,
afin d'éviter toute hypercapnie, est recommandée (PaCO2 aux environs de 35
mmHg).
Hypertension artérielle (HTA)
L'hypertension artérielle en phase initiale de la prise en charge d'un traumatisme
cranio-cérébral grave est très fréquente et ne doit pas être corrigée. Il est possible,
en effet, qu'une HTA soit plutôt utile. Il faudrait avant tout s'enquérir du statut
tensionnel du patient avant le traumatisme (hypertendu connu, traité ou non). Un
sujet âgé tolérera d'autant moins bien une "normotension" qu'il était auparavant
hypertendu. En pratique, en l'absence de signe évident d'hypertension
intracrânienne et d'anamnèse, une hypertension artérielle doit être respectée parce
que l'ischémie cérébrale est, comme nous l'avons vu, la voie finale commune de
l'agression cérébrale quelle qu'en soit la nature.
Conduite pratique
Tout patient comateux (score de Glasgow < 8) doit être considéré comme porteur
d'une lésion du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire. La mise en place d'une
minerve ou de deux sacs de sable en région cervicale sera systématique. Toute
mobilisation du sujet devra maintenir la tête en position axiale. Une fois les variables
respiratoires et hémodynamiques vérifiées, un examen neurologique initial sera
effectué sur les lieux de l'accident.
Bilan neurologique
L'examen évaluera le niveau de conscience par le score de Glasgow. Cette échelle
graduée est simple, rapide et reproductible, permettant une transmission facile entre
les différentes équipes qui recevront le blessé. L'état de coma se définit comme un
score de Glasgow inférieur à 8 (tableau n° 2). C'est un indice pronostique de grande
valeur, bien corrélé à la gravité des lésions et au risque de décès quels que soient
les moyens mis en œuvre secondairement. Une adaptation de la réponse verbale
aux enfants de moins de deux ans est nécessaire. Lorsque le patient ne peut
ouvrir les yeux pour des raisons externes (hématome, traumatisme direct), le score
est compté 1. Si la réponse aux stimulus est asymétrique - par exemple le patient
évite le stimulus à gauche et ne réagit pas à droite -, le score est compté 4. La
stimulation doit être réalisée par un frottement appuyé sur le sternum pendant 5 à 10
secondes. Le pincement du mamelon ne doit pas être le stimulus douloureux car
non symétrique.

État hémodynamique
Un traumatisé crânien pur est rarement choqué, s'il l'est, c'est que son état
neurologique est très grave. Un collapsus cardiovasculaire doit faire rechercher des
lésions associées (abdomen, bassin, membres inférieurs) ou une atteinte de la
moelle épinière. Cette dernière hypothèse doit être évoquée devant un syndrome
vagotonique associant : bradycardie, hypotension artérielle et hypothermie. Dans
tous les cas, restaurer une pression artérielle normale en fonction de l'âge est une
priorité absolue. La pression artérielle varie en fonction de l'âge (tableau n° 3). Le
traitement doit être aussi agressif que celui réalisé lors d'un arrêt cardio-circulatoire
et fait appel au remplissage parfois associé aux vasopresseurs.
Le choix et la quantité du soluté de remplissage restent controversés et n'ont pas
beaucoup d'importance à condition de suivre au moins deux objectifs : maintien de la
volémie* et de la natrémie à 140 Meq/I. Pour maintenir une natrémie normale, il
suffit de n'utiliser que des solutés contenant 9 g de sel (NACI) par litre. De ce fait,
les solutés glucosés sont unanimement proscrits. Dans tous les cas, la
restriction hydrique n'a plus sa place dans la prise en charge initiale car elle est
source d'hypotension artérielle et de baisse de la pression de perfusion cérébrale.
Pendant longtemps, les cristalloïdes (sérum salé, ringer lactate) ont été bannis de
toute réanimation neurochirurgicale. Cette attitude était justifiée par l'apparition
d'oedèmes périphériques chez des patients ayant reçu de grandes quantités de ces

liquides. En fait, les cristalloïdes n'ont probablement pas leur place en cas de choc
hypovolémique, le volume de distribution du sérum salé étant tel (volume
extracellulaire) qu'il faudrait perfuser au moins 4 litres pour compenser la perte d'un
litre de sang. Par contre, le sérum salé est le soluté de choix pour maintenir
une hydratation normale du patient (maintien d'une normo-natrémie). Le ringer
lactate n'est pas iso-osmotique (273 mOsm.L-1) et ne devrait pas être administré
mais, à défaut, il convient mieux que le sérum glucosé. En cas d'hypotension, les
colloïdes et les hydroxy-éthyl-amidons sont les solutés à utiliser en première
intention. Ces solutés accentuent l'anémie responsable d'une augmentation parfois
considérable du débit sanguin cérébral (mécanisme compensateur de la baisse du
contenu artériel en O2). Un patient jeune peut supporter un taux d'hèmoglobine égal
à 7 g/dl (hématocrite à 25%). Le remplissage sera guidé par l'interprétation
raisonnée de la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le débit urinaire, et
l'estimation des pertes sanguines. La mise en place d'une pression veineuse
centrale est utile, mais jamais indispensable. L'ensemble de ces données doit éviter
toute surcharge volémique fréquente à la phase de récupération d'un état de choc
hémorragique (risques d'aggravation de l'hypertension intracrânienne) . L'utilisation
clinique de solutés salés hypertoniques n'est pas encore validée.
Certains auteurs nient toute indication des agents vasopresseurs dans la phase
initiale de réanimation du polytraumatisé. En fait, l'effet désastreux de l'hypotension
artérielle lors d'un traumatisme cranio-cérébral sévère fait recommander le recours
précoce à des agents vasopresseurs. Les catécholamines (dopamine, adrénaline,
noradrénaline) devraient faire partie de l'arsenal thérapeutique initial pour le maintien
à tout prix de la pression de perfusion cérébrale.
État respiratoire
Tout patient ayant un score de Glasgow inférieur à 8 doit bénéficier d'une intubation
trachéale et d'une ventilation contrôlée compte tenu du retentissement majeur des
variations de pression artérielle en oxygène (PaO2) et surtout de PaCO2 sur le débit
sanguin cérébral. D'autres indications sont résumées dans le tableau n° 4. La
fréquence d'une lésion cervicale associée au traumatisme cranio-cérébral est
estimée entre 1,8 et 10 %. Aussi, toute manoeuvre visant au rétablissement de la
liberté des voies aériennes supérieures doit prendre en considération le risque
potentiel de déplacement secondaire d'une fracture cervicale instable. Différentes
techniques ont été décrites. Les points importants résident dans le maintien de l'axe
tête-tronc et la détection d'une difficulté à l'intubation (corps étranger, traumatisme
facial, fracture mandibulaire). Un exemple de séquence rapide d'intubation trachéale
peut être proposé (tableau n° 5). En l'absence de détresse respiratoire aiguë,
plusieurs techniques sont possibles : intubation nasale à l'aveugle, intubation
rétrograde, fibroscopie bronchique lorsque c'est possible.
Dès que la liberté des voies aériennes supérieures est assurée, la majorité des
patients développe une hyperventilation centrale neurogénique qui peut induire une
hypocapnie parfois importante (risque d'ischémie cérébrale). Ailleurs, une respiration
anarchique peut être observée. Dans ces différents contextes, la ventilation
mécanique aidée d'une sédation permet d'optimiser au mieux la PaCO2 d'autant que
la marge thérapeutique (35 mmHg < PaCO2 < 40 mmHg) est étroite.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%