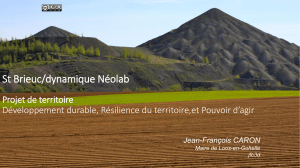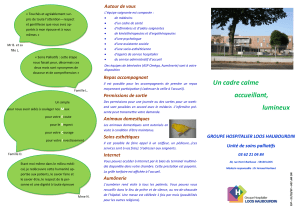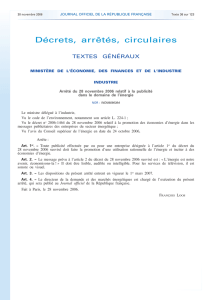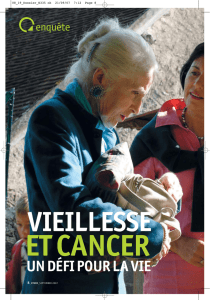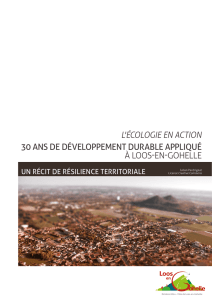ROBERT TREVISIOLError

1
16/4/17
ROBERT TREVISIOL
ADOLF LOOS ÉTAIT-IL ENGAGÉ ?
« Les architectes ont pour tâche de saisir la profondeur de la vie, de méditer sur les conditions
de nécessité jusqu'aux conséquences ultimes, d'aider les groupes sociaux les plus faibles, de
fournir au plus grand nombre de ménages un équipement vraiment fonctionnel, et en aucun cas
il ne leur appartient d'inventer de nouvelles formes. »
1
Adolf Loos était-il engagé? Si le titre qui m'a été proposé pour mon intervention évoque
l'engagement de Loos sous la forme interrogative, cela tient probablement au fait que
souvent cet architecte a été pris pour un dandy, sans doute à cause de nombreuses allusions
anecdotiques, voire frivoles, dont il émailla ses écrits et plus tard ses conférences.
En fait, celles-ci lui servent à montrer comment dans presque tous les domaines le goût
évoluait naturellement et sans que personne ne songeât à déterminer de façon abstraite le
développement des formes, sauf dans le domaine de l'architecture et de l'aménagement
intérieur où des pseudo-artistes prétendaient imposer leur tutelle aussi bien aux artisans
qu'à leurs propres clients.
Les familiers de l'œuvre de Loos s'étonneront en revanche du titre et se demanderont qui
d'autre, parmi les précurseurs du Mouvement moderne et même parmi ses ténors, a bien pu
s'engager autant que Loos pour l'éducation publique et l'émancipation des femmes, pour la
construction de cités ouvrières avec la participation directe des habitants et la mise en
place de cantines populaires pendant la période de crise au lendemain de la première
guerre mondiale, et se battre aux côtés des avant-gardes artistiques.
Cependant, même ses admirateurs n'ont pas toujours suffisamment perçu que pour Loos,
malgré une maîtrise du moindre détail et un raffinement rarement égalés, l'engagement
devait être avant tout projeté au-delà de l'architecture.
Je ne traite pas ici de l'architecture de Loos, mais il importe de rappeler qu'en dépit du
malentendu le plus tenace à leur sujet, ses réalisations et ses projets ne préfigurent pas une
modernité rigoureusement épurée ; ils constituent une alternative à cette modernité. Loos
n'était pas moderne malgré ses colonnes, les meubles Chippendale de ses intérieurs, les
essences précieuses de ses boiseries. Bien au contraire : sa vision de la modernité englobait
tous ces attributs, toutes ces stratifications de la tradition.
Si l'on se réfère à la juxtaposition efficace proposée par un célèbre essai d'Anatole Kopp -
le moderne compris comme cause ou comme style -, il est absolument évident que Loos
est parmi les tout premiers qui aient vu le moderne comme une cause, comme un
engagement pour améliorer les conditions sociales et matérielles.
En même temps, il considère néanmoins que les formes claires, rationnelles, que cet
engagement s'efforcera de donner au cadre bâti ne devront pas pour autant se solder par un
abandon de la tradition classique et du savoir-faire artisanal.
Pour prendre une comparaison d'ordre linguistique, Loos, persuadé qu'il importe de définir
un discours moderne, juge cependant vaine la recherche d'une langue - voire précisément
1
Adolf Loos, Von der Sparsamkeit [De la parcimonie], in “Wohnungs-Kultur. Monatszeitschrift
für industrielle Kunst”, n 2-3, Brno 1924, p. 21.

2
16/4/17
d'un style - moderne. Et pour ne pas laisser subsister le moindre doute à cet égard, il répète
que la tradition classique joue dans la production architecturale un rôle fondamental,
comparable à celui de la grammaire, alors qu'il traite d'« espérantistes » de l'architecture
ceux qui se flattent d'aboutir à une expression moderne par un processus d'épuration.
2
Par une approche en trois phases je me propose d'expliquer :
1. ce dont l'architecture, de l'avis de Loos, ne devait point se mêler;
2. que si Loos préconisait un engagement social de l'architecture, celui-ci lui semblait
encore plus devoir dépasser l'architecture;
3. enfin quelques caractéristiques - surtout d'ordre spatial - qu'une intervention
architecturale doit posséder pour que Loos la juge adaptée à la sensibilité moderne.
I
Le philosophe Ludwig Wittgenstein - qui rangeait Adolf Loos parmi les personnalités
dont il avait subi l'influence - disait à propos de son Tractatus logico-philosophicus que
son œuvre se composait de deux parties, ce qu'il avait écrit et ce qu'il n'avait pas écrit,
ajoutant d'ailleurs que la seconde partie était la plus importante. Il serait possible de
retrouver un paradoxe semblable chez Loos si l'on distingue dans son œuvre d'une part la
production architecturale proprement dite et de l'autre une réflexion critique beaucoup plus
globale sur la civilisation ; là encore, c'est en fin de compte la seconde partie qui est
beaucoup plus importante. La préoccupation principale de Loos semble consister à bien
différencier ce que devraient être l'architecture et surtout la tâche de l'architecte, et ce qui
ne demande pas de compétence spécifique ou d'intervention proprement architecturale,
voire ce qui nuit à un apport civilisateur de l'architecture.
Tout au long de sa vie, Loos s'est efforcé de mener son combat sur deux fronts : d'une part
il a cherché à définir une expression architecturale adaptée aux exigences d'une époque
marquée par le passage à une société de masse ; d'autre part il a cherché à élaguer le travail
de l'architecte de tout ce qui ne pouvait que diminuer sa véritable force d'invention et le
détourner des tâches pressantes qu'une société de masse imposait à la production
architecturale. Il importe ici d'ajouter que l'un des modes opératoires les plus directs
envisagés par Loos pour procéder à cet élagage consistait à remettre toute une série de
choix 'mineurs' entre les mains des exécutants ou des utilisateurs de l'architecture.
Pour l'époque, de telles idées sont tout à fait révolutionnaires : c'est certainement vrai en
1898, lorsqu'apparaît sa première série d'articles, mais ce l'est tout autant une dizaine
d'années plus tard, lorsque Loos réaffirme ces idées avec encore plus de force. Une
2
A vrai dire, Loos ne nie pas qu'il puisse y avoir une sorte de ‘modernité’ dans l'évolution du
goût, mais il est d'avis que celle-ci n'ait besoin d'aucune recherche particulière pour
s'affirmer et qu'elle jaillisse d'un processus tout à fait naturel, inéluctable, comme le prouve
le fait qu'à chaque époque une telle modernité a pu se frayer son chemin.

3
16/4/17
comparaison très sommaire avec la position d'Otto Wagner - dans les mêmes années
permettra de mieux saisir l'originalité de Loos.
D'un côté, Wagner souhaitait une primauté de l'architecture sur les autres arts - et
notamment sur les nouveaux arts appliqués -, alors que pour Loos il était inconcevable
que des auteurs de projet étrangers à la réalisation matérielle d'un ouvrage pussent exercer
sur celui-ci une quelconque tutelle ‘artistique’, d'autant qu'à son avis les nouvelles
générations d'architectes étaient trop obsédées par la quête du nouveau et n'avaient pas
l'humilité nécessaire pour apprendre la valeur des techniques traditionnelles. De l'autre
côté, Wagner poussait jusqu'à l'intolérance son hostilité à l'égard des nouveaux
lotissements d'habitations unifamiliales, qu'il jugeait foncièrement anti-économiques, alors
que Loos estimait sans doute qu'il n'était guère possible d'aller contre cette demande (tout
en comprenant les arguments de Wagner), et s'efforçait en tout état de cause de soumettre
ce phénomène à des principes rationnels et même, somme toute, économiques.
Depuis les tout premiers écrits (1897-98) par lesquels il s'impose à l'attention du public
viennois, Loos essaie de sensibiliser les lecteurs aux nombreux ferments positifs
qu'engendrent
3
les transformations en cours, non sans les mettre en garde contre des
mystifications de plus en plus fréquentes, surtout dans les domaines culturel et artistique. Il
s'insurge notamment contre l'approche esthétisante qui tend alors à s'imposer, et à laquelle
il reproche une confusion de genres qu'il vaudrait bien mieux garder distincts.
4
Au-delà des thèmes apparemment frivoles, tels l'habillement, les voitures de luxe ou même
des questions d'étiquette, Loos se propose de démystifier le rôle de démiurge que les
architectes s'arrogent dans leur obsession de créer des modes ephémères, de s'inventer des
prétextes d'architecture à tout bout de champ, alors que la civilisation va dans la direction
opposée.
L'erreur commise par les architectes consiste notamment à confondre leur travail avec
celui de l'artiste, sans se rendre compte que l'art doit surtout viser une élévation de l'esprit,
alors que l'architecture — dans une société de masse — doit mettre la commodité à la
portée du plus grand nombre.
Loos s'insurge avec de plus en plus de virulence contre toute activité superflue, contre tout
gaspillage constituant à ses yeux autant de symptômes du déracinement culturel qui sévit
sur la scène architecturale de son temps. (« “Ne regardez pas cette horreur ; j'ai fait ça il y
a trois ans!”, est un mot qui ne peut que sortir de la bouche d'un architecte. » A. Loos,
3
De façon fort habile Loos souligne notamment le niveau beaucoup plus évolué atteint par le
monde anglo-saxon, voire par la culture dans laquelle la Sécession viennoise puisait elle-
même ses modèles artistiques. Il brouille néanmoins quelque peu les pistes en citant
indifféremment des exemples anglais et américains - et ceux derniers devaient être
nettement plus familiers pour Loos, grâce à un séjour prolongé aux Etats-Unis (1893-96) -,
ce qui lui permet de mettre l'accent davantage sur des innovations technologiques ou même
d'ordre social, plutôt que sur des modes esthétiques.
4
On peut noter une analogie des plus intéressantes avec la polémique qui va opposer
l'écrivain Karl Kraus aux journalistes, responsables de ne pas se borner à communiquer les
informations, pour leur donner en revanche une présentation plus stylée. Une telle tentative,
de l'avis de Kraus se solde par un double échec : la presse manque à son devoir d'informer et
se ridiculise de surcroît car, malgré les ambitions grotesques de ces tâcherons, jamais leur
prose ne pourra prétendre à une quelconque dignité littéraire. (« La manie de dissimuler la
vie pratique par le biais de l'ornement, qu'Adolf Loos a si bien mise en évidence, trouve son
pendant dans les mots spirituels dont les journalistes truffent leurs travaux, engendrant ainsi
une confusion catastrophique. Les phrases sont l'ornement de l'esprit... » ; in “Die Fackel”, n.
279/280, du 15 mars 1909.)

4
16/4/17
Paroles dans le vide, p. 292.)
Il devient rapidement manifeste pour Loos que les architectes doivent se proposer avant
tout d'améliorer les conditions de logement et les équipements collectifs. Mais à cet effet,
il lui paraît indispensable de libérer l'architecture de tout un fatras de fausses attentes et
d'expliquer que l'architecture ne pourra contribuer à concrétiser une vision sociale qu'en
s'insérant dans une culture plus large. En ce qui concerne la culture — de même que
l'architecture — Loos a voulu surtout souligner qu'elle doit être l'objet non d'invention,
mais avant tout de compréhension, d'assimilation progressive ; c'est seulement à la fin de
ce processus, que des personnes ayant des dons particuliers peuvent essayer de faire
avancer la culture par leur apport original, qui toutefois ne sera généralement pas compris
avant de longues années. Or c'est dans cette perspective à long terme qu'art et architecture
se différencient une fois de plus. L'art, qui pour Loos sert également à déranger le public, à
le tirer de sa torpeur, de son confort intellectuel, n'a pas besoin d'une reconnaissance
immédiate. L'architecture en revanche a pour tâche de servir le public, et son confort
matériel ; elle doit donc d'emblée se faire apprécier et susciter l'assentiment général.
II
Dans l'exercice pratique de son métier d'architecte, Loos montre également que ses vues ne
sont pas toujours conventionnelles. A la différence de tant d'autres architectes du
Mouvement moderne, il ne demande pas à ses clients (directs ou indirects) d'apprendre à
habiter, estimant au contraire que c'est à lui de se mettre à leur service, de chercher à
comprendre leurs exigences et leurs habitudes. Toutefois il attend d'eux une participation
active et consciente.
Au lendemain de la première guerre mondiale, lorsque la social-démocratie lance dans la
capitale autrichienne les programmes de logements sociaux, il apparaît que Loos pense à
un modèle social très différent de celui de la Vienne rouge, fondé sur une politique des
superblocs, visant à forger un sentiment puissant d'identité prolétarienne, et à engendrer
une nouvelle monumentalité.
Il insiste beaucoup sur la nécessité d'une participation directe des habitants, qui doivent
avoir la volonté de se prendre en charge eux-mêmes. Cette approche est à son avis la seule
qui permette de saisir les chances d'émancipation sociale que peut offrir une société de
masse. Loos ne conteste pas pour autant qu'il puisse être utile de promouvoir un nouvel
ordre social (éventuellement socialiste) dans lequel les droits et le bien-être des masses
soient mieux protégés que sous le régime impérial. Il pense toutefois qu'une société
démocratique véritable ne peut se construire que sur l'engagement direct de chaque citoyen
et surtout il est conscient des énormes difficultés liées à la grave crise économique que
connaît l'Autriche au lendemain de la guerre. Ce dernier aspect est illustré avec éclat par
l'importance que ses propositions de lotissements ouvriers (Siedlungen) accordent à la
présence des potagers, conçus pour une économie d'autosubsistance, plus encore qu'à la
typologie des maisons.
Bien entendu, Loos comprend que pour permettre à la classe ouvrière d'amorcer sa propre
émancipation à travers un engagement concret et direct, on ne saurait se contenter de faire
appel à l'esprit individuel d'initiative, et qu'il est nécessaire que les pouvoirs publics créent
certaines conditions préalables. Voilà pourquoi, dès le début de la phase de transition
politique et sociale, Loos réclame explicitement l'intervention de l'Etat, notamment dans

5
16/4/17
les domaines de l'éducation, de la formation et de l'accès à la culture, dans le but
d'accélérer le changement de mentalité nécessaire et de favoriser concrètement l'avènement
d'un nouveau modèle social. Incidemment, la rédaction des Richtlinien für ein Kunstamt
(Orientations pour une direction de l'art), en collaboration avec d'autres intellectuels
progressistes (1919), est l'une des manifestations les plus explicites et les plus marquantes
de l'engagement culturel de Loos.
Dès ses débuts, aussi bien par ses articles que par les exemples d'aménagements intérieurs
qu'il propose, Loos a voulu contribuer à une évolution des mentalités sans laquelle la
notion même de modernité resterait vaine ; il a voulu encourager son public à participer
directement et consciemment aux transformations en cours, à choisir des valeurs plus
durables, à privilégier une amélioration du confort matériel. De plus, il cherche à
convaincre ses clients que l'aménagement de la sphère domestique est davantage un
problème de personnalité que d'architecture - et en tout état de cause une affaire privée.
Pendant des années Loos a transformé ou aménagé des appartements et quelques maisons
unifamiliales, en refusant toute recherche d'originalité superficielle et en ayant recours à
des solutions artisanales éprouvées. Il ne cessait de répéter que des artisans il avait appris
tous les trucs de son métier et jamais il ne chercha à interférer dans le travail de ceux qu'il
considérait comme les véritables ‘auteurs’ des intérieurs qu'on lui demandait de créer.
Loos est même allé jusqu'à expliquer dans ses écrits que ces aménagements ne pouvaient
pas être vraiment considérés comme des travaux d'architecture et que son rôle était tout au
plus de conseiller ses clients dans le choix des corps de métiers :
« Les uns viennent chez moi parce que ils ne s'y connaissent pas, d'autres parce qu'ils ne savent pas
où s'adresser, d'autres encore parce qu'ils manquent de temps, mais chacun vit dans son propre
logement, selon sa propre personnalité. Mitigé, il est vrai, par mes conseils. » (Paroles dans le vide, p.
173)
Il cherchait si peu à exploiter sa capacité d'invention en proposant de nouveaux
ameublements qu'un client lui fit parvenir un jour une somme importante en signe de
reconnaissance pour le plaisir inchangé avec lequel depuis vingt ans il vivait dans
l'appartement que Loos avait aménagé pour lui, alors que ses amis avaient dans le même
temps fait refaire leur intérieur au moins quatre fois.
Tant auprès de l'élite que de la classe ouvrière, Loos veut donc promouvoir une
participation plus consciente aux transformations en cours et une conception de la culture
marquée par un esprit plus concret, au lieu du mimétisme bête qu'il avait stigmatisé dans
l'un des ses tout premiers écrits - inspiré par Otto Wagner : La ville façon Potemkine.
L'objectif ultime — et mythique — reste toujours l'introduction de la civilisation
occidentale en Autriche. (« Si le téléphone de 'style' nous a été épargné, nous le devons
uniquement au fait que cet appareil n'a pas été inventé en Allemagne ou en Autriche, mais
en Amérique. » Paroles dans le vide, p. 123)
Les classes moyennes peuvent atteindre un degré plus évolué de civilisation en renonçant à
un esthétisme superficiel et en privilégiant l'assimilation de valeurs culturelles plus
durables. Les travailleurs peuvent en revanche améliorer leurs conditions de vie en mettant
à profit la principale ressource dont il disposent, à savoir leur propre travail manuel, pour
construire leurs habitations.
L'incitation à prendre en charge personnellement l'amélioration de leur condition
matérielle était sans doute mieux adaptée à la mentalité de ses clients bourgeois, mais
l'enthousiasme juvénile avec lequel Loos, lors de son séjour aux Etats-Unis (1893-96)
 6
6
 7
7
1
/
7
100%