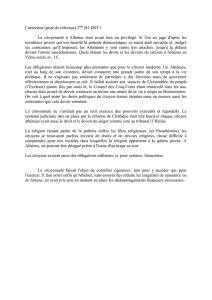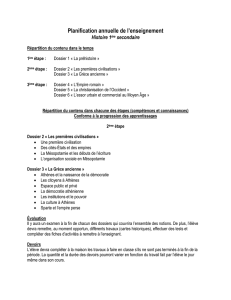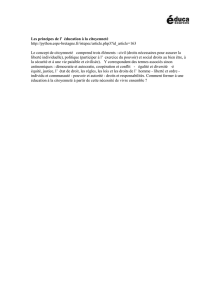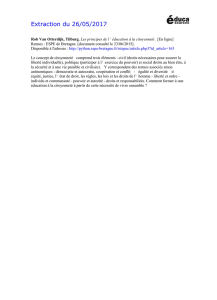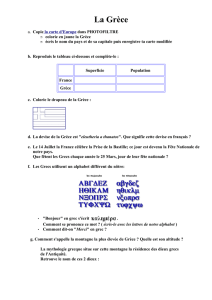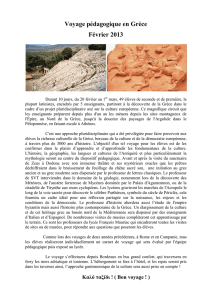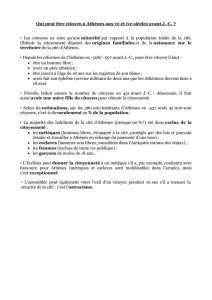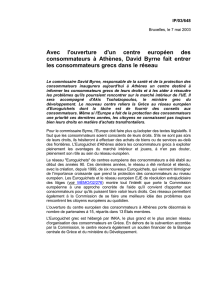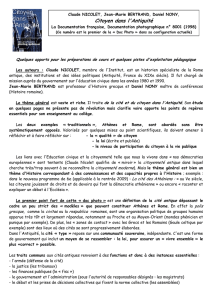CEDH3-DL-FP-Citoyenn.. - Cahiers Europeens d`Houjarray

1
Citoyenneté européenne, citoyennetés nationales
Une connaissance mutuelle de base est un point de départ pour mieux
appréhender les éléments qui rapprochent ou éloignent les nations
européennes les unes des autres, favoriser une meilleure compréhension et
préserver la paix.
Cette nouvelle rubrique propose des extraits de l’ouvrage réactualisé
« Citoyennetés nationales, citoyenneté européenne » conçu et coordonné par
Françoise Parisot. Il a été publié en 1998 par les Editions Hachette
Education avec l’aimable soutien de : la Commission européenne (programme
SOCRATES - Education des Adultes), le ministère délégué aux Affaires
européennes, le ministère de l’Education nationale, la Caisse des dépôts et
consignations, la Fondation Maginot.
Sous le thème générique, « Les éléments fondateurs, Les citoyennetés des
Européens : histoire et vécu », les 15 pays membres de l’Union européenne seront
traités selon le calendrier suivant :
CEDH n°3 : La Grèce et l’Italie
CEDH n°4 : L’Espagne et le Portugal
CEDH n°5 : La France et la Belgique
CEDH n°6 : Le Royaume-Uni et l’Irlande
CEDH n°7 : L’Allemagne et l’Autriche
CEDH n°8 : Les Pays-Bas et le Luxembourg
CEDH n°9 : Le Danemark, la Finlande et la Suède
Dans ce premier volet, nous aborderons donc la Grèce et l’Italie.

2
Citoyenneté européenne, Citoyennetés nationales
Pourquoi ce dossier ?
1
« La coopération entre les nations viendra du fait
qu’elles se connaîtront mieux et que les éléments
divers qui les composent auront pénétré les
éléments correspondants des nations voisines. »
Jean Monnet, Mémoires, Fayard, Paris, 1976.
« La véritable union ne fond pas les éléments
qu’elle rapproche ; par fécondation et adaptation
réciproques, elle leur donne un renouveau de
vitalité. C’est l’égoïsme qui durcit et neutralise
l’étoffe humaine. L’union différencie. » Pierre
Teilhard de Chardin, L’Énergie humaine, Le Seuil.
Nous portons tous sur nos voisins européens des regards et des jugements plus
ou moins a priori, telles des « images d’Épinal ». Certains événements,
impressions ou rumeurs nous ont incités à porter de tels regards, à les figer et,
sans plus se poser de questions, à les perpétuer au risque de nous fourvoyer et
1
Originalement cette série d’articles incorporés à une nouvelle rubrique des Cahiers européens d’Houjarray ont
été publiés sous forme de livre aux Editions Hachette Education.

3
d’offenser. Nous devons sortir de ces « images » pour mieux nous comprendre.
La connaissance mutuelle est la base du respect des uns envers les autres et par-
delà, de l’entente.
Cette entente est le socle de la paix que les peuples européens, après des siècles
d’affrontements, veulent et doivent préserver pour eux-mêmes et les
générations futures.
Alors que les pays européens sont amenés à partager de plus en plus un destin
commun, il nous a paru intéressant, bien que de façon non exhaustive, de
contribuer à cette connaissance réciproque au travers des cheminements
historiques, de réflexions sur l’histoire de la citoyenneté et sur la culture.
L’ambition de cette série d’articles va au-delà. Nous souhaitons aussi faire mieux
comprendre la portée historique de la construction européenne, la place que
l’Europe pourrait et devrait tenir dans le monde si elle était plus unie, si ses
différentes composantes voulaient bien admettre que chacun serait « plus » dans
un ensemble européen qui, tout en respectant les différences, serait plus
cohérent.
Il nous a paru nécessaire avant d’aborder l’histoire de la citoyenneté des quinze
pays de l’Union d’expliquer quelques notions préalables.
Notions et définitions préalables
« L’Union européenne repose sur un large éventail
de valeurs, qui plongent leurs racines dans
l’Antiquité et le Christianisme et qui, au fil de
deux mille ans, ont évolué pour former ce que
nous considérons aujourd’hui comme les
fondements de la démocratie moderne, de l’État
de droit et de la société civile. » Vaclav Havel
2
« C’est dans le gouvernement républicain que l’on
a besoin de toute la puissance de l’éducation. La
vertu politique est un renoncement à soi-même,
qui est toujours une chose pénible. »
Montesquieu
3
2
Extrait de l’allocution du Président de la République Tchèque au Parlement européen de Strasbourg le 8 mars
1994.

4
Dans les communes de France, sous la Révolution française, les habitants
s’apostrophaient en s’appelant « citoyens » et non Monsieur ou Madame. Ce mot
était chargé de sens. Que voulait-il dire ? Il signifiait que l’on était un habitant
de ce pays, bénéficiant de ce fait de droits et de libertés. En contrepartie, il
vous incombait des devoirs.
Les pays de l’Union européenne sont des démocraties. Ils ont des « traditions
constitutionnelles communes »
4
, même s’ils sont riches de diversités exprimées
dans leurs Constitutions
5
, notamment sur la conception de la nation. Mais si l’on
se réfère aux valeurs démocratiques, ce sont tous des États de droit
6
avec des
systèmes parlementaires et une séparation des pouvoirs. L’affirmation du
respect des droits de l’homme est constante. Le mot citoyen se traduit de
différentes façons selon les pays, mais il a, dans les grandes lignes, pour les
raisons que nous venons de citer brièvement, une signification semblable. Depuis
la signature du traité sur l’Union européenne (Maastricht, 7 février 1992), si l’on
possède la nationalité d’un pays membre, on est citoyen européen. Il en découle
des droits et des libertés, ainsi que des devoirs.
Citoyen, citoyenneté, nous verrons ultérieurement comment ces mots se
traduisent dans les quinze pays de l’Union européenne que nous étudions. Mais il
est d’ores et déjà nécessaire de préciser ces notions en français et de souligner
les nuances qui existent entre la citoyenneté proprement dite, qui est liée au
contenu des textes constitutionnels, et un comportement dit civique qui est
respectueux des personnes, de leurs biens et de l’environnement.
« La citoyenneté est la qualité de la personne disposant dans une communauté
politique donnée de l’ensemble des droits civils et politiques. »
7
Aujourd’hui, la
citoyenneté est abordée en tant que système de valeurs à concrétiser dans des
actes, et aussi comme un ensemble de pratiques sociales.
Dans les nations démocratiques telles que les nôtres, l’État et les institutions
politiques donnent corps à la nation. L’État intègre les populations en une
communauté de citoyens, dont l’existence légitime l’action. Il n’y a pas de
3
De l’esprit des lois.
4
Traité sur l’Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992.
5
Constitution : ensemble de règles écrites qui déterminent la forme de l’Etat (unitaire ou fédéral), la
transmission et l’exercice du pouvoir.
6
Ensemble des rapports politiques et sociaux soumis au droit.
7
Dictionnaire Larousse

5
citoyens sans État et pas d’État démocratique sans citoyens. Ils sont
inséparables.
Droits et devoirs afférents aux citoyens
Alors qu’est-ce qu’un comportement de citoyen ? C’est le comportement de celui
qui, appartenant à une communauté politique donnée, en suit les règles et
participe à la vie démocratique.
En quoi consistent-t-ils ?
D’après le Traité d’Amsterdam (article 6, Titre premier), « l’Union est fondée
sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de
l’Homme
8
et des libertés fondamentales, ainsi que de l’Etat de droit, principes
qui sont communs aux Etats membres ».
Quels sont les droits essentiels et les libertés ?
Après les Grecs et les Anglais, les philosophes du XVIIIe siècle, de l’époque dite
des Lumières et de la Révolution française, sont pour une grande part à l’origine
de ces droits. Au XIXe siècle, les mouvements des chrétiens sociaux ont de
même exercé une influence marquante. Au XXe siècle, les luttes syndicales ont
été déterminantes pour les conditions de travail.
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » (1er article de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789 – Déclaration universelle
des Droits de l’Homme, 10 décembre 1948). Le texte fondamental se poursuit et
parle des droits « naturels et imprescriptibles » que sont « la liberté, la
propriété, la sûreté (au sens de sécurité), la résistance à l’oppression » avant de
passer à leurs conséquences pratiques, tout en rappelant que « La liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (art. 4, 1789).
Citons les droits considérés actuellement comme essentiels:
– droit à la nationalité (ONU, 1948) ;
– droit de vote ;
– droit d’expression (penser, dire et écrire) ;
– droit à l’information ;
– droit à l’instruction ;
– droit de propriété ;
8
Convention européenne des droits de l’Homme signée à Rome le 4 novembre 1950 et ratifiée par les pays
membres du Conseil de l’Europe.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
1
/
50
100%