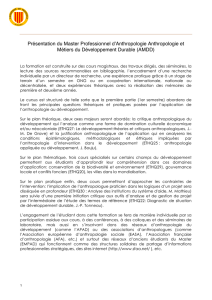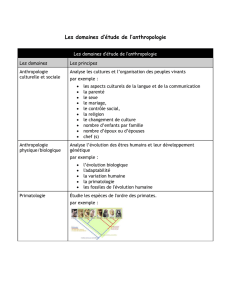Anthropologie et enseignement de l`architecture, quels enjeux

1
Anthropologie et enseignement de l’architecture, quels enjeux ?
Jean-Louis Genard
Ce court texte entend, à partir de la lecture des différentes contributions à cet ouvrage,
répondre à la question suivante : que peut impliquer, pour l’enseignement de l’architecture,
l’intégration d’un souci anthropologique ? Et, le cas échéant, en quoi cela peut-il poser
question ?
Les textes qui précèdent invitent à donner à ces questions plusieurs réponses.
Etymologiquement, l’anthropologie est, bien entendu, la connaissance de l’homme. Toutefois,
au-delà de cette signification très large qui pourrait, à vrai dire, en faire la discipline centrale
des « sciences humaines », le sens du mot « anthropologie » s’est infléchi pour prendre des
accentuations plus spécifiques. Un détour par une évocation de ces fluctuations sémantiques
n’est d’ailleurs pas sans intérêt.
Ainsi, encore que cette signification soit aujourd’hui en net déclin, oppose-t-on quelquefois
l’anthropologie à la sociologie au sens où la première s’intéresserait aux sociétés non
occidentales, voire aux sociétés en développement, là où la sociologie s’emploierait plutôt à
connaître les sociétés dites « développées » ou « industrialisées ». Hérité de découpages issus
du 19e siècle, historiquement attaché à un pensée évolutionniste, ce partage appartient sans
doute à la même configuration intellectuelle qui, au niveau de l’architecture , entendait
imposer aux colonies des formes et des partitions de l’espace obéissant à des logiques
occidentales.
Cette distinction, encore présente dans les découpages universitaires, fait aujourd’hui de
moins en moins sens, si du moins on la réfère à sa seule distinction d’objets. Comme
Balandier a pu initier une déconstruction de ces clivages en proposant une sociologie des pays
africains, Marc Augé et bien d’autres se sont proposé de soumettre les pays occidentaux au
regard anthropologique. Beaucoup ont vu dans ce mouvement le résultat de contacts de
cultures, et surtout de la pression exercée par les logiques occidentales sur l’ensemble de la
planète au point de conduire à une situation où plus aucune culture ne demeure intelligible
sans qu’il ne soit fait au moins en partie référence aux standards culturels occidentaux et sans
qu’il ne soit tenu compte des processus de domination dont les cultures non occidentales sont
victimes. A une certaine anthropologie, il fut alors reproché de cultiver une nostalgie pour une
réalité socio-culturelle, celle des sociétés « archaïques », à vrai dire en voie de disparition. Et,
surtout, une nostalgie qui contribuait à occulter ce qu’il en était réellement de ces sociétés qui
étaient depuis longtemps passées d’un statut de sociétés « archaïques », entretenant volontiers
les rêveries exotiques et les mythes du bon sauvage, vers le statut, à vrai dire peut-être moins
enviable, de sociétés « en voie de développement ». Bref, l’anthropologie était là accusée de
participer d’un processus de mythification d’une réalité dont l’historicité et l’oppression se
trouvaient ainsi gommées.
Cette première mise en question n’a toutefois pas discrédité absolument la distinction entre
anthropologie et sociologie. Elle a plutôt contribué à la faire évoluer. A observer les usages du
mot « anthropologie » dans les arènes académiques, il me semble que la spécificité du point
de vue anthropologique s’est alors en effet progressivement déplacée de l’objet analysé vers le
type de regard induit par une méthode qui se serait éprouvée et aiguisée dans l’analyse des
cultures archaïques, sans qu’il n’y ait de raison d’en exclure la culture occidentale. Formé à

2
l’analyse de cultures de plus en plus introuvables, le regard anthropologique se serait en
quelque sorte alors retourné vers ses cultures d’origine. Observation distanciée mais
empathique, patience de l’intégration dans des milieux d’abord inconnus, souci du détail
culturel… le regard anthropologique contribuera à interroger les habitudes des sociologues.
Ce nouveau glissement sémantique obéissait sans doute à la même logique que celle qui fit
qu’en architecture on en vint à récuser l’impérialisme de modernisme ou du fonctionnalisme
occidental et à prôner une architecture plus soucieuse du régionalisme ou du lieu.
Si cette nouvelle anthropologie prendra d’abord des objets qui paraîtront se rapprocher de
ceux qui étaient les terrains privilégiés de l’anthropologue-ethnologue, elle n’hésitera pas par
la suite à prendre pour objets les symptômes les plus criants du capitalisme avancé. A
l’anthropologie des zones rurales et des quartiers ouvriers victimes du déclin du capitalisme
industriel, se substitueront vite des analyses anthropologiques des Mac Dos ou du Web.
Là où la première évolution sanctionnait les effets de la domination culturelle occidentale sur
l’ensemble du monde et, en particulier, sur les terrains privilégiés des anthropologues, la
seconde, plus récente, était plus profondément épistémologique. Elle invitait, comme le
suggèrera Bruno Latour, à interroger le grand partage entre les modernes et les non modernes,
et, proposait, en tout cas méthodologiquement, d’instaurer un principe de réversibilité ou de
symétrie entre cultures, pour reprendre le vocabulaire de celui pour qui nous n’avons jamais
été modernes. Saisir donc les sociétés occidentales avec le regard du non occidental. Mais
aussi, le cas échéant, entamer avec l’Occident un grand travail de déconstruction des mythes
et des illusions à l’image de ce que le colonialisme d’abord, une bonne conscience paternaliste
ensuite, avaient tenté d’opérer avec les peuples non occidentaux. Après avoir servi de caution
au colonialisme, après avoir, en réponse, flirté avec la culpabilité de l’Occident ou les
sanglots de l’homme blanc dont nous a parlé Pascal Bruckner, l’anthropologie prenait là le
risque de surfer sur la grande vague du relativisme culturel, que celui-ci soit différentialiste (à
chacun une micro-culture, valorisable en soi et qu’il s’agit de préserver) ou indifférentialiste
(tout est somme toute intéressant et défendable).
Que retenir de ces significations et de ces glissements sémantiques ? Du premier sens, très
certainement un souci pour les différences sociales et culturelles, pour le multiplicité des
cultures et, éthiquement, pour le respect de l’autre. Du second, une certaine humilité à l’égard
des repères culturels occidentaux et l’exigence du décentrement dans la communication avec
l’autre.
S’il est une leçon à retenir pour l’architecte et pour l’enseignement de l’architecture, ce serait
donc celle-là.
Mais sans doute l’anthropologie peut-elle nous en apprendre beaucoup plus. Pour le
comprendre, peut-être alors faudrait-il dépasser cet enfermement de la question de la
définition de l’anthropologie dans celle de la tension entre l’Occident et le reste du monde.
Car la leçon de l’anthropologie se situe somme toute aussi à un autre niveau qui me paraît
essentiel pour l’architecte. Ce niveau nous tirerait peut-être alors autant vers ce qui est le
terrain privilégié de l’anthropologie philosophique que vers celui d’une anthropologie conçue
selon les modèles évoqués précédemment.
Tout d’abord, comme l’ont montré plusieurs des articles qui précèdent, l’anthropologie nous a
appris à quel point la culture représente un analyseur pertinent de la réalité. Des années 50 aux

3
années 70, l’anthropologie avait continué à chercher à nous en convaincre. Durant cette
période donc, où un marxisme étroitement matérialiste tendait à discréditer toute approche qui
entendrait aborder le social par la culture ou préserver une relative autonomie pour les faits
culturels. Contre ceux qui pensaient avoir résolu définitivement la question de l’antériorité de
l’œuf sur la poule ou de la poule sur l’œuf, l’anthropologie nous convainquait que la réalité la
plus matérielle était aussi cognitive. On se rappelle par exemple les extraordinaires travaux du
premier Bourdieu sur la maison kabyle. L’anthropologie nous apprenait là que, dans les
pratiques, dans les objets, il y avait et il y a de l’esprit. Qu’une habitation, un détail
d’architecture, une formule de distribution, une échelle,… que tout cela qui se matérialise est
porteur de cognitions. Pour l’architecte comme pour l’usager. Au-delà donc de l’indispensable
préoccupation pour les autres cultures, le regard anthropologique nous invite à faire de cela
une question, une occasion de réflexivité. Apprendre à saisir l’esprit dans les matériaux, dans
les agencements d’espaces, dans les objets… La manière aussi au travers de laquelle, par les
gestes de l’artisan, par les techniques et les matériaux utilisés,… ces cognitions s’objectivent
dans les configurations spatiales. Cette leçon de l’anthropologie ne peut qu’inviter l’architecte
à réfléchir et à verbaliser ces cognitions qui s’inscrivent dans les objets qu’il dessine et qu’il
conçoit. Des cognitions que souvent nous ne voyons que lorsque nous sommes aidés par la
distance culturelle. Réfléchir ce que nous mettons dans nos gestes architecturaux, comprendre
les significations que les maîtres d’ouvrage prêtent au vocabulaire qu’ils utilisent lorsqu’ils
disent les mots de l’architecture. Bref, là se fonde l’exigence d’une attitude architecturale
réflexive et communicationnelle. Apprendre à verbaliser le non-dit, mais aussi entrer dans des
formes de communication avec le maître d’ouvrage qui lui permettent d’exprimer ce que sont
ces attentes. Et une telle attitude nécessite certainement une vigilance, une attention à ces
petits riens dans lesquels l’autre se révèle, dans lesquels aussi nous pouvons lui faire violence.
Ce que nous a aussi appris l’anthropologie –et qui d’une certaine façon ne fait qu’amplifier ce
qui précède- c’est, depuis sans doute les travaux de Marcel Mauss, l’importance du corps dans
le rapport à l’espace. Le texte d’A.M. Vuillemenot y insistait avec force. A quel point la
construction de l’espace est liée à la socialisation du corps. La leçon de l’anthropologie
rencontre là celle de la phénoménologie.
Or, à ce niveau, la culture occidentale, au travers de son processus de rationalisation, est
certainement responsable d’un oubli ou d’une occultation. Le grand travail d’abstraction de la
modernité a fait de l’espace une donnée avant tout mathématique, déconnectée de ses
ancrages corporels. L’espace est désormais dans la mesure, les proportions, les gabarits…
C’est cet oubli que nous rappelle l’anthropologie, comme aussi la phénoménologie de Husserl
d’abord, de Patocka et de Merleau-Ponty plus tard. Peut-être devrions-nous réfléchir alors au
fait que le corps est un des grands oubliés de l’enseignement de l’architecture, oublié du
moins dès lors qu’il ne s’agit plus du corps objectivé, tel que nous le met en scène le Modulor.
Que pourrait toutefois signifier une redécouverte du corps dans l’enseignement de
l’architecture ?
Comme je l’évoquais, au-delà de l’exotisme de leur découverte, la confrontation à d’autres
cultures est toujours susceptible de nous obliger à un retour réflexif sur nous-mêmes. En
particulier, sur ce que la familiarité nous empêche de voir chez nous. La socialisation du corps
appartient en effet à ce que les sociologues, à la suite de Berger et Luckman, appellent la
« socialisation primaire », celle dont les contenus sont à ce point incorporés qu’ils se
transforment en « seconde nature » et échappent ainsi à la réflexivité. Alors que des
environnements familiers ne cessent de nous conforter dans nos évidences, la confrontation à
l’altérité est seule susceptible d’interpeller ce qui demeure autrement ininterrogé. J’évoquerais

4
ici l’expérience de la montée des pyramides pré-colombiennes du Mexique qui, à elle seule,
suffit à nous persuader que nos escaliers sont une construction sociale ; que somme toute
aucune nécessité corporelle ni fonctionnelle ne préside aux mesures de leurs marches ni à la
déclivité de leurs pentes. Gravir une pyramide mexicaine induit une insécurisation de notre
corps d’occidental qui, dans certains cas, confine au vertige. C’est là une expérience qui nous
oblige à faire retour sur nous-même, à prendre conscience de contraintes insoupçonnées et,
dès lors, à les rejeter ou à les assumer mais cette fois, en raison. Ce qui est vrai des escaliers,
l’est évidemment aussi de beaucoup d’autres choses. Pénétrer certaines cases africaines oblige
à une gestuelle qui ne nous est pas familière et qui nous apprend à quel point la socialisation
du corps, en ancrant des habitudes, ferme aussi toute une série de possibles. Ainsi, en
Occident, avons-nous totalement perdu un sens de l’accroupissement qui se trouve souvent
mobilisé dans d’autres cultures, participant d’ailleurs d’une identification des sexes (parce que
les femmes ne s’accroupissent pas comme les hommes), de rituels de sociabilité (parce que
c’est accroupis que l’on palabre) ou encore de pratiques professionnelles. Dans ces deux
exemples de l’escalier pré-colombien et de la case africaine, on voit très bien en quoi le corps
et l’architecture obéissent à des logiques congruentes, la socialisation de l’un confortant les
logiques de l’autre. L’escalier mexicain conforte une manière de gravir les marches très
différente de la nôtre qui appelle à ce que les escaliers soient comme ils sont, comme la case
africaine rend nécessaire et ainsi reproduit une manière de se tenir mais aussi une souplesse
d’articulations qui dans d’autres cultures « s’atrophie » ou se « sclérose ».
Par rapport à ces questions, l’expérience du handicap peut également être très éclairante.
Notre architecture comme notre urbanisme sont, contrairement aux pays d’Europe du Nord,
largement conçus sans souci de ce que nous appelons maintenant volontiers des « personnes à
mobilité réduite ». A l’inverse, comme nous l’avons fait à la Cambre l’année académique
passée, la mise en situation des étudiants (invités à user de la chaise roulante dans des univers
familiers, placés dans des situations d’orientation dans le noir…) oblige à une prise de
conscience des implications corporelles et sociales des choix architecturaux.
Si l’anthropologie nous invite à reposer la question de l’architecture à partir de celle du corps,
il reste à se demander comment rendre le corps plus présent, plus actif dans l’enseignement de
l’architecture. Peut-être, en plus de la confrontation matérielle à d’autres cultures à l’image de
l’expérience relatée par J.P.Pouhous dans cet ouvrage, la dimension « corporelle » de
l’enseignement de l’architecture pourrait-elle tirer parti d’une immersion des étudiants dans
des disciplines artistiques qui seraient plus physiques que l’architecture. Si on la compare aux
autres arts, à la danse bien sûr, mais aussi à la sculpture, à la peinture… l’architecture apparaît
en effet comme un art bien peu physique. L’architecte, dessinant des plans, écrit davantage
des partitions qu’il ne les joue. Et le dessin lui-même prend de plus en plus, nouvelles
technologies obligent, les voies de la dématérialisation. Cela peut paraître anodin, mais ces
dimensions sont de fait significatives. Et, peut-être l’enseignement de l’architecture gagnerait-
il à les assumer, par exemple en poussant l’étudiant à découvrir ces pratiques artistiques
manifestement « plus près du corps », ou à fréquenter davantage le jeu de la partition (c’est-à-
dire le travail matériel, le chantier…) que sa seule écriture.
Ce qui est vrai de la socialisation corporelle, l’est évidemment aussi des formes de sociabilité,
des manières de vivre. Celles-ci s’inscrivent dans l’espace et dans l’architecture comme le
montrent les contributions à ce numéro des Cahiers de la Cambre. Une inscription qu’il faut
donc comprendre, mais sans pour autant se méprendre sur les liens entre formes
architecturales et pratiques sociales : des liens qui, indéniablement existent, mais qu’il ne faut
toutefois pas interpréter sur un mode exagérément déterministe. L’architecture ne détermine

5
pas la violence même si elle peut la faciliter. Les travaux de J. Jacobs sur les métropoles
américaines nous l’ont suffisamment montré : de mêmes formes architecturales peuvent
parfaitement induire des formes d’appropriation et de sociabilité très différentes, même si
certaines formes spatiales manifestement sont susceptibles de favoriser telle ou telle formes
sociales.
Entendons-nous bien toutefois. La compréhension de l’autre est bien sûr indispensable à
l’architecte qui entend construire dans d’autres cultures ou pour d’autres cultures que la ou les
siennes. Mais cela n’implique en rien le nécessaire respect de ces formes architecturales
« autochtones ». Ainsi, la domination, par exemple celle de la femme si présente dans les
cultures évoquées dans cet ouvrage, peut-elle, elle aussi, s’inscrire dans l’espace. Là, bien
pensée, la rupture avec les formes architecturales peut s’avérer un acte politique comme la
prise en compte des réalités anthropologiques des sociétés colonisées fut à coup sûr un acte
politique émancipateur. Toutefois, là encore, de tels gestes nécessitent une compréhension
fine de la réalité sociale tant des actes de rupture insuffisamment réfléchis peuvent engendrer
des « effets pervers », et faire de gestes supposés libérateurs l’envers de ce qu’ils prétendaient
être. C’est ce que montre un des textes consacrés à l’architecture marocaine.
Autrement dit, l’indispensable compréhension anthropologique doit constamment veiller à ne
pas céder à la fascination de l’exotisme sous quelque forme que ce soit. Pas plus d’ailleurs
qu’à la défense emphatique d’une authenticité que viendrait menacer la modernité. Nous
savons à quel point son adoption par l’extrême-droite a pu mettre en évidence les ambiguïtés
d’une défense inconditionnelle de l’authenticité.
Ce que nous apprend l’anthropologie ne doit donc pas s’arrêter à la compréhension de l’autre
mais s’ouvrir à une réflexivité sur nous-même comme aussi sur ceux dont nous découvrons
les réalités. Et l’horizon de cette réflexivité ne doit pas cesser d’être guidé par des intuitions
éthiques ou politiques émancipatrices. Connaître l’autre bien sûr, le respecter assurément,
mais, d’autant qu’il s’agit d’un « art appliqué », l’architecture ne peut oublier la dimension
éthique et politique des gestes qu’elle pose. Ce n’est qu’à condition d’éviter les pièges, que ce
soit ceux du mépris et de l’indifférence mais aussi celui de l’émerveillement, que
l’anthropologie et l’architecture pourront participer d’un processus émancipateur.
1
/
5
100%