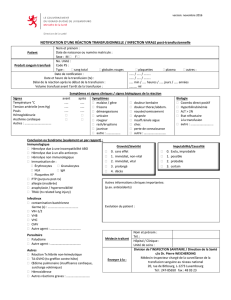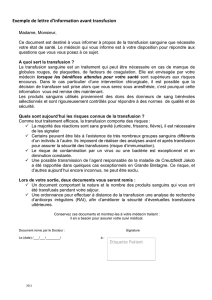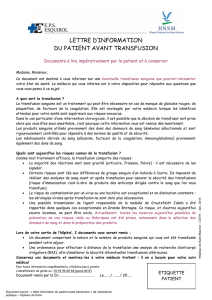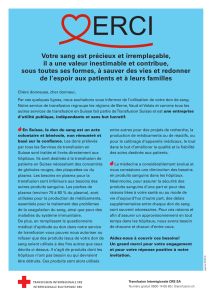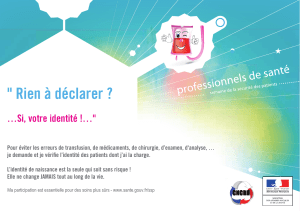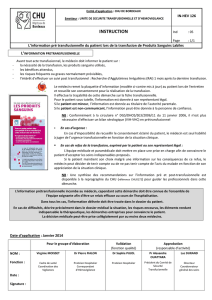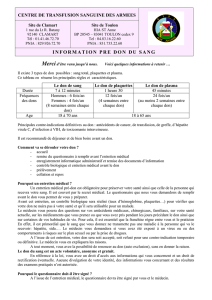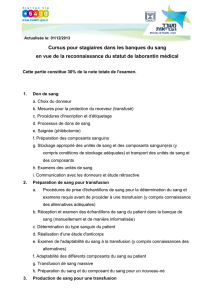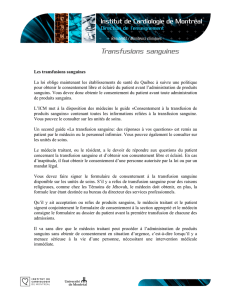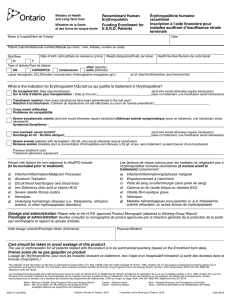Transfusion massive

Transfusion sanguine
et les complications de Transfusion
Massive(TM)
Une transfusion sanguine est une opération consistant à injecter, par perfusion
intraveineuse, du sang ou des dérivés sanguins.
La transfusion sanguine est très ancienne : l'histoire des anciens Égyptiens et le
Traité d’anatomie d'Hérophile en font mention. Au {{XVe siècle}}, le pape Innocent
VIII aurait été soumis à ce traitement. Dans la plupart de ces tentatives, le sang
employé était d’origine animale. La première transfusion historiquement authentifiée
est celle pratiquée le 15 juin 1667, par Emmeretz, médecin du roi de France, sur un
garçon de 16 ans au moyen de sang d’agneau. La même année, Emmeretz et son
confrère Denis effectuaient la première transfusion d’homme à homme en reliant
l’artère d’un des sujets à la veine de l’autre. La diffusion du procédé entraîna de
nombreux accidents et la transfusion fut frappée d’interdiction en 1670. Au {{XXe
siècle}}, la détermination des groupe sanguin groupes sanguins, à la suite de Karl
Landsteiner (1868-1943) qui a découvert système ABO en 1901, résolvait enfin
beaucoup de problèmes. C'est Charles Richard Drew qui conceptualisa et organisa la
première banque du sang, qui permis d'apporter du sang aux Grande-Bretagne
Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale, entre 1940 et 1941.
Maintenant, la transfusion sanguine est déjà devenue une méthode thérapeutique.
Transfusion de produits sanguins,par example, les érythrocytes, les facteurs de
coagulation, les plaquettes,les plasma..., est regardé plus efficace à diminuer les riques,
qui sont d'origine immunologique, infectieuse, ou liés aux volumes transfusés...,
l’Utilisations
l’Anémie et la restauration de la volume circulant
La transfusion sanguine est le traitement de choix en cas d'anémie importante
(Hb<6g) pouvant mettre en jeu le devenir du patient .
Dans le cas d'une perte de liquide corporel alors qu'il n'y a pas ou peu de
diminution du volume de globules rouges (membres écrasés, brûlures graves,
déshydratation...), les globules rouges ne sont pas nécessaires. On utilise dans ce cas
des liquides, dits de remplissage, faite de macromolécules de synthèse, qui permettent
de rétablir le volume circulant.
Corriger la coagulation anormal
Les facteurs sanguins de coagulation sont prescrits dans le traitement de certaines
maladies sanguines héréditaires comme l'hémophilie. Ces produits ne sont pas
exempts de risques infectieux, ce qui en limite leur prescription dans des cas bien
précis. Les recherches portent actuellement sur la production actificielle de ces
facteurs. Chez certains patients, le taux de thrombocytes (éléments sanguins

contribuant à prévenir ou à stopper l'hémorragie et participant au processus de
coagulation) est parfois dangereusement bas, exposant à un risque important
d'hémorragies. C'est le cas en particulie lors de certaines ''chimiothérapies de cancer,
mais aussi lors de certaines maladie du sang. Ces patients peuvent recevoir une
transfusion de plaquettes afin de normaliser la coagulation.
Remplisser l’albumine sanguine
Bien qu’il s’agisse du produit de remplissage le plus durablement efficace, ses
indications ont diminué. Les indications de l’albumine dans le cadre des transfusions
massives sont toutes des indications de seconde intention qui dépendent des limites
d’utilisation des cristalloïdes et des colloïdes ou de leur contre indication (femme
enceinte). L’albumine sera utilisé en première intention devant :
- l’existence d’une hypoprotidémie vraie inférieure à 35 gr/l. En effet, sa fonction
première est le maintien de la pression oncotique
- la chirurgie hépatique
- les brûlures.
Depuis les conférences de consensus et d’experts récents, les indications ont
diminué. En donner trop ou trop souvent expose à des effets délétères :
- accumulation pulmonaire en cas de troubles de la perméabilité capillaire,
- insuffisance rénale hyper-oncotique.
La transfusion(d’albumine) peut aider de rétablir la meilleure defense du systeme
immunitaire chez les patients, sur tout les brulures, pour leur aider de lutter contre les
infection et faire la répétition du plaie.
Les risques et les complications générales
Le risque transfusionnel existe, mais reste par définition inférieur au risque de n'être
pas transfusé si l'indication de cette dernière a été posée. Les risques sont d'origine
immunologique, infectieuse, ou liés aux volumes transfusés :
* Réaction fébrile non hémolytique RFNH
Cette réaction est fréquente et présente de multiples étiologies (1 à 20 %).
Classiquement, c’est une immunoréaction à partir d’anticorps antileucocytaires.
Plus récemment, il est mis en évidence des réactions purement initiées par des
protéines plasmatiques. Ces réactions sont des diagnostics d’exclusion du fait que
la fièvre accompagne toutes les autres complications transfusionnelles (infection,
accident hémolytique…). Ces réactions fébriles peuvent également précéder une
insuffisance respiratoire aiguë “Acute Lung Injury” (ALI).
* Maladie du greffon contre l’hôte :
Cette complication se rencontre au cours de certaines circonstances favorables :
patient immunodéprimé, en transfusion néonatale avec du sang des patients, la
transfusion massive, la transfusion des membres de même famille. Cet accident
est lié à la prolifération de certains lymphocytes T du receveur chez le donneur.
Cette complication est grave car elle s’accompagne de taux élevés de décès : 80 à
90 %. La prévention passe par l’inactivation des poches de sang avec 15 Gray
avant la transfusion à des patients immunodéprimés ou prématurés.

* Hémolyse
Intravasculaire, et occasionnée encore trop souvent par une incompatibilité
ABO, qui est souvent grave, et que ne devrait plus se voir, car parfaitement
évitable, et toujours dû à une erreur humaine. Elle peut se voir dans les
transfusions massives (le risque d’erreur est plus important), bien qu’une très
faible quantité de sang (50 ml) suffise à la provoquer. La survenue d’un épisode
hémorragique au bloc opératoire, lors d’une transfusion, peut constituer le
premier signe révélateur d’un accident transfusionnel, notamment chez le patient
sous anesthésie générale. Elle se traduit alors le plus souvent par une CIVD.
* Le T.R.A.L.I
l’Incompatibilité leuco-plaquettaire, due à la présence d'anticorps anti HLA
chez le donneur, qui peut entrainer une atteinte pulmonaire grave, le T.R.A.L.I,
acronyme anglais (transfusion related acute lung injury), pour atteinte
pulmonaire aigüe transfusionnelle. L’ALI est due le plus souvent à des anticorps
anti-HLA dans le sang du donneur. La prévention de l’aggravation de ces
accidents passe par le lavage des globules rouges et la recherche des anticorps
anti-HLA chez tout transfusé compliqué d’ALI.
* Le purpura post transfusionnel, plusieurs jours après une transfusion de
plaquettes homologues. Le malade détruit ses propres plaquettes.
* Les risques infectieux :
- risque bactérien, dû à la contamination bactérienne du produit transfusé. Ce
type d'accident est rare, mais très grave.
- risque de contamination virale (hépatite virale hépatites, CMV, HIV...). Les
maladies à prion (protéine) prions posent d'autres problèmes non résolus
directement. On minimise ces risques en tentant de détecter les porteurs de
virus, de rejeter les donneurs à risque, et surtout, en maintenant une traçabilité
des dons.
* Le surcharge transfusionnelle, qui peut entrainer un O.A.P. oedème aigu du
poumon, par excès de volume en circulation. Hypocalcémie due à la surcharge
en citrate.
* Hémochromatose, par surcharge en fer, après des centaines de transfusions.
Transfusion massive
Definition :
La transfusion massive se définit comme étant le renouvellement d’une masse
sanguin par un apport transfusionnel supérieur à 10 C.G.R. Une transfusion rapide,
supérieure à 100ml/min, pendant plusieurs minutes est aussi considéré comme une
transfusion massive. Cette compensation transfusionnelle est indispensable à la survie
des patients, que ce soit dans un contexte médical, chirurgical ou traumatique. Quelle
que soit la situation, une réponse rapide et efficace est essentielle. Chacun, médecin,
et infirmier, doit connaitre son role et la conduite à tenir pour qu’une stratégie efficace

se mette en place autour du patient afin de faire face à l’hémorragie.
Complication :
Ses complications sont bien connues et doivent être prévenues : hypothermie, troubles
hydro-électriques (hyperkaliémie, hypocalcémie), troubles de l’hémostase (dilution
des facteurs de coagulation et des plaquettes). Elles sont liées à la quantité et à la
qualité du sang transfusé. En effet, le sang homologue étant froid, acide, riche en K, en
citrate, en agrégats plaquettaires, pauvre en plaquettes, en 2.3DPG, en facteurs de
coagulation, en Ca++ ionisé, la substitution massive va générer des désordres de
l’homéostasie et des modifications d’accompagnement (déséquilibre
hydro-lectrolytique et thermique). Si on ne prévient pas ces complications, il peut
survenir un véritable syndrome de transfusion massive, par définition iatrogène, qui
aggrave le pronostic vital.
HYPOTHERMIE
Le maintien d’une température normale permet de préserver l’hémostase et de diminuer les
pertes sanguines durant la période périopératoire. Les produits sanguins sont conservé à 4℃.
Quand la grande quantité de sang froid, non-rechauffé, est transfusé par la voie intraveineuse dans
le corps, il va provoque évidement l’hypothermie. Chez l’animal, il a été bien démontré que
l’hypothermie ralentit l’activité enzymatique de la cascade de la coagulation, réduit la synthèse
des facteurs de la coagulation, augmente la fibrinolyse et diminue le décompte et la fonction
plaquettaire. l’hypothermie est aussi lié au métablisme hépatique du citrate, à l’elevation légère de
la dissociation oxygenique, etc... Ces anomalies sont cliniquement significatives : une
hypothermie modeste (35 ± 0,5 °C) augmente le saignement et les besoins transfusionnels en
chirurgie de la hanche. L’hypothermie contribue de manière importante à la dysfonction
hémostatique du polytraumatisé. Dans l’étude de Ferrara et coll., le saignement et la mortalité
étaient plus importants chez les polytraumatisés hypothermiques (< 34 °C) et acidotiques et ce
malgré une thérapie de remplacement appropriée. Le clinicien devra se rappeler qu’il est facile de
sous-estimer la contribution de l’hypothermie à la diathèse hémorragique car, habituellement, les
tests de coagulation sont réalisés à 37 °C.
CITRATE ET CALCIUM IONISE
L’intoxication par le citrate est possible quand le débit de la transfusion dépasse l50
ml/min, voire moins en cas d’atteinte hépatique associée. Sa conséquence en est la
baisse du caicium ionisé. Il n’existe pas de corrélation entre le taux du citrate
plasmatique et les anomalies de la coagulation, pas plus qu’avec l’intensité du
saignment.
Il est classique de considerer que l’arrêt cardiaque secondaire à une déplétion
calcique profonde survient avant qu’on ait pu mettre en évidence des troubles de
l’hémostase.
TROUBLES HYDROELECTROLYTIQUES ET ACIDO-BASIQUES
La transfusion massive peut majorer ou induire une acidose métabolique en raison
du pH des produits transfusés. Le plus souvent, cette acidose est la conséquence de
l'hypoperfusion tissulaire en rapport avec la gravité du choc hémorragique. Cependant,
le plus souvent, on observe une alcalose métabolique liée à la production de

bicarbonates à partir du citrate. Les troubles ioniques associés : l'hyperkaliémie, la
baisse ou l'élévation anormale du calcium ionisé, l'hypomagnésémie, bien que rares,
doivent être recherchés systématiquement par la surveillance du ionogramme sanguin
au cours de la transfusion massive.
THROMBOPENIES
La dilution représente la cause la plus importante de thrombopénie, lors d’une
transfusion dépassant dix unités érythrocytaires. Le mécanisme en est simple : la
dilution progressive du pool plaquettaire du receveur par des apports sanguins
dépourvus de plaquettes, va provoquer une chute de la numération plaquettaire. Après
le remplacement d’une masse sanguine, seules 35 a 40 % des plaquettes demeurent en
circulation.
Chez le sujet normal, la survenue d’un accident hémorragique est possible quand la
numération devient brutalement inférieure à 50,000 plaquettes/mm3, la rapidité
d’installation de la thrombopénie primant sur le nombre absolu.
L’abandon des transfusions de sang total trouve d’ailleurs ici une explication : la
conservation du sang à 4 ℃ est responsable d’une destruction de 50% des plaquettes
à l2 heures, 90 % à 24 heures, et pratiquement 100 % au-delà de 24heures . Les unités
de sang total datant de 24 heures ou plus ne contiennent dès lors qu’une quantité
négligeable de plaquettes et ne presentent donc pas d’interêt pour la correction d’un
trouble de l’hémostase primaire. Seul le sang recueilli depuis moins de 6 heures garde
théoriquement une indication.
En l986, une Conférence de Consensus nordaméricaine tentant de codifier la
transfusion de plaquettes a permis de dégager certaines grandes notions :
- la thrombopénie de dilution représente la première cause de saignement après
une transfusion massive ou une hémodilution très prononcée;
- il n’est pas utile de transfuser des plaquettes en cas de saignement chez un
patient présentant une numération des plaquettes supérieure à 50 000/mm3 et/ou un
temps de saignement (méthode d’Ivy) inférieur à deux fois la normale, sauf si d’autres
éléments interfèrent avec l’hémostase. La prescription d’unités plaquettaires lors
d’une transfusion massive ne se fait donc qu’en présence d’un saignement et d’une
thrombopénie documentée;
- l’apport prophylactique de plaquettes n’est plus de mise, à l’exception des cas de
thrombocytopénie chronique (n ≤ 20 000/mm3) devant subir une procédure
invasive. COAGULATION INTRA-VASCULAIRE DISSEMINÉE (CIVD)
POST-TRANSFUSIONNELLE
Retrouvée dans une proportion de 30 % par Manucci lors des transfusions massives,
on lui attribue de nombreuses étiologies en rapport avec le contexte : état de choc,
sepsis, circulation extra-corporelle, etc. La transfusion de sang conservé, en délivrant
des agrégats leuco-plaquettaires, des facteurs activés de la coagulation et des
substances thrombo-plastiques, peut déclencher à elle seule une CIVD lorsque les
capacités épuratrices du système réticulo-endothélial sont dépassées.
Par rapport aux travaux anciens, la CIVD, en tous cas, n’endosse plus l’entière
responsabilité de l’irréversibilité du choc après hémorragie (ettransfusion) massive.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%