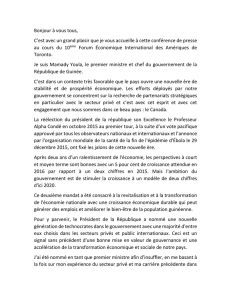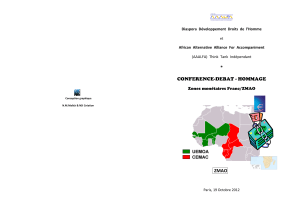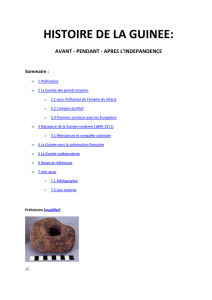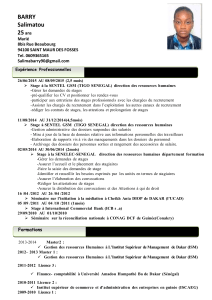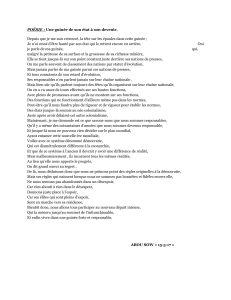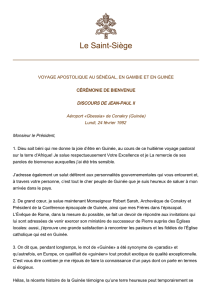webGuinée Camp Boiro Memorial webGuinée Camp Boiro

webGuinée
Camp Boiro Memorial
webGuinée
Camp Boiro Memorial
Témoignages
Sékou tel que je l'ai connu
par André Lewin, interrogé par Hamid Barrada
Jeune Afrique. Collection Plus, Juin 1984,
numéro spécial consacré à l'ancien chef d'État de la Guinée
Peu après la mort de Sékou Touré en mars 1984, le périodique "Jeune Afrique"
publiait en juin 1984, dans sa collection "Plus", un numéro spécial consacré à
l'ancien chef d'État de la Guinée, envers lequel l'hebdomadaire n'avait jamais
caché son hostilité. Le journaliste Hamid Barrada avait recueilli de la part de

l'auteur une longue interview, parue sous le titre "Sékou tel que je l'ai connu" et le
sous-titre "Il y avait deux Sékou Touré". Celle-ci sert de base au texte ci-après,
sous réserve de quelques corrections de détail, mais avec de nombreuses
adjonctions, parmi lesquelles bien des notes de bas de page. Le "portrait" tracé de
l'auteur par Hamid Barrada sous le titre "Le diplomate et le tyran" figure en
annexe.
Hamid Barrada : Vous avez sans doute été l'un des rares hommes dans le monde, à tout le moins en
dehors de l'Afrique, à pleurer Sékou Touré…
André Lewin : Il est vrai que depuis mon premier séjour en Guinée, en mars 1974, donc exactement dix
ans avant sa mort, j'étais très attaché au président Ahmed Sékou Touré; nous avons entretenu des
relations qui sont progressivement devenues amicales; dans une certaine mesure, étant donné la
différence d'âge entre nous, elles étaient même de sa part un peu paternelles; cette amitié n'empêchait
pas que je sois lucide sur ses défauts et conscient des épouvantables violations des droits de l'homme qui
se commettaient en Guinée. Il est exact que j'ai été à la fois surpris et bouleversé par sa disparition. J'ai
été particulièrement affecté, moins au cours des obsèques et des manifestations officielles, qui m'ont
paru chaotiques — les réactions étaient marquées moins par l'émotion que par la curiosité, à la seule
exception du discours du Premier Ministre Béavogui, réellement ému, presqu'en pleurs et la voix brisée
par exemple à l'évocation du mouchoir blanc que le leader disparu agitait toujours en public — qu'à
l'arrivée du corps à Conakry : 400.000 à 500.000 personnes (les deux tiers de la population de la
capitale) ont défilé de l'aéroport jusqu'au Palais du peuple. Alors, il y eut des moments d'émotion vraie.
Président Sékou Touré et l'Ambassadeur de France,
M. André Lewin

Après l'inhumation au mausolée, il m'a semblé que l'indifférence s'installait. J'ai eu cette impression
notamment le dimanche 1er avril, trois jours à peine après les funérailles. Passant devant le mausolée,
j'ai vu qu'il n'y avait aucune affluence : trois militaires nettoyaient le carrelage où se fanaient quelques
couronnes émanant des présidents de la Roumanie ou de la Corée du Nord, du personnel d'un hôtel
local, ou de la communauté libanaise de Conakry.
Vous savez que le cercueil n'a pas été ouvert, ce qui a suscité les rumeurs les plus folles. On a mis en
doute, non le décès de Sékou, mais la présence de sa dépouille, certains assurant que les Arabes,
Marocains ou Saoudiens en particulier, se l'étaient appropriée et il est vrai que l'acharnement des gardes
marocains à empêcher quiconque d'approcher le cercueil était vraiment inexplicable. Quand je me suis
trouvé, seul étranger et blanc, devant ce mausolée désert, j'ai eu le sentiment très fort que l'ère de Sékou
Touré était achevée et bien achevée.
Hamid Barrada : Comment expliquez-vous votre amitié avec un personnage comme Sékou Touré ?
André Lewin : Plusieurs facteurs ont joué, mais il est certain que le président guinéen avait, en dépit de
ses défauts éclatants, une personnalité attachante. Si je n'avais pas pu me le concilier dès nos premiers
contacts, non seulement je n'aurais pas pu mener à bien ma mission, mais je n'aurais pas pénétré la
Guinée en profondeur. L'amitié que le président avait pour moi, et qui n'était un secret pour personne,
m'a ouvert pratiquement toutes les portes et j'ai visité presque toutes les 35 régions que compte le pays.
J'ai rencontré des gens qui me faisaient confiance tout en contestant parfois les orientations et surtout
les méthodes du régime. Mes relations avec le président, auquel je parlais avec une totale franchise, ne
m'ont pas empêché d'avoir des contacts avec l'opposition en exil. Certains de ses membres m'ont
reproché d'avoir "dédouané" ou "réhabilité" Sékou, d'avoir sauvé un régime aux abois, mais la plupart
d'entre eux, après explications, se sont rendu compte que le rétablissement des relations avec la France
avait été bénéfique pour la Guinée, et positif pour la France. D'une manière générale, on me considérait
comme une sorte de phénomène, quelqu'un qui avait réussi bizarrement là où bien d'autres avaient
échoué.

André Lewin
Hamid Barrada : Au fait, comment avez-vous procédé avec Sékou, vous l'avez ensorcelé ?
André Lewin : Vous ne croyez pas si bien dire. L'un de mes amis africains m'a raconté que Sékou se
serait laissé dire par un marabout qu'un jour prochain — c'était en 1973 —, un homme blond viendrait
changer le cours des événements en Guinée. Si cette anecdote est vraie, j'aurais été dans l'esprit de Sékou
envoyé par le destin…
Hamid Barrada : Plus prosaïquement, comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la Guinée ?
André Lewin : Par hasard ! En tous cas, il n'y avait de ma part rien de délibéré à l'avance. En février-
mars 1974, alors que j'étais porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, l'Autrichien Kurt
Waldheim, j'ai accompagné ce dernier dans un périple à travers quatorze pays de l'Afrique de l'Ouest. Le
gouvernement de l'Allemagne fédérale lui avait demandé de profiter de son escale guinéenne pour
s'enquérir du sort d'un de ses ressortissants arrêté quatre ans plus tôt.
Après le débarquement du 22 novembre 1970, les autorités de Conakry avaient mis en cause la
France et l'Allemagne, et, outre de très nombreux Guinéens, un certain nombre d'étrangers furent
arrêtés, torturés, emprisonnés, parmi lesquels 25 Français, une dizaine de Libanais, trois Allemands, un
Grec, un Belge, un Tchécoslovaque, etc. L'un des Allemands, au nom doublement symbolique pour un
germanique d'Adolf Marx (le prénom d'Hitler, le nom du fondateur du marxisme !) résidait en Guinée
depuis 1963 et était directeur technique de la Brasserie de Conakry. Il était accusé d'avoir tenu des
propos contre-révolutionnaires, entreposé des armes chez lui, eu des contacts avec des ennemis du
régime, et même avoir envisagé d'empoisonner la bière de son entreprise, la SOBRAGUI, dans l'intention
de décimer la population ! Adolf Marx était au Camp Boiro depuis plus de quatre ans, et jusque là, le
gouvernement de Bonn n'avait pas réussi à avoir de ses nouvelles. A la demande de Bonn, diverses

personnalités étaient intervenues sans succès en sa faveur, dont plusieurs chefs d'État africains, Indira
Gandhi, des dirigeants soviétiques, le président américain, voire le pape… On avait même eu recours aux
services de marabouts africains; c'est ainsi que la circulation fut un jour arrêtée devant l'ambassade
d'Allemagne à Paris, avenue Franklin Roosevelt, pour laisser les sorciers opérer ! Je tiens cette anecdote
de l'ambassadeur d'Allemagne lui-même, qui m'a montré la note d'honoraires des marabouts…
Hamid Barrada : Combien ?
André Lewin : Quelques milliers de marks… Toujours est-il que tous les moyens possibles avaient été
mis en oeuvre pour connaître enfin le sort d'Adolf Marx. Les parents de celui-ci, hôteliers à Aix-la-
Chapelle, avaient déclenché une campagne pour dénoncer la "passivité" des pouvoirs publics, campagne
de presse qui avait pris une ampleur un peu comparable à celle de l'affaire Claustre en France. Le
gouvernement allemand s'était démené davantage et sans trop se faire d'illusions, avait voulu profiter du
voyage de Waldheim; ce dernier emportait donc dans ses bagages le dossier Marx et devait tenter de faire
quelque chose au cours de son périple africain qui se terminait par la Guinée…
Hamid Barrada : C'était votre premier contact avec l'Afrique noire ?
André Lewin : Pratiquement; auparavant, je n'avais été qu'au Mali, l'ancien Soudan français. Et au
début de ma carrière diplomatique, j'étais présent au Quai d'Orsay, à une place modeste, lors de la
signature par Saïfoulaye Diallo en mai 1963 de plusieurs accords franco-guinéens de coopération, qui ne
furent pratiquement pas appliqués. Avant notre arrivée à Conakry, j'avais pris soin de prévenir le
secrétaire général : "Vous savez, je suis Français, et qui plus est, diplomate français; comme les
rapports entre la Guinée et la France sont détestables depuis quinze ans, il n'est pas impossible que je
sois refoulé à l'aéroport." C'est dire que j'étais loin de me voir jouer un rôle dans la normalisation des
relations entre Paris et Conakry. Le seul qui ait envisagé cette possibilité était le général Gowon, alors
président du Nigeria, où nous avions séjourné avec Waldheim au cours de ce voyage. Nous avions évoqué
le rapprochement entre son pays et la France, auquel j'avais modestement contribué en 1972 en tant que
chef de cabinet d'André Bettencourt, premier ministre français à se rendre à Lagos après plusieurs
années de brouille dues à notre position dans l'affaire du Biafra et aux expériences nucléaires françaises
au Sahara. Le général Gowon, qui revenait lui-même de Conakry, m'avait dit : "Vous avez maintenant
une tâche plus importante devant vous, le rétablissement des relations entre la France et la Guinée."
Hamid Barrada : Vous n'aviez pas eu affaire avec Sékou Touré en tant que collaborateur d'André
Bettencourt ?
André Lewin : Si, mais d'une manière qui aurait dû me décourager ! En 1967 ou 68, André Bettencourt,
alors secrétaire d'État aux affaires étrangères, avait reçu du président Sékou Touré, qui aimait offrir ses
oeuvres un peu à tout le monde, une collection complète de ses livres, aimablement dédicacés. Sékou
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
1
/
95
100%