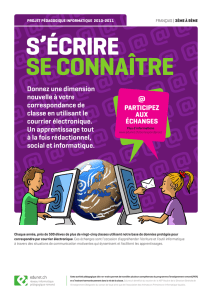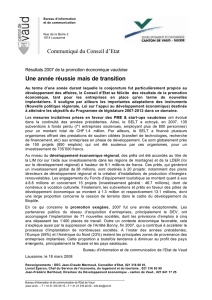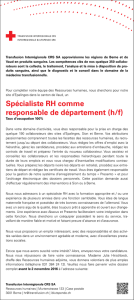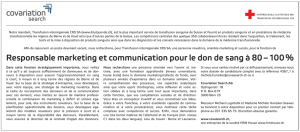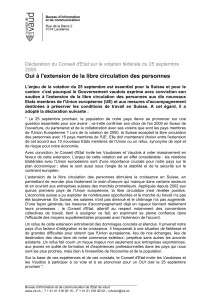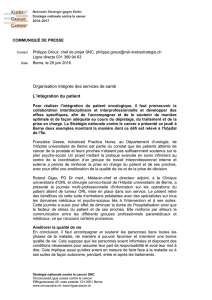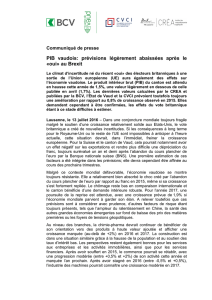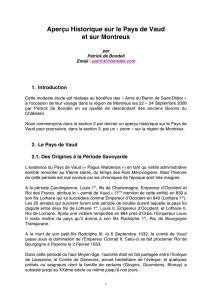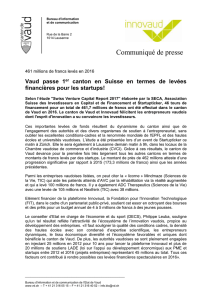Aperçu Historique

1
Aperçu Historique sur le Pays de Vaud
et sur Montreux
par
Patrick de Bondeli
Email : [email protected]
1. Introduction
Cette modeste étude est réalisée au bénéfice des « Amis du Baron de Saint-Didier »
à l’occasion de leur voyage dans la région de Montreux les 22 – 24 Septembre 2006
par Patrick de Bondeli en sa qualité de descendant des anciens Barons du
Châtelard.
Nous commençons dans la section 2 par donner un aperçu historique sur le Pays de
Vaud pour poursuivre, dans la section 3, par un « zoom » sur la région de Montreux.
2. Le Pays de Vaud
2.1. Des Origines à la Période Savoyarde
L’existence du Pays de Vaud (« Pagus Waldensis ») en tant qu ‘entité administrative
semble remonter au VIème siècle, du temps des Rois Mérovingiens. Mais l’histoire
de cette période est mal connue car les chroniques de l’époque sont très maigres.
A la période Carolingienne, Louis 1er, fils de Charlemagne, Empereur d’Occident et
Roi des Francs, attribue le « comté de Vaud » (1ère mention de cette entité) en 839 à
son fils Lothaire qui lui succèdera comme Empereur d’Occident en 840 (Lothaire 1er).
Les 25 années qui suivirent furent une période de trouble durant laquelle le pays fut
disputé entre deux fils de Lothaire 1er, Louis II, Empereur d’Occident, et Lothaire II,
Roi de Lorraine. Après une victoire remportée en 864 près d’Orbe, l’Empereur Louis
II resta maître du pays qu’il donna à son fils Rodolphe 1er, Roi de Bourgogne
Transjurane.
A la mort de son petit-fils Rodolphe III, le 6 Septembre 1032, le comté de Vaud
passe sous la domination de l’Empereur Conrad II. Celui-ci se fait proclamer Roi de
Bourgogne à Payerne le 2 Février 1033.
Dans cette période du haut Moyen-âge, l’autorité était en fait partagée entre l’Evêque
de Lausanne, le Comte de Genevois, avoué héréditaire de l’évêque, et quelques
prélats ou seigneurs dont la famille de certains (Gingins, Goumöens, Blonay) a
subsisté jusqu’au XXème siècle ou même jusqu’à nos jours.
2.2. La Période Savoyarde (1150 – 1536)

2
Au milieu du XIIème siècle les Ducs de Zähringen, Recteurs de Bourgogne
Transjurane (ils y sont seuls vassaux directs de l’Empereur) depuis 1152, cherchent
à étendre leurs états et à gagner le Pays de Vaud. Ils s’y heurtent aux comtes de
Savoie, qui avaient pris pieds dans l’Est du pays comme protecteurs de l’Abbaye de
Saint-Maurice dès le XIème siècle, et qui finissent par l’emporter.
Dès 1150, les Comtes de Savoie occupent le château de Chillon ; Aigle et Bex
dépendent d’eux avant 1179 et ils fondent Villeneuve en 1214. Cette même année,
ils se font céder Moudon par l’Empereur et l’Evêque de Lausanne.
L’extension de la domination Savoyarde sur le reste du Pays de Vaud est
essentiellement l’œuvre de Pierre II.
Notons qu’une nièce de Pierre II, Aliénor, épouse Henri III d’Angleterre, le
conquérant du Pays de Galles. Celui-ci fait construire certains des formidables
châteaux qui protègent les côtes Galloises (dont Caernarvon) par le même architecte
qui a construit le château de Chillon dans la version qui a subsisté jusqu’à nos jours.
Après la mort de Pierre II (1268), son neveu Louis complète son œuvre en fondant
les villes de Morges et de la Tour de Peilz et en conquérant Nyon et Prangins en
1293. Il s’intitule Baron de Vaud et il transmet son apanage à son fils Louis II à sa
mort en 1302. Le Pays de Vaud est racheté par le chef de la Maison de Savoie, le
comte Amédée VI à la mort de Louis II en 1349. Notons cependant que l’évêché de
Lausanne préserve son autonomie au prix d’une alliance très étroite avec la Savoie.
La politique de la Maison de Savoie en Pays de Vaud fut assez habile : D’une part le
souverain groupa autour de lui la noblesse du pays par l’hommage et les charges et
faveurs de la cour ; d’autre part, il favorise systématiquement le développement des
villes en leur accordant des franchises (celles de Moudon, accordées par Pierre II,
furent les premières accordées par la Maison de Savoie dans le pays). Certaines de
ces franchises, toutefois, ne lui sont pas dues et / ou sont antérieures (Lausanne,
Avenches, Romainmôtier). Pierre II assit l’administration Vaudoise, dirigée par le
Bailli de Vaud, sur de nouvelles bases. Le « don gracieux », impôt institué par Pierre
II pour faire fonctionner cette administration, voyait son montant établi par une
délibération des Etats de Vaud, assemblée de Seigneurs et de Bourgeois du Pays.

3
2.3. La Conquête Bernoise (1475 – 1555)
En 1475 les guerres de Bourgogne opposèrent les Confédérés et leurs alliés (comte
de Gruyère, comte de Neuchâtel, duc de Lorraine) au duc Charles de Bourgogne et
à son allié le duc de Savoie. Une troupe de Haute Gruyère conquit le Pays d’Aigle
pour le compte de Berne en 1475. Les Bernois firent des incursions dans le Pays de
Vaud à trois reprises, mais durent l’évacuer en grande partie sur l’intervention de
Louis XI. Les Confédérés gardèrent les baillages de Grandson, Morat, Orbe et
Echallens, arrachés aux Bourguignons. Ces baillages furent rachetés à leurs
Confédérés par Berne et Fribourg qui les gardèrent comme baillages communs
jusqu’à la fin de l’Ancienne Confédération.
Le duc Charles III de Savoie avait la prétention de se proclamer souverain de
Genève et Lausanne, villes épiscopales. Pour résister à ces prétentions, ces deux
villes conclurent des traités de combourgeoisie avec Berne et Fribourg en 1525 –
1526.
L’introduction de la Réforme à Berne (1528) et l’avancée décisive de l’esprit de la
Réforme à Genève en 1532 resserrèrent les liens entre les deux villes. L’hostilité du
duc de Savoie envers ce mouvement (il projetait avec l’évêque de Genève, Pierre de
la Baume, forcé de quitter sa ville le 14 Juillet 1533, une reconquête de Genève)
rendirent inéluctable pour Berne la conquête du Pays de Vaud sans laquelle une
défense efficace de Genève était impossible. De fait, au début de 1536, les
Savoyards avec des alliés du Genevois bloquent complètement la ville de Genève
dont la chute paraît alors probable. Ceci décide de l’intervention Bernoise : Une
armée Bernoise commandée par Hans-Franz Naegeli, futur avoyer, envahit alors le
Pays de Vaud à partir du 22 Janvier. Le duc de Savoie n’avait aucune force capable
de s’opposer valablement à cette armée Bernoise bien organisée et forte de 7000
hommes environ et la population Vaudoise, en partie gagnée à la Réforme, ne
manifesta presqu’aucune hostilité envers les Bernois. A la fin de Mars 1536, Berne
avait conquis tout le Pays de Vaud, y compris l’évêché de Lausanne, ainsi que le
Genevois, le Pays de Gex et une partie de la rive Sud du Lac Léman.
Avec l’arrivée à Genève de Jean Calvin en Juillet 1536, la Réforme y triomphe
définitivement. Par un traité du 7 Août 1536, Berne reconnaît l’indépendance
complète de la nouvelle « Ville et République de Genève ».
Les ducs de Savoie persistèrent dans leurs revendications sur les territoires perdus
et sur Genève jusqu’à la fin du XVIIème siècle. En outre, ces conquêtes Bernoises et
cette grande avancée de la Réforme suscitèrent l’hostilité de l’Empereur , du Valais
et de Fribourg sous la protection de qui certains territoires Vaudois voisins (Romont,
Rue, Chatel-St.-Denis, Vevey, la Tour de Peilz), hostiles à la Réforme, s’étaient
livrés.
Berne avait besoin de se rallier Fribourg afin de faire avaliser ses conquêtes aussi
par les Confédérés demeurés catholiques ; Berne et Fribourg s’entendirent donc
pour partager le pays conquis : Fribourg prit ainsi Estavayer, Surpierre, Vuissens,
Rue, Romont, Châtel-St.-Denis, ainsi que les terres de l’évêché de Lausanne autour

4
de Bulle ; Berne garda le reste du Pays de Vaud en laissant au Valais quelques
territoires à l’extrême Est du Pays de Vaud.
Le comte de Gruyère Jean II, rompit ses derniers liens avec le duc de Savoie, son
suzerain, pour s’allier à Fribourg dans son soutien au partage du Pays de Vaud avec
Berne en 1536. Son successeur Michel se joignit au pacte fédéral en 1548 et le
comté de Gruyère devint donc un nouveau canton Suisse pour quelques années.
Mais les derniers comtes de Gruyère avaient accumulé une dette considérable, ce
qui amena la Diète Fédérale à prononcer la faillite du comté de Gruyère en 1554.
Les deux principaux créanciers, Fribourg et Berne, se partagèrent alors le comté,
Fribourg prenant la basse Gruyère avec la ville de Gruyères et Berne la région de
Saanen et de Château d’Oex, avec laquelle elle avait déjà des liens politiques
anciens, qui devint le baillage de Saanen (dont le siège fut finalement établi au
château de Rougemont).
Le territoire Bernois avait alors atteint sa plus grande extension. Mais la Savoie
n’avait pas renoncé aux territoires perdus en 1536 et elle avait l’appui de Charles-
Quint, tandis que Berne avait celui de la France. En 1542, la Diète d’Empire intima à
Berne de restituer à la Savoie ses conquêtes de 1536, sans résultat. En 1559, le
nouveau duc de Savoie, Emmanuel-Philibert, éleva à nouveau des prétentions sur
ces territoires et Genève dans un contexte plus favorable où Berne n’avait plus
vraiment le soutien de la France et des Confédérés. La guerre avec la Savoie était
donc sur le point d’éclater, mais Philippe II, successeur de Charles-Quint au trône
d’Espagne, obligea le duc de Savoie à négocier. Une paix fut alors signée à
Lausanne le 30 Octobre 1564 par laquelle l’indépendance de Genève était reconnue
et Berne était forcée de rétrocéder le Pays de Gex (occupé par Genève en 1589 au
nom de la France, puis donné définitivement à celle-ci en 1601), ainsi que le
Genevois et le Chablais à la Savoie. C’était la première fois dans son histoire que
Berne rétrocédait un territoire, qui fut aussi perdu définitivement pour la Suisse.
2.4. Le Régime Bernois (1536 – 1798)
La conquête n’ayant pas été préméditée, Berne n’avait aucun plan préparé à
l’avance pour l’organisation du pays conquis. Il s’ensuivit une courte période de
tâtonnements où Berne envoya des commissions pour prendre les mesures les plus
urgentes et faire des propositions aux Conseils pour l’organisation du Pays.
Les terres conquises se composaient de villes combourgeoises de Berne, Payerne et
Lausanne, dont les contingents avait pris part à la conquête, de villes privilégiées
dépendant de la Savoie ou de l’évêque de Lausanne, de terres qui avaient été la
propriété de ces deux princes, de maisons religieuses quasi indépendantes (les
prieurés de Payerne, Bonmont et Romainmôtier), et de seigneuries dont les
propriétaires étaient vassaux du duc de Savoie ou de l’évêque de Lausanne. Partout
Berne se substitua aux droits du Prince ; les villes conservèrent leurs franchises ; les
vassaux qui firent leur soumission à Berne (tous, finalement, sauf l’ancien Bailli de
Vaud) purent conserver leurs seigneuries après avoir prêté hommage à Berne.
Berne ne conserva en propriété directe que les anciens biens religieux et ceux du
Bailli de Vaud.

5
Le pays fut partagé en baillages (Chillon, Lausanne, Yverdon, Moudon, Avenches,
Morges, Nyon, Romainmôtier, Bonmont, et Payerne dont le titulaire était un
gouverneur militaire). A ces baillages proprement Vaudois, s’ajoutèrent les baillages
communs avec Fribourg (cf. section 2.3), le gouvernement militaire d’Aigle (qui
existait depuis 1475), les baillages de Thonon et Gex (perdus, cf. section 2.3, en
1564), et le baillage de Saanen (créé en 1554, suite à la faillite du comte de Gruyère,
cf. section 2.3).
Un nouveau baillage (Aubonne) fut créé longtemps après dans les circonstances
suivantes : Suite au décès de son précédent titulaire, Jean-Baptiste Tavernier en
1684, la baronnie d’Aubonne fut revendue à Henri Duquesne, fils du célèbre amiral
Abraham Duquesne, obligé de quitter la France à la suite de la promulgation par
Louis XIV de l’Edit de Fontainebleau en 1685 par lequel il proscrivait les Réformés
(toutefois l’Amiral Abraham Duquesne, en raison de ses états de service et de son
grand âge, put demeurer en France sans être inquiété lui-même jusqu’à son décès
en 1688).
Henri Duquesne fit sceller le cœur de l’amiral, après son décès, derrière une pierre
d’un mur du temple d’Aubonne en y plaçant une inscription qui est toujours visible
aujourd’hui. En 1691, Les Conseillers de Berne chargèrent Henri Duquesne de
constituer une petite flotille de guerre (galères) sur le lac Léman pour laquelle il
construisit le port de Morges.
En 1701, Henri Duquesne revendit la baronnie d’ Aubonne à Berne qui en fit le siège
d’un nouveau baillage inauguré par Emmanuel de Bondeli, ancêtre direct de l’auteur
de ces lignes.
Le bailli, qui appartenait obligatoirement à l’aristocratie Bernoise et qui était nommé
pour 6 ans, représentait le Souverain (les Conseillers de Berne, « Leurs Excellences
(LLEE en abrégé) de Berne ») et il avait les pouvoirs exécutif et judiciaire (ce dernier
était partagé avec les seigneurs résidant dans le baillage). Le bailli avait un
lieutenant baillival et des assesseurs qui étaient obligatoirement Vaudois ; il en était
de même des juges. Tout appel à des tribunaux étrangers (cour suprême de
Chambéry ou official de Besançon) fut supprimé au profit d’une nouvelle instance
d’appel la « Chambre des Suprêmes Appellations Romandes ». Cette chambre était
présidée par le « Trésorier Romand », ou « Trésorier du Pays de Vaud » qui, ayant
aussi en charge la surveillance, notamment financière (d’où son titre), de
l’administration des baillis, était le premier personnage du Pays de Vaud.
Certaines familles nobles Vaudoises (Goumoëns, Gingins, Tavel) devinrent
bourgeoises de Berne et furent agrégées à l’aristocratie Bernoise. Il s’ensuivit que
certains baillis du Pays de Vaud, choisis dans ces familles, étaient Vaudois. Il y eût
même le cas de Wolfgang-Charles de Gingins, seigneur de Chevilly, qui fut nommé
Trésorier Romand (le dernier) en 1795.
Les « Etats de Vaud » assemblée datant du régime Savoyard (cf. section 2.2)
disparurent progressivement dans la mesure où leur rôle principal, l’établissement du
montant du « don gracieux », disparut lui aussi puisque Berne renonça à lever des
impôts directs.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%