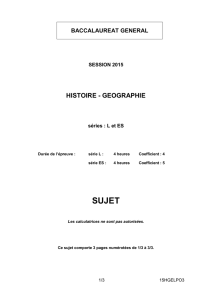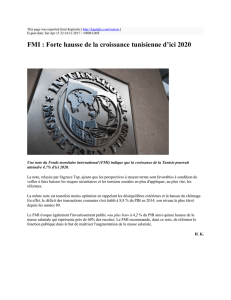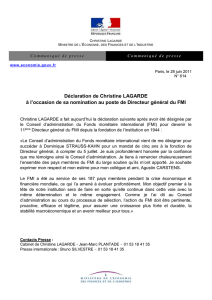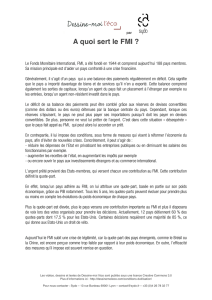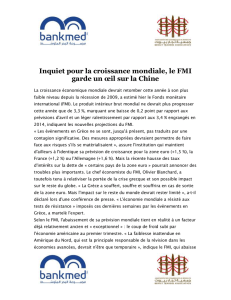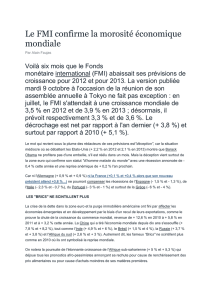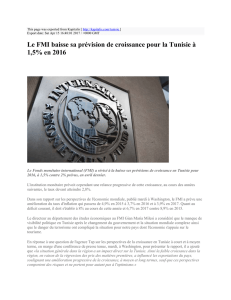FMI = Famine, misère, impérialisme

LCR Formation 72 FMI = Famine, misère, impérialisme
Pilier de l’ordre impérialiste mondial depuis l’après-guerre, le FMI (Fonds Monétaire International) est
pour les travailleurs des "pays en voie de développement" synonyme de licenciements, d’attaques
contre le niveau de vie des travailleurs et de misère généralisée pour la classe ouvrière.
En effet, afin de "stabiliser" les économies et de "restaurer la confiance des investisseurs", le FMI insiste
pour que chaque gouvernement applique ses plans d’austérité dont les travailleurs du monde entier
supportent les conséquences.
Le plan d’austérité est devenu le principal préalable du FMI à toute aide financière mise en place pour
faire face à la fuite des capitaux, à la dette étrangère devenue écrasante ou à la disparition des réserves
de devises étrangères - les signes classiques d’une crise financière aggravée.
Le FMI, structure fondamentale de l’impérialisme moderne, se définit lui-même de la manière suivante :
• Il est politiquement neutre, comme une espèce de banquier bénévole mais plein de bon sens, qui ne
fait qu’appliquer la volonté de ses pays-membres.
• Il a comme unique objectif d’appuyer le développement et la croissance du commerce international.
• Son aide financière ne sert qu’à permettre aux pays-membres de surmonter des difficultés financières
temporaires - en particulier dans le domaine de la balance des paiements (c’est-à-dire avoir assez
d’argent pour payer les importations) - et à les aider à effectuer les changements structuraux
nécessaires afin d’augmenter les exportations.
• Sa doctrine est celle du néolibéralisme, avec comme objectif que tous les pays puissent avoir une
spécialité dans le domaine de la production, afin de maximiser le bien-être des citoyens.
Voilà la version officielle, la vision impérialiste de la chose. La vérité est tout autre.
En fait, le FMI fonctionne comme une espèce de ministère des finances à l’échelle planétaire. Il contrôle
notamment la situation des pays du "tiers monde" - les semi-colonies d’Asie, d’Amérique latine et
d’Afrique - dans l’intérêt d’une poignée de puissances impérialistes, en particulier les USA, l’Allemagne,
la France, le Japon et la Grande-Bretagne, qui dominent l’économie mondiale.
Les objectifs réels du FMI sont en fait évidents :
• Assurer la capacité d’un pays à remplir ses obligations en matière de dette aux banques privées. Tout
surproduit financier créé par l’exportation ou la privatisation doit avant tout servir à payer l’intérêt des
dettes aux banques étrangères.
• Ouvrir des marchés nationaux à l’investissement et à l’appropriation par les principaux pays
impérialistes.
Au sein du FMI, certains pays-membres - les puissances impérialistes - sont plus égaux que d’autres.
En poursuivant son projet d’abolition de toute restriction sur la libre circulation des marchandises, des
services et du capital, le FMI montre clairement qu’il n’est qu’une arme au service des classes riches et
puissantes.
Le FMI et la crise des années 80
Jusqu’au début des années 70, la plupart des pays semi-coloniaux ont surfé sur la vague de croissance
que constituaient les "Trente Glorieuses". Leurs exportations ont augmenté à un taux suffisant pour
empêcher un déficit de leurs balances des paiements. Ils ne croulaient pas sous le poids des
importations.
Leur éventuels déficits étaient financés par des crédits commerciaux, des prêts des gouvernements
étrangers ou des agences internationales. En 1971, les banques privées ne possédaient qu’un tiers des
prêts étrangers dans les pays du "tiers monde".
Puis les années 70 ont été marquées par la crise ; deux récessions mondiales ont frappé l’économie
internationale et la demande pour les exportations traditionnelles d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine a
chuté.

A la fin de la récession mondiale de 1980-82, des pays comme le Brésil, le Mexique, l’Argentine et le
Venezuela ont fait faillite. Ils ne pouvaient plus payer les intérêts des dettes contractées auprès des
banques privées qui avaient proposé des prêts pendant les années 70 afin que les pays pallient aux
déficits produits par la crise internationale.
En 1970, la dette des pays dominés par l’impérialisme était de l’ordre de 75 milliards de dollars. 15 ans
plus tard, ce chiffre a été multiplié par 12 : la dette s’élevait à 900 milliards de dollars.
La plupart des prêts demandés par les classes dirigeantes des pays semi-coloniaux n’avaient pas pour
objectif d’augmenter le niveau de vie de la population. Un grand nombre d’entre eux étaient directement
liés à des contrats militaires dont l’objectif était de renforcer les régimes répressifs d’Amérique latine et
d’Afrique confrontés à la pression populaire ainsi qu’au renforcement, dans le même temps, des profits
des sociétés multinationales d’Europe et des USA qui fabriquaient des produits militaires (armes, avions,
hélicoptères, voitures, etc.).
D’autres prêts servaient, eux, des projets dits "de prestige", inutiles pour la population, mais qui avaient
pour objectif de renforcer le régime aux yeux du peuple et des classes dirigeantes des États voisins.
Et, bien entendu, parmi ces sommes empruntées, des milliards de dollars ont tout simplement été
détournés vers des comptes privés dont jouissaient les Mobutu et les Suharto.
Pendant la récession de 1980-82, le poids de la dette est devenue écrasant. L’effondrement de la
demande de matières premières pendant les années 70 a porté un premier coup de massue aux pays
d’Amérique latine. Ceci a été suivi en 1979 de l’explosion des taux d’intérêt - de 7 % à 17 % - alors que
les USA cherchaient à freiner l’inflation.
Par voie de conséquence, le remboursement des seuls intérêts -- et non pas la dette elle-même -- a
consommé une partie croissante des revenus d’exportation qui diminuaient. La proportion des revenus
des pays semi-coloniaux absorbés par le paiement des intérêts est passée de 15 % en 1977 à 25 % en
1982.
Pendant cette même période, la somme totale remboursée par les pays dominés par l’impérialisme est
passée de 40 à 121 milliards de dollars. Pays après pays, les bourgeoisies locales s’apprêtaient à jeter
l’éponge.
Les banques, menacées par la perte pure et simple de leur argent, ont exigé l’intervention du FMI pour
renflouer les économies. Il fallait éviter la faillite et imposer les mesures politiques et économiques
nécessaires pour assurer le remboursement de la dette. C’est dans ce contexte que le FMI a trouvé sa
raison d’être.
Dès la fondation des instances financières gérant l’économie capitaliste mondiale en 1944, les USA ont
fait en sorte que tous les pays souhaitant recevoir de l’argent de la Banque mondiale doivent
obligatoirement adhérer au FMI et donc subir sa politique.
En 1978, les USA ont modifié la charte du FMI, afin que tout prêt soit conditionné à l’acceptation de la
politique du FMI en matière de réforme économique. Ce changement généralisait une politique qui
n’avait jusque là été appliquée que sélectivement.
Par exemple, quand un pays impérialiste avait des difficultés à boucler son budget - comme ce fut le cas
pour la Grande Bretagne en 1960 - aucune condition particulière n’était associé au prêt accordé par le
FMI.
Le sort des pays semi-coloniaux était très différent. En 1954, le Pérou fut le premier pays d’Amérique
latine à se tourner vers le FMI ; il dut subir un programme de réformes économiques drastiques. Idem
pour le Chili en 1956.
La crise d’endettement des années 80 a conduit à une véritable ruée vers le FMI. A la fin de 1984, 40
pays semi-coloniaux avaient signé des accords avec lui. Bien sûr, ces accords étaient formulés de

manière à éviter tout contrôle démocratique sur le processus de "réforme" exigé par le FMI.
Les choses se passent toujours de la même façon : le FMI écrit une lettre d’intention spécifiant les
conditions qu’il impose ; le gouvernement doit la signer. Les fonds sont ensuite débloqués. L’accord
n’est pas nécessairement publié et il n’a pas le statut de traité international, il n’est donc pas
nécessairement discuté par le parlement du pays concerné.
Le FMI n’est pas gratuit. Le pays concerné doit payer 0,25 % du prêt afin de couvrir les "frais d’agent" du
FMI ! Ensuite, il doit acquitter 4,5 % du prêt directement aux pays-membres dont les devises composent
l’argent prêté.
Résultat : un transfert de la richesse des pays semi-coloniaux vers les pays impérialistes.
Enfin le pays-emprunteur doit adopter un plan "d’ajustement structurel", sans lequel il n’est pas admis
sur les marchés internationaux des capitaux, ce qui le prive de l’accès à la richesse. Le but des plans est
d’assurer les profits des banques et de transférer les richesses nationales vers les impérialistes.
Le plan traditionnel du FMI comporte certains éléments immuables :
• la dévaluation de la devise nationale ;
• la hausse des taux d’intérêt ;
• l’élimination des subventions, y compris sur la nourriture ;
• l’augmentation des prix demandés par les entreprises d’État pour l’énergie, l’eau etc. ou la privatisation
de ces entreprises ;
• le contrôle des salaires ;
• la restriction du crédit.
Toutes ces mesures "d’ajustement" ont un même objectif : la limitation de la demande intérieure et des
importations et le renforcement des exportations occasionnées par la diminution de leur prix. Tous les
revenus découlant des exportations doivent être utilisées pour le remboursement de la dette.
Investissements étrangers
En restaurant l’équilibre de la balance des paiements, le FMI assure que le pays puisse à nouveau
attirer les investissements étrangers. Lorsque les impérialistes reviennent dans ces pays, tout est moins
cher à cause de la dévaluation.
Là encore une fois, ces mesures n’ont qu’un seul objectif : créer - ou recréer - les conditions pour
l’extraction des surprofits par les impérialistes.
En Amérique latine, pendant les années 80, la politique du FMI a conduit à une "décennie perdue" pour
les masses. Le Brésil constitue un exemple typique.
En janvier 1983, le Brésil a signé un accord avec le FMI et s’est lancé dans un programme de
"stabilisation" prévu sur trois ans. En échange d’un prêt de 4,5 milliards de dollars, le plan prévoyait :
• la dévaluation de la devise de 30 % ;
• la réduction de moitié du déficit de la balance des paiements en 1983 ;
• la réduction de moitié du déficit budgétaire ;
• la baisse de l’inflation de 100 % par an à 85 % en 12 mois ;
• la hausse des taux d’intérêt et la suppression des subventions ;
• l’abandon de l’indexation des salaires, conduisant ainsi à une perte du pouvoir d’achat des travailleurs.
Étant donné qu’avec la dévaluation, les prix ont grimpé deux fois plus vite que les salaires, bon nombre
de travailleurs ont connu la pauvreté. Les exportations ont augmenté mais la résistance ouvrière a fait
en sorte que les salaires n’ont pas diminué dans les proportions espérées par le FMI.
Conséquence ? Le FMI a refusé de livrer la deuxième tranche du prêt, jusqu’à ce que le gouvernement
adopte une loi décrétant que la hausse des salaires ne pouvait atteindre que 80 % de la hausse des prix
! Les travailleurs se sont mis en mouvement et le gouverneur de la Banque du Brésil a dû démissionner.
Au bord de la faillite, le gouvernement brésilien a écrasé le mouvement et a fait adopter la politique du
FMI à la hussarde.

En novembre 1983, le FMI a débloqué enfin 11 milliards de dollars, dont l’unique fonction était... de
rembourser la dette.
Les pays d’Amérique latine des années 80 ont joué le rôle de cobayes néo-libéraux du FMI. L’un après
l’autre, chaque pays a dû adopter une politique orientée vers les exportations, basée sur un programme
de privatisation des industries nationales au profit des sociétés multinationales impérialistes et la
destruction pure et simple des aides étatiques destinées aux couches les plus pauvres.
Mais en 1997, l’effondrement des pays du Sud-Est asiatique a montré l’erreur des théories néo-libérales
prônées par le FMI sur le développement capitaliste.
Le FMI chantait les louanges de ces économies. Il les prenait pour modèles afin de montrer comment
des pays du "tiers monde" pouvaient connaître croissance et stabilité et jouir des investissements
étrangers. Entre 1990 et 1996, les banques étrangères se sont ruées vers ces pays, applaudis par le
FMI qui y voyait des modèles à suivre partout dans le monde semi-colonial.
Et puis, l’année dernière, la vérité a éclaté aux yeux de tous : surproduction, effondrement des profits,
mauvaises dettes et fuite des capitaux. L’un après l’autre, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, la Corée
du Sud et les Philippines ont tous sombré. Incapables de défendre leurs devises face à la déferlante
financière, leurs économies se sont effondrées.
Étant donné qu’ils suivaient tous et sans conditions la politique du FMI, ils étaient en droit d’attendre que
celui-ci débloque immédiatement les fonds nécessaires pour les sauver.
Pas du tout. Pour le FMI, la crise devait être payée par les populations. Cela s’est traduit par la réduction
des dépenses d’État, la limitation de la demande intérieure et des salaires et l’augmentation des taux
d’intérêt.
Les "apprentis sorciers" du FMI ont même rajouté une clause visant la dérégulation du mouvement des
capitaux, un des facteurs qui avaient déclenché la crise !
Le but du FMI est simple : se servir de la crise afin d’ouvrir ces pays comme autant d’huîtres, permettant
ainsi aux banques et aux sociétés impérialistes d’en déguster les meilleurs morceaux.
Voilà pourquoi l’accord de décembre 1997 entre le FMI et la Corée du Sud exige une profonde réforme
structurelle, la fermeture des institutions financières, le rachat des banques coréennes par des banques
étrangères et la fin des prêts gouvernementaux. Comme l’a dit un commentateur, l’objectif du FMI est
net :
"Il ne peut y avoir aucun doute, les vrais gagnants sont les sociétés occidentales et nippones. Le
transfert vers des propriétaires étrangers a commencé, marqué par l’euphorie, comme le montre cette
remarque de la part d’un dirigeant d’une banque britannique : 'Si quelque chose qui hier valait 1 milliard
de livres, aujourd’hui ne vaut que cinquante million, c’est assez excitant.' La combinaison des
dévaluations massives avec la libéralisation à tout va et la reprise soutenue par le FMI pourrait même
précipiter le plus grand transfert de richesses des propriétaires nationaux vers l’étranger qu’on ait jamais
vu en temps de paix depuis cinquante ans. Même les transferts vers les USA qu’on a vu en Amérique
latine pendant les années 80 ne seraient rien à côté."
L’avenir du FMI
Le caractère pro-impérialiste des conditions avancées par le FMI n’a jamais été aussi évident malgré ce
qu’en dit Michel Camdessus. Celui-ci déclarait, sans rire, fin octobre, que les programmes du FMI
"cherchent à faire en sorte que la reprise des dynamiques de développements serve le développement
humain, que la dépense publique soit autant que possible destinée à l’éducation, à la santé de base, etc.
C’est le meilleur moyen pour donner leur chance aux plus pauvres."
La seule pointe de critique que Camdessus concède avec cynisme, c’est que "la libéralisation a parfois
été conduite en dépit du bon sens". Et les millions de travailleurs et de jeunes qui ont subi les effets
nocifs des programmes du FMI sur leurs conditions de vie, alors ? Oubliés !

Comme Piaf, le FMI ne regrette rien.
Car après tout, ces conséquences sont sa raison d’être.
L’avenir du FMI peut prendre deux directions. D’une part, il est possible que le nombre et la profondeur
des crises financières des années 90 épuisent les ressources du FMI.
Par conséquent, les impérialistes craignent que la prochaine crise soit la dernière. Car pour répondre à
la crise rampante qui déferle sur les places boursières de la planète, le FMI a besoin de plus d’argent
encore.
Aux USA, le Congrès n’a donné "que" 18 milliards de dollars au FMI le mois dernier. Mais son
instrument financier préféré a besoin de beaucoup plus. S’il s’écroule sous le poids de cette crise ou de
la suivante, on pourrait assister à l’effondrement du système d’échange planétaire et à un retour au
chaos qui a caractérisé les années 30. Voilà la voie réactionnaire.
Mais il y a une autre piste.
Les luttes des pauvres et des exploités contre l’austérité imposée par le FMI pourraient bloquer les plans
de ce dernier, aboutir au renversement des gouvernements bourgeois qui cherchent à les mettre en
œuvre. Voici la voie révolutionnaire.
C’est seulement en suivant une telle voie que l’on peut arracher des mains des capitalistes les banques
et les usines du monde entier et les mettre sous le contrôle de ceux qui y travaillent.
Dans ces circonstances, si les pays les plus développés étaient munis de gouvernements ouvriers, ils
pourraient commencer la construction d’un ordre monétaire international opposé à celui du FMI. Ce
serait un ordre basé sur un système planétaire de planification socialiste, un système destiné à
augmenter le niveau de vie des plus pauvres.
L’expropriation des banques abolirait les dettes nationales. Les revenus des exportations n’assouviraient
plus l’avarice des financiers internationaux et ne conduiraient plus au transfert des richesses entre les
mains d’une poignée de sociétés multinationales.
Une institution monétaire internationale sous le contrôle démocratique des travailleurs dirigerait un
système de paiements à taux de change stables entre les pays-membres d’une fédération socialiste,
tout en permettant aux devises nationales d’exister si tel était le souhait des masses travailleuses de ces
pays.
Mais une transition socialiste, durant laquelle chaque pays serait intégré au sein d’un plan international
de production et de distribution, aurait comme conséquence inévitable de miner le besoin de devises
nationales. Les sommes dépensées pour les échanges pourraient utilement servir ailleurs.
Dans cette optique, celle de l’après-révolution socialiste, la politique monétaire aurait comme seul
objectif de mesurer la productivité du travail, signalant ainsi aux institutions de planification comment
mieux répartir l’argent au sein du système socialiste tout entier.
C’est une perspective très différente de celle du FMI. Mais c’est la seule qui peut faire sortir l’humanité
du cycle de crise, de répression et de guerre qui est le lot commun sous la férule capitaliste. Il s’agit
d’une perspective émancipatrice et rationnelle plaçant la production au service de l’humanité et non
l’inverse.
Aux origines du Fonds Monétaire International
Pendant les années 30, le monde capitaliste fut ravagé par la Grande Dépression. Des milliers de
banques ont fait faillite ; la valeur marchande des terres s’est effondrée ; les usines se sont arrêtées et
des dizaines de millions de travailleurs se sont retrouvés au chômage. Le système financier et
d’échange monétaire international fut profondément endommagé. Une perte de confiance généralisée
 6
6
 7
7
1
/
7
100%