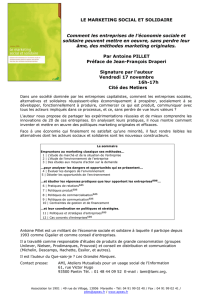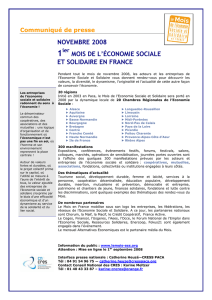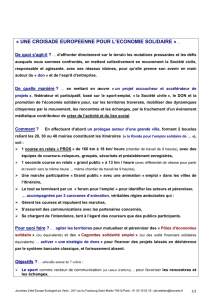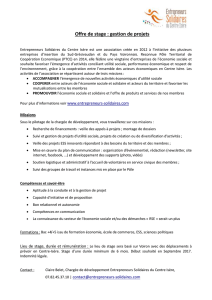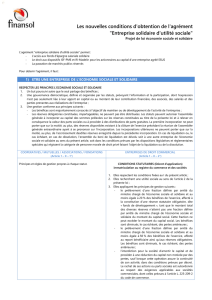Épargner solidaire pour recréer du lien social - UTC

1
Jeudi 1er Décembre 2005
DOSSIER MORALISER L'ÉCONOMIE
Epargner solidaire pour recréer du lien social
Apparues au début des années 80, les finances solidaires visent à soutenir des projets à forte
plus-value sociale, environnementale ou culturelle. Plus de 130 000 épargnants ont adopté la
démarche en 2004.
En 2001, Oumie Yanssane crée sa
boutique, Bébés en vadrouille (1),
qui commercialise des vêtements et
des jouets écologiques ou issus du
commerce équitable. En 2004,
Caroline de Rancourt recapitalise
Nouvelles technologies en Auvergne,
l'entreprise d'insertion qu'elle a créée
deux ans plus tôt, spécialisée dans la
numérisation de documents. Le point
commun entre ces deux
entrepreneuses : elles ont pu créer ou
développer leur activité grâce aux
finances solidaires. Ce type de
financement est apparu en France au
début des années 80 : dans un
contexte de développement du
chômage de masse, une poignée de
militants souhaite alors permettre à
des personnes n'ayant pas accès au
crédit bancaire de créer leur propre
entreprise, en mettant à leur
disposition une partie de leur
épargne.
Aujourd'hui, l'espace de la finance
solidaire s'est élargi. Ses ressources
reposent notamment sur des produits
d'épargne solidaire. Ces produits sont
variés et ressemblent souvent aux
produits d'épargne classique que
proposent les banques. La différence
vient de la destination finale de
l'argent : au lieu d'être investi sur une
entreprise cotée en Bourse, les fonds
confiés par les épargnants servent à
financer des entreprises solidaires
non cotées et à soutenir des projets à
forte plus-value sociale ou
environnementale qui trouvent
difficilement des financements sur
les marchés classiques, parce qu'ils
relèvent d'activités considérées
comme risquées et/ou peu rentables.
Pour un épargnant solidaire,
l'épargne n'est pas prioritairement un
moyen de s'enrichir, mais un outil
pour (re)créer du lien social et de la
cohésion territoriale.
Une dissidence économique
En 2004, 130 000 personnes
physiques et morales avaient choisi
d'épargner de façon solidaire, contre
13 000 en 1996. Le montant total de
l'épargne atteignait 613 millions
d'euros à la fin 2004, soit deux fois
plus qu'en 2002, selon Finansol,
collectif associatif qui réunit la
plupart des acteurs du secteur. « La
finance solidaire est sortie de la
confidentialité, se félicite Henri
Rouillé d'Orfeuil, ancien président de
Finansol. A partir d'initiatives
militantes et locales, nous avons
réussi à construire un système avec
des circuits et des outils qui
permettent de collecter de l'épargne
large. » « La finance solidaire relève
de la même logique que le commerce
équitable, l'agriculture biologique ou
le tourisme alternatif, note Jean-Paul
Vigier, premier président de Finansol
et aujourd'hui président de la
Fédération européenne des banques
éthiques et alternatives (Febea). Tous
ces mouvements représentent une
dissidence dans le système
économique dominant. Il s'agit de la
démarche de citoyens qui cherchent
à reprendre l'initiative dans le
domaine économique et à redonner
du sens à l'action économique, en y
introduisant une dimension de
solidarité. »
Deux grands types de produits
d'épargne solidaire sont à distinguer :
les produits de partage (©), pour
lesquels le souscripteur renonce à
une partie des intérêts perçus pour en
faire don à des acteurs financiers
solidaires (©), et les produits
d'investissement solidaire (s), qui
consistent à mettre une partie du
capital de l'épargnant à disposition de
ces acteurs (le capital appartient
toujours à l'épargnant, mais est utilisé
par les investisseurs à des fins
solidaires).
Comptes à terme ou actions non
cotées
Il existe plusieurs moyens de
souscrire ces produits. Le premier est
de le faire directement auprès
d'acteurs financiers solidaires. Cela
peut consister à ouvrir un compte à
terme auprès d'établissements qui
accordent des crédits à des projets
sociaux ou environnementaux
créateurs d'emplois, comme la
société financière de la Nef (2) ou la
Caisse solidaire du
Nord-Pas-de-Calais (3). Il peut
également s'agir d'acheter des actions
non cotées auprès d'institutions telles
que la Société d'investissement
France active (4), qui aide à la
création ou au développement
d'entreprises d'insertion ou à vocation
solidaire, la Société foncière Habitat
et Humanisme (5), qui rachète et
réhabilite des logements pour les
familles n'ayant pas accès aux HLM,
ou encore Oiko-crédit (6), qui
finance des projets au Sud par du
microcrédit.
Les achats d'actions, en général, ne
rapportent pas grand-chose au
souscripteur, si ce n'est des avantages
fiscaux et la satisfaction d'avoir
contribué à financer des projets
solidaires en accompagnant leurs
entrepreneurs. « Le capital de la Sifa,

2
qui atteint 23 millions d'euros, est
partagé entre 100 personnes morales
: banques, organismes mutualistes,
caisses de retraite ou entreprises,
détaille Edmond Maire, président de
cet organisme. Lorsqu'ils prennent
des parts dans notre capital, on leur
dit : 'Soyez tranquilles, on vous
promet qu'on ne vous versera pas de
dividende ! " Mais nous nous
engageons à ce que la valeur
nominale de leurs actions ne baisse
pas non plus. » De manière générale,
les institutions solidaires préfèrent
recevoir de l'argent sous forme
d'épargne solidaire plutôt que sous
forme de dons. « C'est un acte plus
engageant, plus réfléchi que le don,
remarque Bernard Usquin,
responsable des ressources
financières à Habitat et Humanisme.
L'épargnant s'engage sur plus long
terme que le donateur, et de façon
plus qualitative. »
Autre manière de souscrire de
l'épargne solidaire : passer par
l'intermédiaire des quelques banques
et sociétés de gestion proposant des
Sicav, des fonds communs de
placements (FCP) ou des livrets
bancaires de type solidaire. Le Crédit
coopératif est un des établissements
bancaires les plus engagés dans cette
démarche, pour des raisons évidentes
: « Nous sommes une banque
coopérative et nous nous définissons
comme la banque de l'économie
sociale et solidaire, explique Hugues
Sibille, directeur délégué au Crédit
coopératif. Soutenir la solidarité est
le coeur de notre métier et
correspond à nos valeurs. » La
banque propose douze produits
solidaires ayant reçu le label Finansol
(7), qui garantit leur caractère
solidaire et transparent. Elle propose
surtout des produits de partage, dont
le FCP Faim et développement par
lequel le souscripteur verse 50 % à
75 % des revenus générés par le
fonds à une organisation non
gouvernementale (ONG) de son
choix. Ce fonds a permis le
versement de 523 000 euros en 2004,
dont 86 % se sont dirigés vers le
Comité français contre la faim et
pour le développement (CCFD) et
vers la Sidi, sa Société
d'investissement et de développement
international (8).
La Macif, autre acteur majeur de
l'économie sociale, a quant à elle
privilégié les produits
d'investissement solidaire. Elle a créé
en 2002 le FCP Macif croissance
durable et solidaire. 5 % à 10 % des
encours de ce fonds sont investis
dans des entreprises solidaires (9). Le
reste est investi sur des critères de
développement durable.
Mais le boom récent des finances
solidaires est surtout lié au
développement de l'épargne salariale.
En 2004, 53 % des épargnants
solidaires avaient souscrit par ce
biais. La loi Fabius de 2001, puis la
loi Fillon de 2003 ont en effet permis
aux salariés qui bénéficient des
mécanismes d'épargne salariale
d'investir dans des Fonds communs
de placement d'entreprise (FCPE)
solidaires. On dénombre aujourd'hui
une trentaine de FCPE solidaires,
dont trois ont reçu le label Finansol.
Et les syndicats s'investissent
beaucoup pour que des FCPE
solidaires soient systématiquement
proposés dans les plans d'épargne
entreprise.
Des placements qui rapportent
autrement
Si l'on compare des placements de
nature équivalente, l'épargne
solidaire rapporte généralement
moins que l'épargne classique, soit
parce que le souscripteur fait don
d'une partie de ses intérêts (produits
de partage), soit parce qu'une partie
de son capital est investie sur des
projets dont la rentabilité
économique est faible (produits
d'investissement solidaire). Mais le
manque à gagner est largement
compensé par la satisfaction d'avoir
contribué à financer des initiatives
solidaires.
S'ajoutent à cela des avantages
fiscaux non négligeables : 25 % de
réduction d'impôts sur le revenu pour
les actions non cotées, 66 % de
réduction d'impôts pour les dons
générés par les produits de partage,
exonération de l'impôt sur le revenu
pour l'épargne salariale solidaire...
Toutefois, ces avantages ne
bénéficient pas aux 50 % de ménages
non imposables.
De manière générale, les produits qui
rapportent le moins sont aussi les
plus solidaires. Garrigue (10) est une
société coopérative de capital-risque
créée en 1985. Elle investit en fonds
propres dans des entreprises à forte
plus-value sociale et
environnementale. Toute personne
physique ou morale peut y prendre
des parts sociales. « Financièrement,
cela ne rapporte pas grand-chose,
reconnaît Dominique Cariiez,
président de Garrigue. Il peut y avoir
des pertes. La distribution de
dividendes n'est pas exclue, mais elle
reste très largement théorique. Mais
100 % des sommes récoltées servent
à investir dans la création ou le
développement d'activités. Ce qui est
loin d'être le cas quand on souscrit
une Sicav ou un FCP solidaire. » De
même, les Clubs d'investisseurs pour
une gestion alternative et locale de
l'épargne solidaire, les Cigales (11)
épargnent des sommes qui sont
ensuite investies dans des entreprises
locales en création ou en
développement. Ces sommes peuvent
être perdues en cas de faillite de
l'entreprise, mais la totalité de
l'épargne aura servi à soutenir un
projet solidaire.
« La diversité des types de
placements solidaires qu'on trouve
en France est une vraie richesse,
note Mathilde Mandonnet, secrétaire
générale de Finansol. Selon le
rendement que l'épargnant souhaite
retirer de son placement,
l'implication personnelle qu'il veut y
mettre et le degré de solidarité qu'il
souhaite favoriser, chacun peut y
trouver son compte. Et dans tous les
cas, une partie de l'argent sert à
financer des initiatives solidaires. » «
En outre, les placements sont
entièrement transparents : on est
capable de dire précisément aux gens
à quoi sert leur-argent » , ajoute
Bernard Usquin.
Les types d'initiatives soutenues sont
en réalité assez variés. La Sifa, par
exemple, finance des entreprises
créant des emplois destinés à des
personnes en situation de précarité
économique et sociale. L'Association
pour le droit à l'initiative
économique, l'Adie (12) octroie des
prêts individuels à des chômeurs de
longue durée ou des bénéficiaires de
minima sociaux, pour qu'ils créent
leur entreprise. La société financière
de la Nef finance notamment des
projets de protection de
l'environnement. Garrigue finance
plutôt des projets innovants tels que
la commercialisation de produits
biologiques ou équitables. Habitat et
Humanisme fournit des logements à
des familles en difficulté dans des
quartiers de centre-ville, afin de

3
favoriser la mixité sociale, et leur
offre un accompagnement destiné à
les aider à se réinsérer. La Sidi,
Oiko-crédit et la Cofides Nord-Sud
fournissent un appui financier et
technique à des institutions de
microcrédit qui proposent des
financements aux entrepreneurs
exclus des circuits bancaires, dans
une centaine de pays de Sud et de
l'Est.
90 000 emplois créés depuis 1983
Au total, depuis 1983, les finances
solidaires ont permis la création de
près de 90 000 emplois en France, le
logement de 5 400 familles en
situation de précarité et l'octroi de
plus de 4 millions de microcrédits
dans 91 pays en développement. Les
finances solidaires ont en outre
souvent un effet de levier : elles
peuvent décider les banques à
accorder des prêts aux créateurs
d'entreprise. Le taux de survie des
entreprises financées ainsi est même
supérieur à la moyenne française :
celles qui ont été financées par
France active ont un taux de
pérennité de 77 % au bout de cinq
ans, alors que le taux moyen de
survie des entreprises françaises est
de 46 % au bout de trois ans. Ces
bons résultats sont notamment liés à
l'accompagnement que les acteurs
solidaires fournissent aux créateurs
d'entreprise, qui permet de rendre les
projets plus viables.
Une démarche encore marginale
Toutefois, la finance solidaire reste
une démarche marginale, si on la
compare aux sommes amassées par
le reste des circuits financiers.
Qu'est-ce que 613 millions d'euros
d'épargne solidaire rapportés aux 7
000 milliards d'épargne totale des
ménages en France (chiffres Insee,
fin 2003) ? 30 % des Français
déclarent connaître l'existence de
l'épargne solidaire, selon le
Baromètre des finances solidaires
réalisé par Finansol. Mais le secteur
manque encore de visibilité aux yeux
du public et l'accès à l'épargne
solidaire reste difficile, car les
produits ne sont pas distribués
partout (13).
En outre, « les fonds d'investissement
solidaire doivent encore faire face à
certains préjugés de la part des
épargnants, note Thierry
Wiedemann-Goiran, président du
directoire de Macif Gestion. Ceux-ci
ont notamment du mal à croire qu'un
placement puisse à la fois être sûr,
rapporter un peu d'argent et servir la
solidarité. Du coup, ils hésitent à
s'engager. » Autre frein au
développement : « Concevoir des
produits d'épargne solidaire et les
gérer demandent un gros effort aux
institutions financières, remarque
Thierry Wiedemann-Goiran. Ces
fonds sont plus compliqués à gérer
que les fonds classiques, car les
entreprises sur lesquelles on investit
ne font pas l'objet d'analyses
financières systématiques. En outre,
cela nécessite un important effort de
commercialisation et déformation
des agents de distribution, que les
banques ne sont pas toujours prêtes à
fournir. »
Certains croient pourtant à la
possibilité d'un véritable changement
d'échelle de la finance solidaire. «
C'est une pratique qui pourrait tout à
fait se généraliser à l'ensemble de la
société » , estime ainsi Henri Rouillé
d'Orfeuil. Pourquoi ne
connaîtrait-elle pas le même succès
que le commerce équitable ? « Si le
commerce équitable a explosé, c 'est
parce que les grands réseaux de
distribution s'en sont emparés,
analyse Hugues Sibille. Ceux-ci ont
fini par comprendre que ce créneau
intéressait le consommateur et ils en
ont fait un argument marketing. Il
pourrait se passer la même chose
avec la finance solidaire, si les
grands réseaux bancaires s'en
saisissent. »
Un certain nombre d'acteurs de la
finance solidaire hésitent toutefois à
se compromettre avec des banques
davantage intéressées par le profit
que par la solidarité. « Nous sommes
face à un vrai dilemme, reconnaît
Jean-Paul Vigier. Soit nous restons
dans notre coin, en respectant des
principes stricts, mais alors nous
acceptons de rester "petits ". Soit
nous souhaitons nous développer et
répondre à des besoins larges, et
dans ce cas, il faut accepter ce type
d'alliances et de compromis. »
(1) 47 bd Henri-IV, 75004 Paris,
www.bbenv.com
(2) 114 bd du 11-Novembre-1918,
69626 Villeurbanne cedex, tél. : 0811
9011 90, www.lanef.com
(3) 3 contour Saint-Martin, 59100
Roubaix, tél. : 03 20 81 99 70.
(4) Sifa, 37 rue Bergère, 75009 Paris,
tél. : 01 53 24 26 26,
www.franceaclive.org
(5) 69 chemin de Vassieux, 69300
Caluire, tél. : 04 72 27 42 58,
www.habitat-humanisme.org
(6) www.oikocredit.org
(7) La liste des 47 produits d'épargne
labellisés par Finansol, avec leurs
caractéristiques, peut être consultée
sur www.finansol.org
(8) 12 rue Guy-de-la-Brosse, 75005
Paris, tél. : 01 40 46 70
00.www.sidi.fr
(9) Un FCP et une sicav ne peuvent
voir plus de 10 % de leur encours
investis dans des entreprises
solidaires, puisqu'ils ne sont pas
autorisés légalement à investir plus
de 10 % de leur encours dans des
entreprises non cotées.
(10) 61 me Victor-Hugo, 93500
Pantin, tél. : 01 48 44 74 03,
www.garrigue.net
(11) 61 rue Victor-Hugo, 93500
Pantin, tél. : 01 49 91 90 91,
www.cigales.asso.fr Voir « Les
Cigales investissent utile et
local » , Alternatives Economiques n°
219, novembre 2003.
(12) 4 bd Poissonnière, 75009 Paris,
tél. : 01 56 03 59 00,
www.adie.org
(13) Il est cependant possible de
souscrire certains produits solidaires
depuis n'importe quelle banque, en
fournissant leur code ISIN. C'est le
cas de dix Sicav et FCP. Les codes
ISIN de ces produits sont sur
www.finan sol.org/Pro
duits/TableauProduits.aspx
Une question de mots
Investissement solidaire :
investissement dans des entreprises
non cotées finançant des projets
solidaires qui ne trouvent pas de
financements dans les circuits
financiers classiques : aide à la
création d'activité pour les personnes
exclues, développement du
microcrédit, logement de familles
précaires, etc.
Investissement éthique :
investissement dans des entreprises
cotées en Bourse, en excluant les
entreprises ou les secteurs d'activité
(tabac, alcool, armement, etc.) qui ne
respectent pas un certain nombre de
critères éthiques.
Investissement socialement
responsable : investissement dans
des entreprises cotées respectant
certains critères sociaux et

4
environnementaux, évalués par des
agences de notation sociale telles que
Vigeo.
POUR EN SAVOIR PLUS
· www.flnansol.org : on y trouve
l'actualité du secteur, la liste des
produits solidaires labellisés par
Finansol, des fiches descriptives de
l'ensemble des acteurs de la finance
solidaire, ainsi qu'un guide interactif
des initiatives soutenues par
l'épargne solidaire, qui permet de
découvrir les projets financés en
Ile-de-France et à l'étranger.
· Le Baromètre des finances
solidaires, coéd. Finansol et La
Croix.
· « Les placements éthiques.
L'épargne alternative et solidaire »
, Alternatives Economiques
Pratique n° 15, septembre 2004.
· Lettre ouverte à ceux qui veulent
rendre leur argent intelligent et
solidaire, par Jean-Paul vigier, éd.
Charles Léopold Mayer, 2003.
· Economie, le réveil des citoyens.
Les alternatives à la mondialisation
libérale, par Henri Rouillé
d'Orfeuil, éd. La Découverte, 2002.
· Une ville pour l'homme.
L'aventure d'Habitat et humanisme,
par Bernard Devert, éd. du Cerf,
2005.
· Garrigue, une utopie concrète,
éd. Garrigue et Le temps des
cerises, 2005.
· Les nouveaux utopistes de
l'économie. Produire, consommer,
épargner... différemment, par
Sylvain Allemand, éd. Autrement,
2005.
DorivalCamille
Tous droits réservés : Alternatives Economiques
Diff. 111 582 ex. (source OJD 2005)
2AEA6NE0SADB046330360C819304F14567B5749724A1311424FD3EB
1
/
4
100%