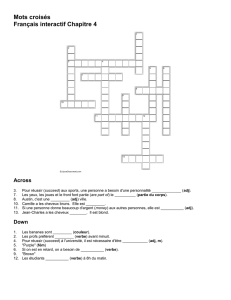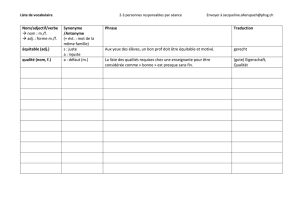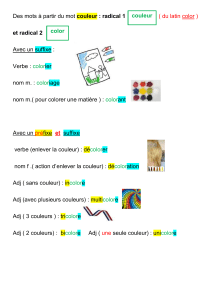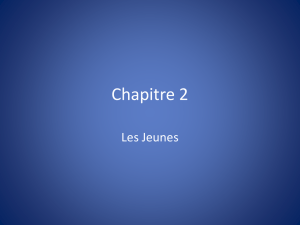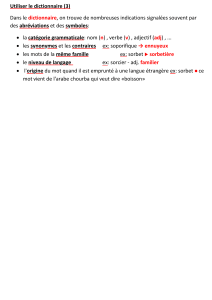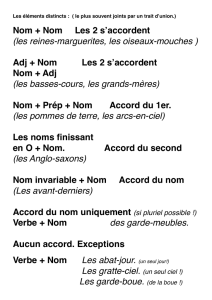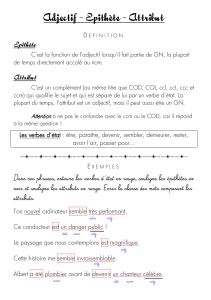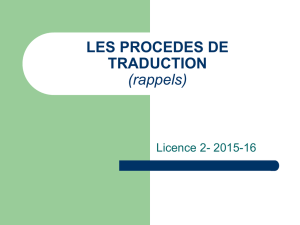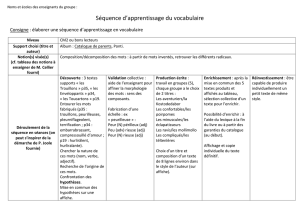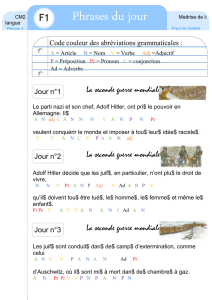bacteriologie generale - Faculté de Médecine Vétérinaire

BACTERIOLOGIE GENERALE (2)
3
E CANDIDATURE
J. MAINIL 2004/2005

61
Chapitre 5. Les grands groupes bactériens
5.1. Taxonomie bactérienne
La classification des organiques vivants est une méthode objective de délimitation d’entités (ou taxons) dans un
groupe particulier.
La classification du monde bactérien est encore plus complexe que celle des organismes eucaryotes
pluricellulaires. Le principal problème est le choix des critères de classification. Ceux-ci ont varié dans le temps
avec l’évolution des techniques. Les premiers critères étaient morphologiques (longueur, largeur, forme, …) et
de mobilité, auxquels se sont rapidement ajoutés des critères de coloration (Gram, Ziehl-Neelsen, Giemsa,
Köster, …) et divers critères biochimiques (biochimiques). Vint ensuite l’apport de la biologie moléculaire avec
l’analyse des chaînes métaboliques (chaîne respiratoire des quinones et des cytochromes, par exemple), des
activités enzymatiques (dégradation de polymères, estérases, catalase, …), des compositions des parois (types de
muropeptides, de mannanes, …) et des membranes externes (composition protéique), et surtout l’apport de la
génétique moléculaire (analyse des ADN chromosomiques et plasmidiques et des ARN ribosomiaux). La
génétique moléculaire est la base actuelle de la classification des bactéries (et la raison pour laquelle tant de
bactéries changent actuellement de nom).
Vu l’évolution des critères de classification, celle-ci a constamment évolué au grand dam des bactériologistes
médicaux et encore plus des cliniciens et des étudiants. Il faut souligner que « ce n’est pas le bactériologiste qui
s’amuse à rendre le monde bactérien complexe mais ce dernier qui, petit à petit, révèle sa complexité au
bactériologiste ». Cependant, grâce à l’implication de bactériologistes médicaux dans la bactériologie
fondamentale, notamment comme taxonomistes, toute nouvelle espèce bactérienne décrite, tout changement de
classification doit être étayé par l’existence de critères phénotypiques relativement aisés à mettre en évidence
dans un laboratoire de diagnostic bactériologique de routine. Par exemple, selon les critères génétiques, le genre
Brucella ne devrait comprendre qu’une seule espèce (et non une petite dizaine comme actuellement). Mais, il
serait impossible pour le monde médical de modifier la nomenclature actuelle d’un genre aussi important, aussi
garde-t-on la classification traditionnelle.
Une dernière remarque concerne le point de vue de la bactérie. L’esprit humain aime classer les choses qu’il
étudie, sinon il se sent perdu. Les bactéries n’ont, elles, besoin d’aucune classification pour vivre et subvenir à
leurs besoins, ni pour provoquer des maladies. N’oubliez jamais, au laboratoire, que la classification bactérienne
est une structure artificielle qui s’applique à un monde biologique bien réel dont le temps de génération est de
l’ordre de l’heure (en simplifiant à l’extrême) tandis que le nôtre est de l’ordre du quart de siècle ! Une
classification bactérienne ne peut donc, en aucun cas, être rigide ni fixée dans le temps, car des souches mutantes
apparaissent continuellement, qui possèdent des critères intermédiaires ou des nouveaux critères !
5 .1.2. L’espèce bactérienne

62
Le taxon de base est l’espèce bactérienne. Les bactéries faisant partie de la même espèce sont proches entre elles
morphologiquement, biochimiquement et, bien sûr, génétiquement. La définition actuelle du taxon « espèce
bactérienne » se situe plus précisément à hauteur des molécules d’ADN chromosomique : « deux souches
bactériennes appartiennent à la même espèce si leurs ADN totaux (chromosome + plasmides) montrent plus de
70% d’homologie (mesurée par hybridation avec l’ADN d’une souche de référence de l’espèce) et si les
température de fusion (ou de séparation des deux brins, Tm) molécules hybrides d’ADN diffère de moins de 5°C
(Tm<5°C) de la température de fusion des molécules natives respectives (souche de référence et souche
étudiée) d’ADN ». Aujourd’hui les chromosomes et plasmides de nombreuses espèces ets ouches ont été
complètement séquencés, permettant une analyse encore plus précise.
Au-dessous de l’espèce se trouve la sous-espèce, le plus petit taxon officiellement reconnu. La sous-espèce est
créée lorsqu’une espèce bactérienne est formée de différents groupes de souches, différentiables de manière
reproductible, phénotypiquement et génétiquement. Les souches d’une sous-espèce montrent plus de 85%
d’homologie des ADN. Entre sous-espèces d’une même espèce, l’homologie est comprise entre 70 et 85%.
5.1.2. Les genres et familles
Au dessus de l’espèce, les bactéries sont regroupées en genres et en familles. Ces regroupements sont basés sur
d’autres critères moléculaires (sources d’énergie, types de métabolisme énergétique, chaîne enzymatiques,
composition de parois, …). Parmi les bactéries Gram + le regroupement en genres est effectif, mais celui en
familles est encore peu utilisé. Par contre, dans le monde des bactéries Gram -, le regroupement en familles est
assez bien organisé et utilisé. Ces regroupements en familles même s’ils sont régulièrement remis en question et
réaménagé, sont très utiles dans l’enseignement de la systématique bactérienne.
Prenons l’exemple d’un groupe de bactéries Gram -, la famille Pasteurellaceae. Cette famille est composée de
plusieurs genres qui ont été regroupés, il y a quelques années, sur base de critères biochimiques (types de
quinones respiratoires) et génétiques (ARN ribosomiaux). Ces genres étaient Pasteurella, Actinobacillus,
Haemophilus et Histophilus. Par étude des ADN chromosomiques essentiellement, il a été montré que le genre
Pasteurella doit être subdivisé en 3 genres : Pasteurella « sensu stricto ». « Pasteurella » haemolytica et
« Pasteurella » pneumotropica. De plus, la seule espèce du genre Pasteurella sensu stricto (multocida) était très
hétérogène et ces mêmes tests ont permis de la subdiviser en près d’une douzaine d’espèces différentes. Toujours
par la même approche, certaines espèces de ces différents genres ont été redistribués dans d’autres genres de la
même famille (du genre Haemophilus vers le genre Actinocacillus par exemple) ou ont été exclus de la famille
(Taylorella equigenitalis par exemple). De plus, le genre « Pasteurella » haemolytica a été baptisé du nom de
Mannheimia, à la fin du XXème siècle.
5.1.3. Taxons supérieurs.
Les taxons supérieurs tels qu’ordres, classes et embranchements (ou phylum) sont établis sur base des séquences
des ARN ribosomiaux, mais sont peu, voire pas, utilisés pour les bactéries médicales. Les autres taxons

63
supérieurs sont les séries, divisions, règnes et domaines. Les séries et les règnes ne sont pas appliqués aux
bactéries. Les trois domaines sont les cellules eucaryotes, les (eu)bactéries et les archaebactéries ; les divisions
des eubactéries sont au nombre de quatre, par tradition :
1) Gracilicutes (gracilis = mince ; cutis = peau) à structure de paroi mince ;
2) Firmicutes (firmis = fort ; cutis = peau) à structure de paroi épaisse ;
3) Ténéricutes (tener = mou ; cutis = peau) sans paroi ;
4) Mendoxicutes (mendoxis = fautif ; cutis = peau) (sans intérêt médical).
Bien qu’un peu obsolète, cette dernière classification reste cependant intéressante sur le plan mnémotechnique.
5.2. Nomenclature bactérienne
La nomenclature représente un langage international qui permette d’appeler, par un même nom, des choses
identiques dans n’importe quel laboratoire ou clinique du monde entier. La nomenclature bactérienne est
binomiale et est réglementée par le code international de la nomenclature bactérienne, qui est, encore une fois,
une création purement humaine. Les noms scientifiques sont donnés sous forme latinisée. Ces noms sont issus du
grec et/ou du latin, mais aussi de plus en plus souvent du français, de l’anglais, ou d’autres langues modernes,
auxquels des préfixes ou suffixes latins sont ajoutés. Certains noms rappellent une maladie ou une lésion,
d’autres un scientifique, d’autres, encore, un métabolisme ou un lieu géographique.
Le nom du genre s’écrit avec une majuscule, celui de l’espèce avec une minuscule. Ils s’écrivent en italique (ou
bien sont soulignés). La seule revue officielle est l’ « International Journal for Systematic Bacteriology ». Les
noms pour les familles se terminent par –aceae. Lorsque deux espèces bactériennes classés séparément sont
rassemblées dans un même genre selon les nouveaux critères, ou deux genres dans une même famille, le critère
d’antériorité (ancienneté relative) des noms prévaut pour désigner ce genre ou cette famille.
La nomenclature prévoit encore quelques cas particuliers. La sous-espèce est notée subspecies (subsp) suivie
d’un nom latin en italique (ou souligné). L’appartenance d’une souche isolée au laboratoire à un genre, sans
précision de l’espèce, est notée du nom du genre suivi de sp. (species) tant que cet isolat n’est pas identifié à une
espèce. Lorsque l’on veut désigner toutes les espèces d’un genre, pour souligner un caractère biochimique ou
pathologique commun par exemple, le nom du genre est suivi de spp.
Dans diverses langues modernes, et dont la langue française, il existe de très nombreux synonymes non officiels
pour désigner une espèce bactérienne. Ces noms ont valeur historique (bacille de Koch pour Mycobacterium
tuberculosis, bactéridie charbonneuse pour Bacillus anthracis, par exemple). Certains de ces noms donnent
cependant naissance à des confusions (vibrion septique fait penser au genre Vibrio, alors qu’il s’agit de l’espèce
Clostridium septicum !) et, en règle générale, ne seront compris que par des francophones, au contraire des noms
scientifiques en latin.
Enfin, une espèce ou une sous-espèce peut être subdivisée en biovars (ou biotypes), en sérovars (ou sérotypes),
en lysovars (ou lysotypes) et en pathovars (ou pathotypes). Ces différents –vars sont des numéros, des lettres

64
et/ou des noms. Ces noms ne correspondent plus à des noms scientifiques. Ils s’écrivent donc normalement avec
une majuscule. Ils correspondent aussi à différents critères (maladies, origine géographique, etc.)
Pour poursuivre avec la famille Pasteurellaceae, l’exemple suivant illustrera ces différentes considérations. Que
signifie : Pasteurella multocida subsp multocida sérotype D toxinogène ?
La souche identifiée telle quelle appartient au genre bactérien Pasteurella sur base de critères morphologiques,
de cultures, de colorations et des tests d’orientation (catalase, oxydase, mobilité, O/F) ; à l’espèce multocida sur
la base de critères biochimiques par la biotypie ; à la sous-espèce multocida sur base des mêmes critères ; au
sérogroupe capsulaire D par la sérotypie ; et produit une toxine de nature dermonécrotique par la pathotypie.
Cette souche de l’espèce Pasteurella multocida, qui est associée à une affection du porcelet, la rhinite
atrophique, produit en effet une dermo-nécro-toxine spécifique de cette affection.
5.3. Systématique bactérienne
Bien qu’il n’existe pas de livre officiel de systématique bactérienne, le « Bergey’s Manual of Systematic
Bacteriology » est considéré comme l’ouvrage de référence. Cet ouvrage présente l’ensemble du monde
bactérien, à intérêt médical ou non. Il en est à sa 9ème édition en 4 volumes faisant un total de plus de 2500 pages.
La 10ème édition commence à sortir. La 1ère édition remonte à 1923 et comprenait pages moins de 400 pages.
Comme tout ouvrage de systématique quel que soit le domaine, le manuel Bergey’s est extrêmement aride à lire
et, comme tout ouvrage collectif, il est dépassé sur le plan de la classification et de la nomenclature au moment
même de sa parution. Malgré toutes ces critiques, il reste un excellent ouvrage à consulter surtout pour des
souches ou des espèces peu fréquentes en pathologie, identifiées au laboratoire de diagnostic.
Pour les bactériologistes médicaux et vétérinaires, il est forcément incomplet et insatisfaisant sur le plan de la
pathologie. Les ouvrages plus spécialisés sont repris dans l’engagement pédagogique. La suite de ce chapitre de
systématique bactérienne est présente sur le site sous forme de fichier Power Point. Ce fichier ne comprend
cependant aucune photo pour des raisons de « poids » de fichier et de droits d’auteur.
L’ordre dans lequel les différents groupes de bactéries importantes dans le domaine médical sont présentés varie
selon le présentateur. Dans la mesure du possible, j’ai basé celui-ci sur des critères que le cours défini et décrit
dans les chapitres précédents et que vous utiliserez en partie pendant les séances de travaux pratiques. Mais, ces
critères peuvent varier selon les bactéries. La tradition veut que l’on commence par décrire les bactéries Gram+,
suivies des bactéries Gram-. Le deuxième critère pris en compte est la morphologie. Ensuite, chacun suit sa
propre intuition. Parmi les bactéries Gram+, les critères supplémentaires sont les rapports avec l’oxygène et le
test catalase. Parmi les bactéries Gram-, les critères supplémentaires sont la croissance ou non sur milieux
sélectifs pour entérobactéries, les rapports avec l’oxygène, le test oxydase et le test O/F. Au total, ce chapitre du
cours propose sept grandes divisions des bactéries à intérêt vétérinaire, importante en pathologie et/ou en denrées
alimentaires d’origine animale (DAOA) : les coques Gram+, les bâtonnets Gram+, les bactéries Gram+ sans
paroi, les coccobacilles et bâtonnets Gram- poussant sur milieux sélectifs pour entérobactéries, les coccobacilles
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
1
/
49
100%