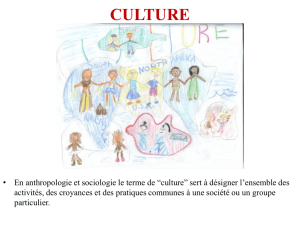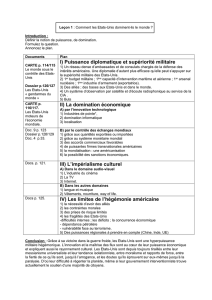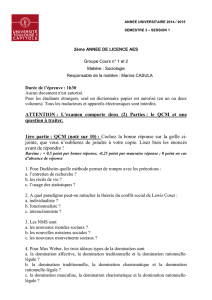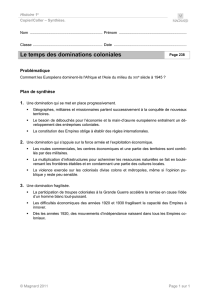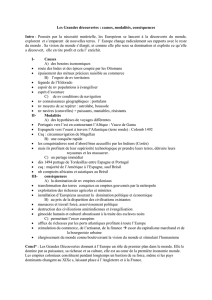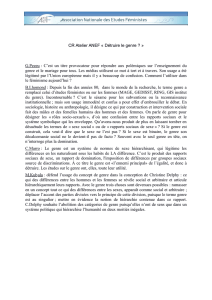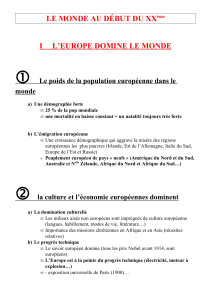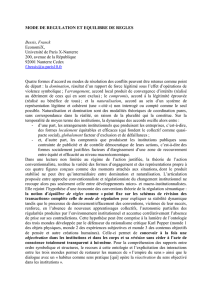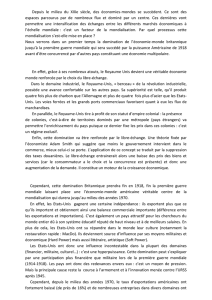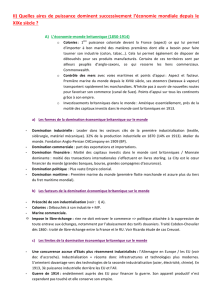Télécharger le fichier

Peut-on aujourd’hui encore considérer les relations sociales
comme des rapports sociaux de domination ?
La sociologie s’est constituée comme discipline autonome par le regard singulier qu’elle a porté sur les échanges
entre individus : elle considère en effet qu’ils sont sous-tendus par des phénomènes collectifs -des rapports
sociaux- entre groupes hiérarchisés. Au sein de la tradition sociologique, M. Weber a défini précisément la
domination comme une relation de pouvoir vécue comme légitime, ce qui lui a permis de dégager la diversité des
rapports sociaux de domination, par opposition à K. Marx se focalisant sur leur soubassement supposé
essentiellement économique. Mais ce paradigme des rapports sociaux de domination conçu il y a un siècle est-il
toujours aussi opérationnel aujourd’hui ?
I) La déprise de la domination…
A) Cette déprise résulte de la déconcentration et de la contestation du pouvoir en
démocratie…
- La démocratie s’enracine dans un espace social à part, affranchi de l’intérêt personnel et des rapports sociaux
de domination de la société d’ordre. J. Habermas a retracé la constitution de cet espace public (1962).par des
lieux et des instances autonomes de socialisation politique
- La déconcentration du pouvoir dans les sociétés démocratiques, anticipée par A. de Tocqueville (De la
démocratie en Amérique, 1848), a été confirmée empiriquement à l’échelon local : R. Dahl (Qui gouverne ?,
1956) dégage ainsi le rôle des « subleaders », qui relaient et portent auprès des instances officielles du
pouvoir les intérêts, l’opinion de la base. Ils ne sont pas issus de la bourgeoisie patricienne et possédante et
incarnent la déprise de la domination traditionnelle sur la vie politique.
- A l’échelon national et macrosocial, les mouvements sociaux procurent aux dominés des ressources pour
renverser les rapports de domination. Selon A. Touraine, la portée du mouvement ouvrier (1984) déborde
ainsi les revendications matérielles et engage un principe de totalité : c’est bien une historicité de la société
industrielle fondée sur la domination de classe qui en constitue le véritable enjeu.
- De façon plus générique, L. Boltanski et E. Chiapello (Le nouvel esprit du capitalisme, 1999) montrent que
les mouvements sociaux se réfèrent à des cités alternatives pour contester l’ordre dominant. Le mouvement
ouvrier a pu s’appuyer notamment sur la cité civique pour contester la cité marchande. La multiplicité des
cités donnent une autonomie aux agents par rapport à la domination.
B) … et de ses répercussions sur les hiérarchies sociales…
- La démocratisation a modifié la signification des relations sociales, a « égalisé les conditions » pour
reprendre l’analyse d’A. de Tocqueville. Le salariat, condition auparavant dominée, précaire voire indigne,
est ainsi devenue un statut, associé à des droits, notamment de protection sociale (R. Castel, Les
métamorphoses de la question sociale, 1995)
- Le processus de moyennisation questionne la permanence de la domination économique et culturelle. La
hiérarchie des revenus s’écrase et se représente plutôt aujourd’hui sous la forme d’un strobiloïde. Selon H.
Mendras (La seconde Révolution française, 1988), la signification sociale du barbecue ou du port du jean est

justement d’exhiber une atténuation et une dénégation par les classes moyennes des rapports sociaux de
domination. En transgressant ostensiblement les codes bourgeois, en mettant en scène une convivialité sans
apprêt, savamment improvisée – les mets ne sont pas cuisinés, la disposition des invités est libre-, on
s’efforce d’immuniser les relations sociales de la domination.
- En matière de consommation et de goûts culturels, la moyennisation se traduit par le passage d’une logique
de distinction à la logique de l’omnivorité (R. Peterson & R. Kern, « Changing highbrow taste : from sob to
omnivore », 1996), de « l’homme pluriel » (B. Lahire). Le clivage entre culture légitime et culture illégitime,
vecteur de domination symbolique, s’estompe.
C) … qui a infléchi le regard de la sociologie sur les relations sociales.
- En sociologie de la culture, C Grignon et J.-C. Passeron (Le savant et le populaire, 1989) ont montré que
l’ethnocentrisme académique était à l’origine d’un biais misérabiliste exagérant la domination culturelle,
tandis que sa dénégation pouvait procéder du biais symétrique du populisme.
- En déplaçant l’unité d’analyse sociologique du système à la relation, l’approche interactionniste révèle que
les relations de pouvoir ne sont pas inscrites dans des normes macrosociales, mais qu’elles sont construites,
négociées par les acteurs sociaux. Ainsi, à l’hôpital, la négociation autour des « dirty jobs » transcende et
modifie les hiérarchies professionnelles des statuts officiels (E. Hughes, Men and their work, 1958)
- L’interactionnisme stratégique partage cette relativisation des mécanismes de domination. Pour rendre
compte de la circulation de l’influence dans les relations sociales, il faut les envisager dans un « système
d’action concret ». Ainsi, se situer au contact de deux sous-systèmes, en position de « marginal-sécant »,
confère un pouvoir spécifique au sein des organisations, celui de l’agent d’entretien des machines dans une
usine taylorisée par exemple (M. Crozier, Le phénomène bureaucratique, 1963). Non seulement les relations
sociales se déploient en débordant les hiérarchies officielles, mais elles sont structurées par des règles elles-
mêmes négociées et jamais complètement imposées, comme le suggère la typologie de J. D. Reynaud
distinguant régulation « de contrôle », « conjointe » et « autonome » (Les règles du jeu, 1989).
- La sociologie des réseaux en cartographiant les relations sociales concrètes sans hiérarchiser leurs pôles pose
les « trous structuraux » (R. Burt, 1992) comme une ressource indépendante des logiques macrosociales de
domination.
II) … n’est que relative…
A) Déprise de la domination ou déplacement du regard sociologique ?
- L’expression « aujourd’hui encore » suggère un déclin historique de la domination. Sur le très long terme, la
division sociale du travail, en démultipliant les relations d’interdépendance, aurait sapé un ordre traditionnel
qui tirait justement sa force de n’être jamais questionné. L’ethnographie discute cette tendance : l’observation
de sociétés dites « primitives » montrerait qu’au contraire la domination serait un fait social moderne (P.
Clastres, La société contre l'Etat, 1974), ou du moins que la concentration du pouvoir varie selon les société
(J.-W. Lapierre, La société contre l’Etat ?, 1976). L’influence marxiste pourrait être à l’origine de la
pregnance de la domination dans l’analyse sociologique, tout particulièrement en France jusqu’à une période
récente.
- Ainsi, même à l’époque où la domination culturelle de classe faisait consensus en sociologie, le témoignage
de R. Hoggart (La culture du pauvre, 1957) mettait en exergue « l’attention oblique », la distanciation des

classes populaires vis-à-vis de produits culturels de consommation de masse considérés trop souvent et trop
vite comme aliénants. Plus tard, l’attention portée aux loisirs par la sociologie, dont participent les travaux
d’H. Mendras, conduit au constant d’un déclin de la domination, mais dans un domaine qui en a été peut-être
toujours exempt.
B) Déplacement de la domination de classe
- La moindre visibilité de la domination de classe n’équivaut pas à son déclin. La méthode sociologique
d’objectivation interfère sur le constat : là où des données brutes sur les pratiques culturelles peuvent
manifester une démocratisation ou un déclin de la culture légitime, l’analyse factorielle des correspondances
met en relief la métamorphose de mécanismes de domination qui sont toujours à l’œuvre. L’analyse
sociologique ne peut décrire ces mécanismes qu’en adoptant, hier comme aujourd’hui, une méthode
adéquate, qui représente l’espace social comme différencié et les positions sociales comme relatives.
- Ainsi, l’omnivorité culturelle peut être une marque nouvelle de distinction par rapport aux pratiques
culturelles exclusivement populaires, comme le reconnaît bien volontiers B. Lahire. La façon de consommer
les biens culturels de masse (au premier degré ou au second ?) apparaît ainsi dans les entretiens comme
marquant aujourd’hui une « barrière » au sens d’E. Goblot.
- Les transformations de la structure sociale au cours des 30 dernières années conduisent à reconsidérer a
posteriori la moyennisation des 30 Glorieuses comme une éclipse passagère plutôt qu’un déclin définitif de la
domination de classe : les statistiques de la mobilité sociale (C. Peugny, Le déclassement, 2009) comme
l’enquête de terrain (M. Cartier, I. Coutant, O. Masclet & Y.Siblot, La France des "petits-moyens", enquête
sur la banlieue pavillonnaire, 2008) vont dans ce sens.
C) Déplacement de la domination politique en démocratie.
- La démocratie estompe-t-elle véritablement les rapports sociaux de domination ? Dans son Traité de
sociologie générale (1917) , V. Pareto préférait l’expression de « régime plouto-démocratique » : ce n’est pas
le phénomène, mais la forme de la domination qui est spécifique aux sociétés démocratiques, qui resteraient
gouvernées par les lois immuables de la domination des élites. R. Michels (Les partis politiques, 1911) avait
mis en évidence ces tendances oligarchiques dans un parti a priori en pointe de la démocratisation, à savoir le
parti social-démocrate allemand.
- La croyance envers l’émancipation démocratique est également mise à mal par l’expérience de S.Milgram
(La soumission à l’autorité, 1974) : l’abdication du libre-arbitre jusqu’à attenter à la vie d’autrui sous couvert
d’une autorité légitime se retrouve dans les démocraties avancées.
- Le pouvoir politique en démocratie continue à soutenir la domination sociale : l’affinité des habitus entre le
personnel politique, les hauts fonctionnaires et les classes dominantes imprègne le fonctionnement du champ
bureaucratique, comme P. Bourdieu le montre à propos des transformations et de la mise en œuvre de la
politique du logement dans Les structures sociales de l'économie (2000). Pour autant, la démocratie n’est pas
équivalente aux autres régimes politiques, car la « référence à l’universel » y constitue une arme symbolique
efficace dans les luttes internes au champ bureaucratique.
- On retrouve ici l’analyse fondamentale de la domination par M. Weber : la modernité correspond au
passage de la domination traditionnelle, voire charismatique, à la domination légalo-rationnelle, non pas à un
hypothétique repli des rapports sociaux de domination. Les travaux de N. Mariot (Bains de foule, les voyages
présidentiels en province, 1888-2002, 2006) offrent ainsi une image nuancée de l’évolution de la domination

politique : la persistance des voyages présidentiels atteste le maintien d’un lien de nature charismatique ; leur
banalisation relative inscrite dans leur organisation (ils n’ont plus lieu le dimanche, ne font plus l’objet de
fêtes, mettent en scène le Président au travail et non en représentation, n’attirent plus les foules) la
rationalisation de la domination politique.
III) … et peut-être illusoire
Ces déplacements de la domination impliquent de nouveaux modes de légitimation. Si l’on se souvient de la
définition wébérienne de la domination comme une autorité légitime, naturalisée, peu questionnée, on
comprend que ces nouveaux modes de légitimation, moins perceptibles aux acteurs sociaux, et peut-être aussi
parfois à l’analyse sociologique, renforcent en réalité les mécanismes de domination.
A) De nouvelles formes d’intériorisation de la domination au travail
- En apparence, le reflux du taylorisme et la diffusion du toyotisme affaiblissent les hiérarchies
professionnelles adossées à la division verticale du travail, les salariés d’exécution étant de plus en plus
impliqués, sollicités, encouragés dans leurs initiatives. Les travaux de L. Boltanski et E. Chiapello entérinent
ce nouvel esprit du capitalisme, tout en en dégageant l’ambivalence : si l’aliénation taylorienne a
effectivement cédé à la critique artiste du second esprit du capitalisme qui a été incorporée aux méthodes de
management depuis les années 1970, la « cité par projet » soumet les salariés à des épreuves pour lesquelles
ils sont mal dotés, les nouveaux discours du management peuvent légitimer au nom de l’autonomie
individuelle et de la flexibilité la précarisation des travailleurs. La domination au travail est d’autant plus
forte que les individus vivent leur trajectoire professionnelle non plus comme une destinée collective, mais
comme la rétribution ou la sanction d’efforts et de talents individuels. Cette individualisation des rapports
sociaux de travail redouble une domination davantage intériorisée.
- Les travaux de S. Beaud et M. Pialoux étayent ces nouvelles formes de domination à l’usine (Retour sur la
condition ouvrière, 1999 ). Sous couvert d’une volonté affichée d’enrichir le contenu des tâches des ouvriers
et d’égaliser également les relations sociales, en instaurant par exemple le tutoiement entre les « opérateurs »
et les « moniteurs », la réorganisation du travail sous l’égide du toyotisme renouvelle la domination : la
charge cognitive s’accroît au fur et à mesure que la pénibilité physique du travail se relâche, et il est plus
difficile de résister à une autorité lorsqu’elle se vit sur le mode de la camaraderie. Paradoxal à l’aune de la
détérioriation objective des conditions d’emploi, le repli du syndicalisme chez les jeunes intérimaires se
comprend alors comme résultant en partie de cette occultation collective de la domination.
B) De nouvelles formes d’intériorisation de la domination politique.
- Dans une perspective de très long terme, la domination s’approfondit en recomposant l’économie affective
des individus. L’œuvre de N. Elias développe les étapes historiques de ce processus de civilisation :
curialisation des guerriers, diffusion du haut vers le bas de la hiérarchie sociale de nouvelles normes de
pudeur, monopolisation du pouvoir par un Etat central. L’assise du pouvoir est de moins en moins la
coercition physique, et de plus en plus l’auto-contrainte.
- Cette mainmise de l’Etat sur nos représentations gagne la sphère intime : F. Weber (Le sang, le nom, le
quotidien, 2005) montre ainsi comment le droit encode les relations familiales : les relations affectives d’une
enquêtée avec son beau-père sont influencées par les modifications de leur définition légale par l’Etat.

- L’intériorisation de cette domination politique se fait également par la peur et la culpabilisation : l’inflation
pénale aurait ainsi comme fonction selon L. Wacquant (Punir les pauvres, le nouveau gouvernement de
l'insécurité sociale, 2004 [2001]) d’imposer subrepticement, de rendre acceptable auprès de ses victimes la
précarisation systématique du travail.
C) L’intériorisation de la domination de genre
- C’est sans doute à propos de la domination masculine que la sociologie a le mieux dévoilé le caractère
potentiellement factice de l’atténuation des rapports sociaux de domination. B. Friedan avait souligné le
caractère indicible de leur domination pour les dominées elles-même : il s’agit d’un problème « sans nom »
(La femme mystifiée, 1963). La domination mystifie celles et ceux sur qui elle s’exerce. Ainsi le mécanisme
de « l’amor fati » fait parfois des dominé-e-s les plus ardents avocats de leur propre domination.
- Aussi, l’idéologie nouvelle de l’égalitarisme et de la négociation des rôles au sein du couple ne met pas fin à
la domination masculine, comme le montre J.-C. Kaufman dans La trame conjugale (1992)
1
/
5
100%