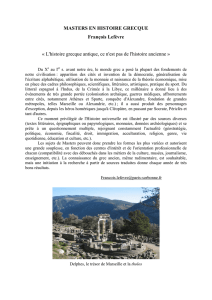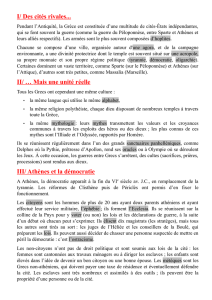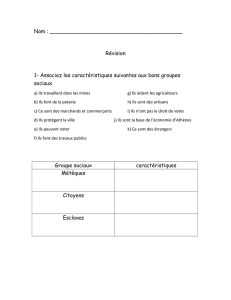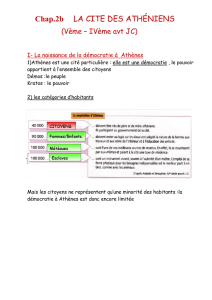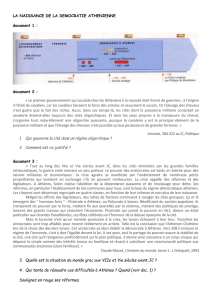histoire_grecque - Billard Club Saint

Introduction à la géographie du monde grec
La Grèce Antique est le monde des cites grecques comprenant la Grèce, la Turquie, le sud de l’Italie, la Sicile, les
côtes de mer Noire. Le monde grec antique se situe dans la partie orientale au centre géographique de la mer Egée où se
trouve le sanctuaire de toutes les cités (Delphes, Olympie).
I] Les grands ensembles
1) Généralités
La mer Méditerranée est une mer au milieu des terres (Europe au Nord, Asie à l’est et l’Afrique au sud) et s’ouvre
par le détroit de Gibraltar (Atlantique), le détroit de Bosphore (Mer Noire) et le Canal de Suez (ouverture artificielle au
XIXème siècle). La mer Méditerranée est cernée par les montagnes voire la haute montagne, à part l’Egypte et la Libye. Elle
est aussi divisée par des mers secondaires soit en bassin occidental ou oriental, soit des mers fermées (Adriatique, Golfe
du Syrte). La mer Egée fait partie des bassins secondaires fermés de la mer Méditerranée :
Ouverture sur la Crète et le détroit vers la mer Noire,
Entourée de montagnes par la zone balkanique d’où des soulèvements récents,
Issue d’un phénomène d’effondrement d’un plateau formé par deux montagnes.
La Grèce est un pays de montagne à 70-80% du territoire, la géographie du pays est compliquée et fragmentée.
2) Cinq régions
La Grèce du nord-ouest est une péninsule balkanique due à un prolongement de chaînes de montagnes dont les
Alpes Dinariques, la chaîne u Pinde qui est l’épine dorsale entre deux versants (est-ouest). La chaîne occidentale est
bordée par la mer Ionienne tournée vers la mer Adriatique. Le climat est doux, tempéré et les régions sont boisées d’où
peu de cités à part dans les îles Ionienne avec Corcyre (ou Corfou).
Le versant oriental est une façade tournée vers la mer Egée et subit un climat sec, semi-aride avec des orages
violents et un été long. Morphologiquement, ce bassin de la mer Egée se divise par la plaine de la Macédoine, de
Thessalie, de la Béotie (Thèbes), de l’Attique (Athènes, Mégare).
La Péloponnèse est constituée par la chaîne du Pinde coupée par un effondrement et ensuite envahie par la mer
(Golfe de Corinthe). C’est une vaste presqu’île orientée vers le sud, vers l’isthme de Corinthe, c’est également un vaste
massif montagneux, compact, élevé (2 000 mètres). On retrouve trois corps dirigés vers l’Afrique, divisés par des plaines
côtières d’est ou ouest dot la plaine de Messénie, de Laconie, de l’Argolide. La Péloponnèse et une région de cités
importantes dont Corinthe, Argos, Sparte et Elide.
La mer Egée, elle-même, est un vaste plateau effondré où émerge des sommets immergés qui forment une centaine
d’ensemble d’îles. Les îles du nord sont éloignées, étendues dont l’île de Thassos. Les îles du centre comprennent l’île de
Délos et l’île de Sporades qui sont des îles en forme de cercle (quiqlos = cycle). La Crète constitue un grand mur de
montagnes entre la mer Egée et la mer Méditerranée et est un archipel.
L’Asie Mineure est une péninsule anatolienne, une partie avancée du continent asiatique (Turquie). Ce territoire est
une immense masse montagneuse soulevée du Moyen-Orient vers un plongeon dans la mer Egée. L’immense plateau
anatolien, dont fait parti Ankara, s’abaisse et se fractionne dans la mer (île de Samos). Le Méandre est un fleuve puissant
dans la région grecque, ce phénomène de méandres est dû à l’alluvionnement crée peu à peu de la plaine côtière gagnant
du terrain sur la mer. La partie inférieure n’appartient pas au monde grec et la façade maritime grecque s’étale de l’île de
Samos, Milet à Ephèse.
II] Les contraintes du milieu
1) La terre et les hommes
Le paysage grec varié est dû aux contraintes climatiques livrant une zone dure pour l’homme par ces conditions
naturelles difficiles. La Grèce admet un certain type de culture que l’on nomme la Triade méditerranéenne (céréale avec
le blé et l’orge, l’olivier et son huile, la vigne). Chaque cité vit en autosubsistance pour l’idéal mais il y aussi des
exportations entre elles. Les cultures s’organisent en plusieurs niveaux, un système d’étagement sur trois niveaux :
La plaine donne une récolte des céréales, des vignes, des légumes et des fruits réclamant beaucoup de
main-d’œuvre pour un effort de drainage afin de transformer la terre en marécage. La main-d’œuvre doit
faire effort de bonification des sols marécageux, le mode de production exige de laisser les terres en
jachère un an sur deux.
La colline est le lieu des cultures d’oliviers d’où l’aménagement en terrasses. Pour changer le paysage en
terrasse, il faut un travail titanesque à les faire et également à les réparer car les terrasses ont tendances à
se désagréger souvent.

La montagne est une zone inculte où o travaille l’élevage des moutons et des chèvres pour leurs viandes,
leurs laits et leurs laines. C’est une zone de maquis et de garrigue, et est généralement la zone frontalière
des cités limitrophes.
L’agriculture grecque est une poly-agriculture vivrière, toutes les gammes de denrées de bases à la société humaine
sont cultivées. Le régime alimentaire est frugal et peu varié (galette, pain, bouillie, soupe, fromage, huile, vin) avec
rarement de poissons et très rarement de la viande. La pluviosité est faible et très irrégulière, et menace l’équilibre
agricole des cités et l’équilibre des récoltes. La menace de la disette étant permanente détermine un réseau d’échanges
commerciaux.
2) Relations maritimes
Les relations maritimes sont abondantes car les relations par voies terrestres sont très difficiles. La plupart des cités
grecques dispose d’un port et les relations maritimes s’organisent à deux échelles :
Les relations locales relient la mer deux cités quotidiennement, pour exemple, Athènes avec Salamine. La
cabotage (biens que l’on échange) introduit un commerce de proximité.
La navigation à grande distance se fait pour le transport du bois de construction (sauf au sud), des
métaux (étain, cuivre venant de l’Occident et de Chypre), des céréales (blé par la Sicile, l’Egypte et la mer
Noire). La route du blé est la voie maritime de l’Occident vers la Sicile, en allant de la mer Egée à la mer
Noire. Il y a une dépendance économique égéenne reliée par des grandes routes commerciales donnant
pour la plupart, l’origine des expansions territoriales et de la colonisation.

Le monde grec au IIème millénaire avant notre ère
Les archéologues distinguent deux étapes, l’âge du bronze et l’âge du fer. Les deux âges successifs existent pour
toute l’Europe avec des dates différentes. En Grèce, l’âge du bronze est entre le IVème siècle et le IIème millénaire. Les grecs
ou les hellènes sont une population, une ethnie et viennent d’un peuple indo-européen de l’Eurasie centrale caractérisée
par une langue grecque et des pratiques religieuses particulières. C’est la civilisation mycénienne, nous allons voir son
développement et sa disparition.
I] Les premiers états grecs
1) Premier développement : les protomycéniens (1650-1450)
Les protomycéniens s’installent dans la façade du Péloponnèse et forment une société en 1650. On a retrouvé aucun
texte mais des vestiges archéologiques dont des zones d’habitats, des tombes, des sépultures. Grâce à ses vestiges
architecturaux, on voit une société organisée par des centres de pouvoir dans le Péloponnèse (Mycènes, Pylos) et la Béotie
(Thèbes). Cette société est dirigée par des princes territoriaux ayant tous les pouvoirs. Les tombes regroupent des familles
de même clan dynastique et des familles princières. La matière des tombes et les objets ornant ces tombes viennent de
loin. On y trouve également des armes d’apparats de guerre et de chasse, les activités aristocratiques par excellence. Les
grecs ont mis peu à peu une société hiérarchisée avec une série de petites principautés dans la Grèce et le sud placée sur
des plates-formes. Les tombes sont de plus en plus enrichies par des relations lointaines (Egypte, Europe du Nord) d’où
un enrichissement des sociétés grecques. On parle de protomycénien avant de parler de mycénien.
2) Le rôle des minoens
Les princes protomycéniens étaient contemporains d’une civilisation développée, les minoens installés sur l’île de
Crète depuis longtemps parlant une autre langue. La civilisation minoenne est un développement extraordinaire au le
IIème millénaire (2000-1450). La civilisation est fondée sur des grands états centralisés autour d’un immense palais,
civilisation palatiale. La Crète est divisée en quatre grands royaumes, Cnossos, Malia, Zakros et Phaistos. Vers 1700, les
quatre royaumes ont fondu en un seul le royaume de Cnossos. Toute l’organisation est gérée par un palais central. Le
palais prélève une part importante de son royaume par des scribes, des comptables où à l’intérieure des administrations
parsemées sur le territoire. Les minoens se distinguent de leur art et de leur production d’outils. Les objets crétois dans
leurs tombes sont un signe de richesse. Les minoens vont avoir une influence fondamentale sur la civilisation grecque.
3) L’ère des palais mycéniens (1450-1200)
Le modèle de la Crète va donner une mutation sur les petits royaumes protomycéniens qui vont se transformer en
grands états palatiaux. Les princes mycéniens vont faire la conquête de la Crète et détruire complètement le palais
principal de Cnossos. Ils vont coloniser l’île où des peuples hellénophones s’y installent et vont devenir la population
grecque. La Crète fait partie du monde grec (1450). Le rayonnement ancien minoen a une influence sur la Grèce
mycénienne qui va s’organiser en cinq grands états palatiaux, Mycènes, Tirynthe et Pylos dans le Péloponnèse, et Thèbes
et Cnossos en Crète. Ces cinq grands états vont connaître 250 années brillantes et vont établir à un état centralisé. Cet état
compte parmi les plus avancés du monde méditerranéen.
Ces royaumes vont s’effondrer les unes après les autres pendant 100 ans (1300-1200) et vont disparaître. Des
hypothèses sont émises sur le mystère de cette disparition dont les grandes invasions, les grandes catastrophes naturelles
dues à un changement climatique. Soit ces royaumes guerriers se sont éliminés au cours de guerres, soit le système
d’organisation rigide s’est effondré de lui-même ou les deux ensembles.
II] Les rois mycéniens et leurs palais
1) Le pouvoir royal
Les palais de Mycènes et de Pylos sont dirigés chacun par le Wa-Na-Ka (roi) qui siège dans leur capitale respective
du royaume. Le Wa-Na-Ka a des privilèges fonciers réservés, un culte royal et poursuit une aristocratie, une caste de
chefs héréditaires installées dans les quatre coins du royaume, les BasiLeus. Le BasiLeus dirige son état et contrôle
personnellement l’administration secondée par un premier ministre appelé le La-Wa-Gétas. Les états sont divisés en
provinces, eux-mêmes en district. Le Wa-Na-Ka transmet ses ordres et nomine les dirigeants de ces subdivisions.

2) L’exemple de Mycènes
Le palais de Mycènes domine son territoire, son système de fortification est détruit puis renforcé. Le palais est
l’appartement du roi sur la partie haute de la ville. Une pièce centrale à quatre colonnes précède un vestibule qui est une
pièce d’apparat (mégaron). On trouve dans le palais un appartement d’habitation, d’archives, de stockage et des pièves
consacrées aux cultes. Sur la partie basse, la ville occupe cet espace de production, d’objets, de biens où le roi en et le roi.
Les tombes sont situées en haut de la ville en forme de rond. Le palais concentre le pouvoir militaire, économique et
politique.
III] L’économie palatiale
Outre les vestiges, nous avons des documents écrits trouvés dans les pièces d’archives, ce sont les premiers
documents écrits de l’histoire grecque transcrits. La langue grecque n’est pas alphabétique mais se transcrit par signes
pour chaque syllabe, l’écriture grecque est de type syllabique appelé linéaire B d’où des nouvelles fabrications
d’instruments pour la retranscription. On retrouve peu de documents à part des textes courts sur des tablettes d’argiles
(quelques lignes) conservant des comptes provisoires (denrées alimentaires, liste des habitants) retranscrits par des
scribes. Parmi ces documents, il n’y en a aucun définitifs, seuls les documents partiels sont conservés. Les tablettes
d’argiles ont été cuites par un incendie et ont traversé les millénaires pour ensuite nous parvenir. Les documents
concernent l’année précédente de la dernière année de vie du palais détruits par l’incendie final. Les peu de documents
nous livrent un instantané, une prise sur le vif sur la vie du palais.
Les documents nous apprennent qu’il existait un large système fiscal en nature sur la production agricole du
royaume. Le roi donnait des ordres de prélèvements qui sont repartis de façon plus ou moins proportionnelle dans le
royaume. Des celés sont mis sur les contenants de denrées au départ de la campagne et à l’arrivée au palais, on liste ces
biens. Ces productions prélevées sont la laine, l’olivier (huile) et les bêtes pour les sacrifices (moutons, bœuf, chèvre). Les
biens étaient consommés soit par le roi ou des matières premières de production industrielle dans des ateliers dispersés
dans le royaume. Ces ateliers d’états produisent du textile, des vêtements, les huiles parfumées, les objets métalliques
(armes, outils) d’où un besoin d’ouvriers et d’ouvrières qui sont des hommes, des femmes libres ou des esclaves. Le roi
avait autorité sur les ateliers de broderie, de tisserie et de forgeron.
Les documents montrent que le roi versait à ses ouvriers des rations alimentaires. Cette production d’état est
exportée par le roi dans son royaume ou à l’extérieur notamment des céramiques mycéniennes contenant de l’huile
retrouvées en Italie, en Asie Mineure, au Proche-Orient, en Mer Egée et en Egypte. Cette industrie a dû faire la fortune
des ros pendant 250 ans.
Les peu de documents retrouvés sont maigres et concernent une organisation élaborée et rigide inspirée du modèle
crétois à partir de 1450. L’Etat fort a disparu vers 1200 sans laisser de traces, des cendres vont naître (âges obscures) et
beaucoup plus tard (200 à 300 ans) donneront les cités grecques (micro états).

Le monde grec à l’époque géométrique (1200-750)
Et à l’époque archaïque (750-500)
I] Des palais mycéniens aux cités
1) Période géométrique : transition (1200-750)
Les états palatiaux mycéniens s’effondrent où suit une longue période de régression en Grèce. Cette période
connaît un déclin matériel avec aucune ville et aucun habitat, un déclin économique et commercial où les échanges
commerciaux entre la Grèce et l’autre partie du monde méditerranéen cessent. On suppose également un déclin culturel
où les grecs perdent l’usage de l’écriture (fin du système linéaire B), un déclin démographique entraînant une
désorganisation de la société. Les tombes deviennent extrêmement rares à cause d’une dépopulation massive du nombre
d’habitants. Ce recul global est appelé les âges obscures (le Moyen Age grec). On connaît de mieux en mieux cette période
grâce à l’archéologie, elle est nommée l’époque géométrique car les vases sont décorés par des motifs faciles à reconnaître.
Cette époque géométrique dure entre 1200 et 750 avant notre ère.
La Grèce connaît de grands mouvements de population. Les grecs partent en masse, traversent la mer Egée et
viennent en Asie Mineure. La migration ionienne (1200-900) accroît l’étendu helléniste. La Grèce balkanique connaît un
déclin général mais toutes les formes sociales ne sont pas disparues. Les grecs ont conservé certains traits de leur
civilisation dont la langue et la religion. Ils doivent essayer de réorganiser la société. On perçoit cette reconstruction au
bout de deux siècles (1000) dans la région de l’Eubée et en Adique (Athènes). On y a découvert des tombes recouvertes de
céramiques et d’objets importés du Proche-Orient. Par exemple, la tombe de Lefkandi est une tombe d’un chef où se
trouve aussi sa femme et ses quatre chevaux. Ce chef guerrier riche a dû recevoir des funérailles grandioses, c’est la trace
d’une société organisée où on trouve autour de cette tombe, un habitat. Cette société se structure comme un groupe
cohérent qui va devenir peu à peu la première cité.
2) Lente émergence des cités (750-500)
Au milieu du VIIIème siècle, on a une organisation de la société et une accumulation de matériel. Le VIIIème siècle
marque une nette remontée démographique (hausse du nombre de tombes et des habitats). La croissance économique est
due à la reprise définitive des échanges commerciaux avec le Proche-Orient. Les grecs prennent le même système de
l’écriture alphabétique à la Phénicie. Les premiers textes en grec datent du milieu du VIIIème siècle avant notre ère.
Dans chaque communauté locale se matérialisent des villes, des agglomérations urbaines avec des maisons, des
rues. La première ville grecque du Ier millénaire avant notre ère est Smyrne à la fin du VIIIème siècle, qui est une véritable
asty au sens grec. Cette ville nouvelle est rattachée à des terroirs agricoles, les communautés urbaines vont délimiter ces
terroirs donnant à des territoires o cette définition spatiale donnera à terme des conflits de frontières. La communauté
victorieuse montre sa domination avec l’apparition de sanctuaires ruraux assez loin des villes, aux confins du territoire
pour démarquer limites urbaines. La communauté y vit sa religion et balise par ces sanctuaires toute la zone territoriale.
Le phénomène de la mutation mentale a contribué au passage de la communauté à la cité. Les membres de la
communauté développent l’appartenance à un même groupe grâce à l’expérience de la guerre des frontières augmentant
le sentiment collectif, la cohésion (le combat des phalanges). L’appartenance à un groupe se fait sentir lorsqu’une
communauté se distingue au niveau religieux où elle se choisit des dieux, des héros. Chaque communauté élabore son
panthéon de divinité, son identité religieuse à travers des mythes et des légendes que chaque cité confectionne.
Chaque cité cherche à développer un art particulier comme le style corinthien (statue de bronze) ou le style argien,
d’Argos. La tendance générale au VIIIème siècle est que chaque communauté définit son territoire, sa religion, la solidarité
de ses habitants. Le monde des premières cités (une centaine au total) a vu naître une œuvre capitale, les poèmes
homériques. Ce sont les premières oeuvres écrites de la littérature grecque et européenne. Ces longs récits en vers
comprennent l’œuvre de la Guerre de Troie dans l’Iliade, et l’Odyssée (Ulysse), toutes écrites entre 750 et 700 dans une
cité de l’Asie Mineure. Les anciennes poésies représentent non pas un monde réel mais un monde imaginaire hétéroclite.
Les œuvres célèbres d‘Homère sont la référence majeure des grecs où les enfants apprennent à les lire et à les réciter.
Homère fixe la globalité de la religion grecque.
II] L’époque archaïque, l’expansion des cités
1) La guerre des frontières
Le premier grand acte de l’histoire de la cité est la colonisation, les colonies deviennent indépendantes de la
métropole et de nouvelles cités se retrouvent dans des zones extérieures à la mer Egée (Fini le temps où on s’empare
sauvagement des terres et où on les exploitait !). Avec l’extension territoriale, les grecs doivent être des marins actifs sur
les routes maritimes méditerranéenne. Les grecs font du commerce avec l’Orient (produit local, de luxe, l’alphabet)
notamment avec l’Egypte des pharaons pour le blé. En 620, les grecs obtiennent la fondation d’un comptoir égyptien à
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
1
/
42
100%