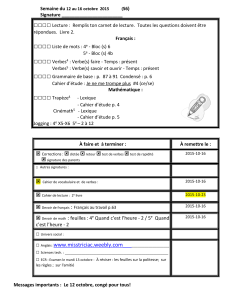Verbes de déplacement

REVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE
TOME XXII BUCAREST, 1977 N° 1, p. 42-61
DISTRIBUTION SÉMANTIQUE DES PBÉFIXES VEEBAUX
EN FRANÇAIS MODERNE
PAR
PAÏSSY HRISTOV
Les dérivés résultant de l'adjonction d'un préfixe à une forme verbale de base se
justifient par la nécessité d'une caractérisation synthétique du procès. Le problème des
valeurs des préfixes a fait l'objet d'un grand nombre d'études linguistiques (N. Dănilă, «
Sur la vitalité de la dérivation en français et en roumain », in Recueil d'études
romanes, p. 51—61 ; A. Dauzat, L'appauvrissement de la dérivation en français, ses
causes, “ La Français moderne », 1937, № 4, p. 289 — 300 ; J. Dubois, J. L. Guilbert,
La formation du système préfixal intensif en français moderne et contemporain, « Le
Français moderne », 1961, № 2, p. 87 — 112 ; J. Peitard, Recherches sur la préfixation
en français contemporain, Thèse, Paris III, 1971, etc.). Certains linguistes accordent
dans leurs études plus d'attention aux préfixes et négligent injustement la valeur
verbale; d'autres, tenant compte avant tout du sens du verbe, assignent aux préfixes des
significations qui leur sont étrangères.
Nous nous proposons d'étudier les possibilités combinatoires des préfixes
verbaux en français moderne dans leur rapport avec le verbe dont le procès est soumis
à une caractérisation. Une telle étude ne peut prétendre d'être exhaustive. Epuiser tous
les cas de combinaisons entre les préfixes et les verbes de base serait une entreprise
colossale qui constituerait plutôt une énumération des différents rapports entre les deux
éléments composant l'unité préfixale et de leur réalisation dans la langue sans être
nécessairement une étude théorique.
La solution du problème de la distribution sémantique des préfixes verbaux

nécessite un classement préalable des verbes de départ qui tienne compte du caractère
du procès exprimé. Nous adoptons les principes théoriques élaborés par K. Mantchev
dans son étude Hiérarchie sémantique des verbes français contemporains (in «Cahiers
de lexicologie », Paris. 1967, № I, pp. 31 — 46). L'auteur, fondé sur la constatation que
« le verbe qui est le générateur de la phrase doit impliquer avant tout le rapport reliant
le sujet à l'objet » (p. 32), fixe les trois positions fondamentales être, avoir et faire dans
leur suite chronologique (il s'agit de la genèse de l'idée verbale). Nous nous permettons
de reproduire le schéma en question :
S ÊTRE AVOIR FAIRE О
« Ces trois verbes sont à la base du système verbal. Tous les autres peuvent se ramener
à être, avoir ou faire » (p. 34). «... Le verbe être révèle la dominance du sujet, le verbe
avoir met presque sur le même plan le sujet et l'objet (avec une légère insistance sur le
sujet), le verbe faire oriente la dominance tantôt vers le sujet, tantôt vers l'objet :
FAIRE LE NAÏF, FAIRE LA CHAMBRE » (p. 36
К. Mantchev souligne l'existence de trois constructions pour le verbe être :
construction absolue ÊTRE1 (le verbe y est l'équivalent d'EXISTER), construction
attributive ÊTRE2 (le verbe y est copulatif) et construction circonstancielle ÊTRE3 (p.
ex. être quelque part) (op. cit., p. 36).
« Les verbes modaux tels pouvoir, vouloir, devoir suivent immédiatement le
verbe être, l'englobent et accusent une approche plus ou moins forte du verbe avoir
sans jamais l'atteindre » (op. cit., p. 36—37).
Entre le verbe avoir et le verbe faire se situent les verbes de perception tels que
éprouver, sentir, entendre, voir, connaître, comprendre, concevoir, etc. (op. cit., p. 37
— 38).
« Le passage de la tension de l'objet — faire à sa détension - être engendre
d'autres verbes» (p. 38); faire + être —>naître (pour les animés) et paraître (pour les
inanimés).
Nous nous sommes permis de schématiser à l'extrême les positions qu'occupent

les verbes fondamentaux dans la genèse de l'idée verbale et nous les adoptons comme
point de départ dans l'étude distributionnelle des préfixes.
Dans notre thèse sur la sémantique des préfixes verbaux en bulgare et en français
(Véliko Tirnovo, 1974) nous avons constaté qu'à l'exception du préfixe en-/em-/ qui
présente deux valeurs dans ses combinaisons avec un verbe (la pénétration dans un
objet et l'éloignement), les valeurs contextuelles des autres préfixes peuvent se ramener
à une seule valeur de langue, suffisamment générale pour pouvoir couvrir des
applications discursives plus ou moins distinctes. Comme la préfixation occupe une
position intermédiaire entre le plan de la langue et le plan du discours et repose sur
l'ébauche des valeurs discursives pour pouvoir se réaliser (ce n'est pas avec sa valeur
initiale que le verbe naître entre en combinaison avec le préfixe re-, mais plutôt avec
une acception contextuelle concrète : « Quand on renaît à l'espérance…»), nous
devons examiner les occurrences possibles d'un verbe donné pour juger de son pouvoir
combinatoire avec les préfixes. Cette analyse nous permettra de voir à quelle étape de
l'évolution de l'idée verbale apparaît tel ou tel préfixe et en quoi consiste sa valeur
linguistique. Nous aurons comme points principaux de notre étude les positions
fondamentales qui marquent la genèse de l'idée verbale.
A. Le verbe être et les verbes qui lui sont assimilables
I. La position ÊTRE1
«ÊTRE1 pose l'existence de toute matière, susceptible d'être pensée
linguistiquemeiit. C'est la première position du système idéogénique du français. . .
ÊTRE1 a pour essence (...) de poser l'existence des choses dont on parle... ÊTRE1
signifie "exister" sans plus, Exister est, si l'on peut dire, la réalisation de ÊTRE1, son
aspect extérieur ; celui-là est chargé d'une matière plus grave que celui-ci »
1
.
Des citations ci-dessus il ressort que ÊTRE1 est une position virtuelle qui pose
l'existence d'une chose sans impliquer aucune autre précision (ni dans le temps, ni dans
l'espace). C'est ce fait qui explique le peu d'emploi de ÊTRE1 dans le discours (je pense
donc je suis, il était une fois. .., Jean n'est plus). Il n'est pas difficile de comprendre
1
K. Mantchev, Hiérarchie sémantique des verbes français contemporains, «Cahiers de lexicologie», Paris, 1967, 1, 31-10.

alors pourquoi ÊTRE1 refuse d'admettre une qualification préfixale. La préfixation
demanderait un champ d'applications discursives plus étendu.
Comme il a été dit plus haut, c'est exister qui s'avère la matérialisation la plus
pure de ÊTRE1 en discours tant pour les sujets animés que pour les sujets non animés.
L'existence du sujet est posée par le verbe même dans le temps. Si deux sujets A et B
sont posés comme existants, trois rapports temporels sont possibles:
A existe avant В =A préexiste à В
A et В existent ensemble =A et В coexistent
A existe après B
On voit que les deux premières de ces trois positions trouvent leur réalisation
linguistique dans les unités préfixales : préexister (antériorité) et coexister
(simultanéité), (C’est sans doute la loi de l'économie qui a empêché la réalisation
préfixale de la troisième position, étant donné que préexister suffit déjà à rendre ce
rapport : В préexiste à A. L'apparition des deux préfixes pré- et со-(сum-) devant le
verbe exister ne signifie pas encore qu'il s'agit de préfixes de même nature. Si pre-, à ce
stade du développement du procès, exprime un rapport temporel, со- implique, en
outre, l'idée de pluralité des sujets qui agissent ensemble. Ainsi arrivons-nous à
distinguer deux tendances dans la caractérisation synthétique du procès — la première,
qui le situe dans le temps par rapport à un procès semblable dont le sujet est différent, et
la deuxième — qui regarde le procès du côté du nombre des agents qui y sont engagés,
et lui confère une valeur cumulative orientée vers le sujet. Nous sommes en présence
d'un syncrétisme linguistique sui generis.
La caractérisation du procès exprimée par les préfixes pre- et co- n’affecte en
rien le procès même ; il s'agit simplement d'une localisation dans le temps et en partie
dans l'espace. C'est la raison pour laquelle on peut parler ici de caractérisation
extrinsèque du procès. L'homogénéité entre les préfixes temporels et ÊTRE1 est
évidente et on pourrait considérer ces préfixes comme existentiels.
L'existence des sujets animés trouve une expression spéciale dans le verbe vivre dont le
contenu sémantique se ramène facilement à être en vie : Les corbeaux vivent très

longtemps (PL). Ce verbe pose l'existence de la matière vivante et laisse entendre un
procès limité des deux côtés, sa limite initiale étant naître et sa limite finale — mourir.
Comme la vie organismes est un processus d'orientation prospective, on peut s'attendre
à une caractérisation temporelle qui vise la durée du procès par rapport à un autre
procès, c’est-à-dire qui exprime une existence postérieure à une autre. Si pour le verbe
exister étaient possibles les deux premières positions (préexister, coexister), pour vivre
c'est la troisième qui s'impose (survivre) — II n'est pire mort que de survivre à
l'honneur). L'absence de prévivre pourrait s'expliquer par l'orientation rétrospective de
pré- qui est contraire à celle de vivre. Si toutefois l'expression de l'antériorité s'impose,
elle est réalisée adverbialement (il a vécu avant). Le manque de la position
intermédiaire de simultanéité pour le verbe vivre est compensé par cohabiter où
l'existence est posée dans l'espace par rapport à l'endroit où l'on vit (où l'on habite). De
cette façon le verbe vivre rejoint la troisième position ÊTRE3 qui nécessite une
caractérisation spatiale.
Il n'est donc pas difficile de voir dans le verbe vivre la réplique intégrale du
verbe être quand le sujet est animé :
Il n'est plus = Il ne vit plus.
Il est seul == Il vit seul
Il est à la campagne = Il vit à la campagne.
D'autre part, vivre nous offre la forme revivre qui indique le processus repris,
renouvelé. A la différence des préfixes déjà rencontrés. re- n'exprime pas le rapport
entre tel procès et tel autre, ni une caractérisation du procès. Il s'agit d'une valeur très
générale de reprise ou de répétition plus ou moins identique qui théoriquement peut
s'appliquer à tous les procès impliquant un commencement. Si être et exister refusent la
construction avec re- c'est parce que ces verbes n'incluent pas la limite initiale du
procès. Le verbe vivre s'éloigne de ÊTRE1 parce qu'il présente l'existence comme un
procès en développement qui seul est compatible avec l'idée de reprise.
La reprise qui n'est autre chose que l'idée condensée de faire dans le cas où le
procès est repris, agit sur le verbe vivre pour le ramener à la limite initiale de l'existence
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%