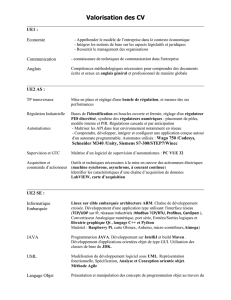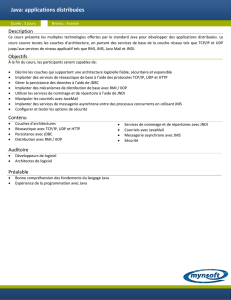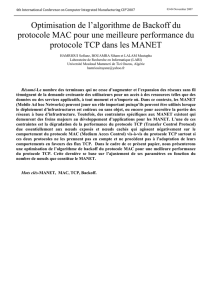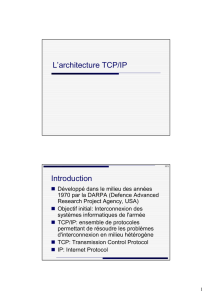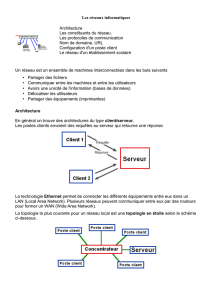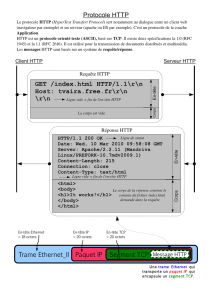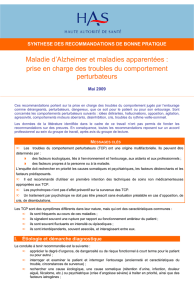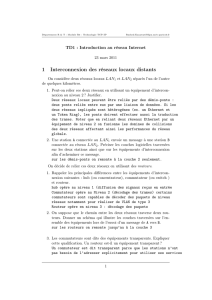3 Initiation à l`utilisation du réseau sous LINUX

THEYS Alban MAUSSAND David MEILHAC Alexis
3BIRT02
1/25
TP02 :
Environnement TCP/IP
sous LINUX

THEYS Alban MAUSSAND David MEILHAC Alexis
3BIRT02
2/25
Sommaire
1 GENERALITES .................................................................................................................................................. 3
1.1 LES GRANDS PRINCIPES DU MODELE OSI ........................................................................................................... 3
1.2 PRESENTATION D’ETHERNET ........................................................................................................................... 3
2 ETHERNET ET INTERNET ................................................................................................................................. 4
2.1 VISUALISATION APRES AVOIR TAPE IFCONFIG : .................................................................................................... 4
2.2 VISUALISATION DU FICHIER /ETC/HOSTS ............................................................................................................ 5
2.3 SITUATION DU PROTOCOLE IP DANS LE MODELE OSI ........................................................................................... 6
2.4 FORMAT DES PAQUETS IP .............................................................................................................................. 6
2.5 COMMANDE PING ........................................................................................................................................ 8
2.6 LE PROTOCOLE ARP ...................................................................................................................................... 8
2.7 PROTOCOLE INVERSE AU PROTOCOLE ARP ........................................................................................................ 8
3 INITIATION A L’UTILISATION DU RESEAU SOUS LINUX ................................................................................. 9
3.1 COMMANDE PING ........................................................................................................................................ 9
3.2 DIFFERENCE ENTRE TELNET ET RLOGIN .............................................................................................................. 9
3.3 CONNEXION A LINUX ................................................................................................................................... 10
3.4 LANCEMENT D’UN PROGRAMME LINUX A DISTANCE ......................................................................................... 10
4 TCP ET UDP ................................................................................................................................................... 10
4.1 SITUATION DANS LE MODELE OSI .................................................................................................................. 11
4.2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES.................................................................................................................... 11
4.3 VISUALISATION DU FICHIER /ETC/PROTOCOLS .................................................................................................. 11
4.4 VISUALISATION DU FICHIER /ETC/SERVICES ..................................................................................................... 12
4.5 LISTE NECESSAIRE ET SUFFISANTE POUR DEFINIR UNE ASSOCIATION ENTRE 2 MACHINES ............................................ 14
4.6 COMMANDE LINUX NETSTAT ....................................................................................................................... 14
4.7 SCHEMA DE ROUTAGE DU RESEAU DU DEPARTEMENT ......................................................................................... 16
5 RPC ET XDR ................................................................................................................................................... 16
5.1 PRESENTATION .......................................................................................................................................... 17
5.2 LA PILE TCP / IP ........................................................................................................................................ 17
6 NFS ................................................................................................................................................................ 18
6.1 ROLE DE NFS ............................................................................................................................................ 18
6.2 VISUALISATION DES FICHIERS /ETC/FSTAB ET /ETC/EXPORTS ................................................................................ 18
7 NIS ................................................................................................................................................................. 19
7.1 LISTAGE DU FICHIER /ETC/PASSWD................................................................................................................. 20
7.2 LOCALISATION DU LIEN LOGIN_NAME PASSWORD ............................................................................................. 21
7.3 ROLE DU SERVICE NIS ................................................................................................................................. 22
7.4 INTERET D’UNE BASE NIS DANS UN RESEAU ..................................................................................................... 22
8 WIRESHARK .................................................................................................................................................. 23
9 CONCLUSION ................................................................................................................................................ 24
10 BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................................................... 25

THEYS Alban MAUSSAND David MEILHAC Alexis
3BIRT02
3/25
1 Généralités
1.1 Les grands principes du modèle OSI
Chaque constructeur ayant un système propriétaire, une norme a été établit en 1977 par l’ISO,
afin de limiter les problèmes d’incompatibilité. Le modèle OSI (Open System Interconnection) a
ainsi été mis en place comme standard de communications entre les entités d’un réseau. Il
impose des règles qui gèrent les communications entre les entités.
Le modèle OSI a sept couches :
Couche
Fonction
7. Application
Assure l’interface avec l’utilisateur, géré par les
logiciels.
6. Présentation
Définit le format des données utilisées par la couche
application indépendamment du système.
5. Session
Définit l’ouverture et la fermeture des sessions de
communications entre deux entités du réseau.
4. Transport
Gère le transport des données, leurs découpages et
les erreurs de transmission
3. Réseau
Gère l’acheminement (adressage et routage) des
données via un ou plusieurs réseaux.
2. Liaisons
Donne les fonctions et les processus pour le transfert
de donnée entre les entités du réseau.
1. Physique
Définit les spécifications électrique et physique entre
les appareils.
1.2 Présentation d’Ethernet
Ethernet est une technologie de réseau local basé sur le principe suivant : toutes les machines du
réseau Ethernet sont connectées à une même ligne de communication, constituée de câbles
cylindriques.
Ethernet appartient à la couche physique du modèle OSI.
On distingue différentes variantes de technologies Ethernet suivant le diamètre des câbles utilisés:
Technologie
Type de câble
Vitesse
Portée
10Base-2
Câble coaxial de faible diamètre
10Mb/s
185m
10Base-5
Câble coaxial de gros diamètre (0.4 pouce)
10Mb/s
500m
10Base-T
double paire torsadée
10 Mb/s
100m
100Base-TX
double paire torsadée
100 Mb/s
100m
1000Base-SX
fibre optique
1000 Mb/s
500m

THEYS Alban MAUSSAND David MEILHAC Alexis
3BIRT02
4/25
Tous les ordinateurs d'un réseau Ethernet sont reliés à une même ligne de transmission, et la
communication se fait à l'aide d'un protocole appelé CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with
Collision Detect ce qui signifie qu'il s'agit d'un protocole d'accès multiple avec surveillance de
porteuse (Carrier Sense) et détection de collision).
Avec ce protocole toute machine est autorisée à émettre sur la ligne à n'importe quel moment et
sans notion de priorité entre les machines. Cette communication se fait de façon simple:
Chaque machine vérifie qu'il n'y a aucune communication sur la ligne avant d'émettre
Si deux machines émettent simultanément, alors il y a collision (c'est-à-dire que plusieurs
trames de données se trouvent sur la ligne au même moment)
Les deux machines interrompent leur communication et attendent un délai aléatoire, puis la
première ayant passé ce délai peut alors réémettre.
Ce principe est basé sur plusieurs contraintes:
Les paquets de données doivent avoir une taille maximale
il doit y avoir un temps d'attente entre deux transmissions
Le temps d'attente varie selon la fréquence des collisions:
Après la première collision une machine attend une unité de temps
Après la seconde collision la machine attend deux unités de temps
Après la troisième collision la machine attend quatre unités de temps …
2 Ethernet et Internet
2.1 Visualisation après avoir tapé ifconfig :
Il y a 2 interfaces :
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 80:1c:c4:1a:40:f7
inet adr:192.168.1.208 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::821c:c4ff:fe1a:40f7/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:80470 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:4975 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
Octets reçus:5295445 (5.2 MB) Octets transmis:539250 (539.2 KB)
Interruption:17
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
Packets reçus:20 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
Octets reçus:920 (920.0 B) Octets transmis:920 (920.0 B)

THEYS Alban MAUSSAND David MEILHAC Alexis
3BIRT02
5/25
2.2 Visualisation du fichier /etc/hosts
/etc/hosts contient une liste d'association nom de machine - adresse IP permettant de bypasser la
résolution de nom classique (qui interroge les serveurs DNS) pour quelques serveurs dont on connaît
l'adresse. Typiquement utilisé pour renseigner des noms de machines locales, plus facilement
accessibles par leur nom qu'en tapant l'adresse complète. Voilà ce qui apparait :
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 dst-08
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
En première colonne l'adresse de la machine, ensuite en 2e colonne (séparée par un espace ou une
tabulation) le nom correspondant, suivi éventuellement par ses alias (le texte précédé de # est
considéré comme du commentaire).
Les adresses IP du fichier sont de classe A
Les adresse IP codent le numéro de réseau et le numéro de la station sur ce réseau. La longueur de
l’adresse dans la version 4 de l’IP (IPv4) est de 4 octets (16octets en IPv6). Il y a une correspondance
entre l’adresse IP, l’adresse MAC et la table ARP (expliquée ci-après).
Il y a 5 classes d'adresse IP, les trois premières classes (A, B et C) sont utilisées dans les réseaux
standards.
▪ Classe A :
. 1er octets : pour le réseau (NetID)
. 2,3, 4ème octets : pour les ordinateurs (HostID)
. 0XXXXXX1 -----> 01111110
L'adressage est de 1.0.0.1 à 127.255.255.254
L'adresse IP de classe A autorise près de 127 réseaux de plus de 16 millions machines par réseau
▪ Classe B :
. 1, 2ème octet : pour le réseau
. 3, 4ème octet : pour les ordinateurs
. 10XXXXXX -----> 10111111
L'adressage est de 128.0.0.1 à 191.255.255.254
127.0.0.1 : l'adresse pour localhost ( La machine locale )
L'adresse IP de classe B autorise près de 16575 réseaux de plus de 6500 machines par réseau
▪ Classe C :
. 1, 2, 3ème octet : pour le réseau
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%