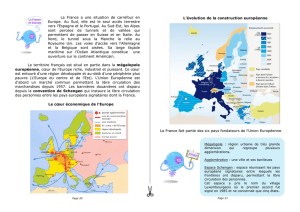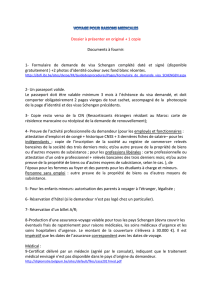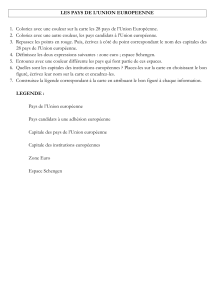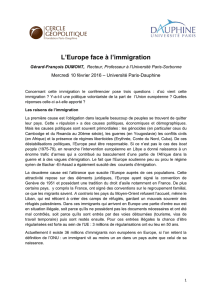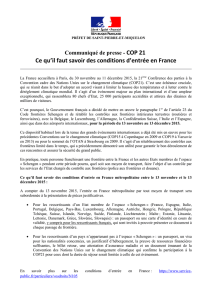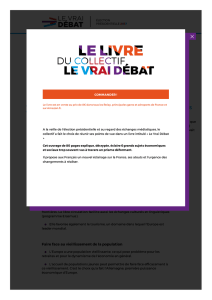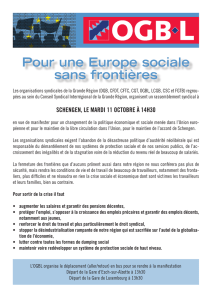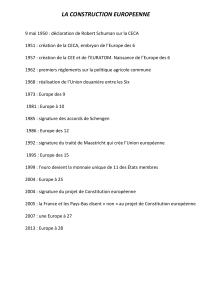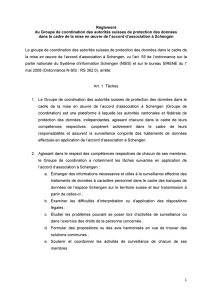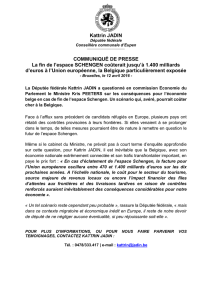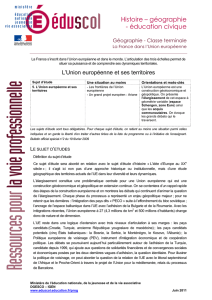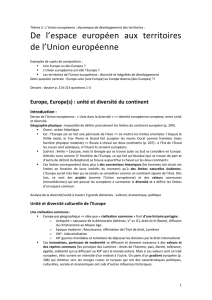Raphaël - Schengen

1
Raphaël - Schengen
Contenus:
compétences culturelles : l’interculturel de la chanson; l’immigration ; accords
politiques ;
compétences lexicales: expressions figées; lexique divers ;
compétences linguistiques: pronoms et leurs fonctions syntaxiques ;
compétences pragmatico-discursives: argumentation pour/contre ;
compétences communicatives: expression de la révolte.
Niveau CECR: B1+ – B2
Temps: 4 heures
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Raphael_
French_singer.jpg
Raphaël Haroche voit le jour à Boulogne,
en banlieue parisienne, d’un père russo-
marocain et d’une mère argentine, le 7
novembre 1975. La profondeur des
chants slaves et l’énergie des rythmes
sud-américains bercent l’enfance de ce
fils d’avocats qui, dès son plus jeune âge,
se passionne pour la musique et fait ses
gammes sur le piano familial. A l’âge de
sept ans, il découvre David Bowie et se
fascine pour l’univers baroque du
créateur de "Ziggy Stardust". Plus tard,
ses références iront d’Iggy Pop à Bob
Dylan, de Noir Désir à Jacques Brel ou
Léo Ferré.
Témoignages
« Raphaël, je pense, est l'artiste qui marque
ce début de siècle. Ca change enfin un
garçon beau et plein de talents ! enfin
surtout plein de talents et beau, car c'est
surtout pour ça qu'on l'aime? non? Je suis
vraiment fan, il est tellement génial !! Pourvu
qu'il continue comme ça ! »
« Raphaël, vous êtes pour moi le nouveau
grand monsieur de la chanson française. Je
n'ai jamais été vraiment fan d'un chanteur à
part Brel, mais j'avoue que c'est la première
fois que je ressens une telle admiration pour
un jeune chanteur. J'aime votre douceur,
votre authenticité. Vous ne ressemblez à
personne. Ne changez surtout pas. Vous
êtes quelqu'un de rare! »
La Création de l'homme
http://www.flickr.com/photos/marja2006/3661454606/
« Pour paraphraser notre ami Verlaine
parlant d'Arthur Rimbaud, je dirais une
seule chose : "mi ange, mi démon, autant
dire Raphaël"... »

2
Raphaël, tu nous offres de telles
interprétations, si simples, si sincères et si
justes... Sans fioritures, sans artifices, tes
ballades et tes riffs plus sauvages nous
propulsent dans un monde qui est tien. Ce
monde réaliste où départs, souvenirs
d'enfance et hommages aux plus grands
riment avec poésie. Tu as la voix fragile d'un
poète de 17 ans, le regard, le sourire, le
physique d'un ange, les mots d'un écorché
vif au summum de son génie.
(http://www.evene.fr/celebre/biographie/raphael-haroche-19916.
php?messages)
La création
http://www.flickr.com/photos/nexus_6/244839290/in/photostrea
m/
Pour Raphaël, l’écriture est un exutoire et il a une facilité déconcertante lorsque la
muse le visite, pour écrire ses textes en quelques minutes. Ce grand amateur de littérature
a pour compagnons de chevet Jack Kerouac ou William S. Burrough, des auteurs
américains, révoltés ou marginaux qui ont baigné ses jeunes années.
Au printemps 2003, sort le second album de Raphaël "La réalité", à la tonalité
beaucoup plus posée que le précédent (Hôtel de l'univers), où le piano remplace les riffs
des guitares saturées. A 27 ans, il écrit et compose toujours ses chansons, avec toutefois
deux interventions notables de Gérard Manset ("La mémoire des jours" et "Etre
Rimbaud"). Des chroniques de la petite enfance, des chansons de révolte ou d’amitié,
constituent les douze titres d’un album réalisé par Jean Lamoot, qui a collaboré avec Alain
Bashung, Noir Désir ou encore Indochine.
Mais Raphael connaît vraiment la consécration avec son troisième album
Caravane, disque de diamant avec 1,8 million d'exemplaires vendus (meilleure vente de
2005[10]), qui lui vaut trois victoires de la musique en mars 2006 : meilleur artiste masculin,
meilleur album et meilleure chanson pour Caravane. Tous les extraits de cet album
(Caravane, Ne partons pas fâchés, Et dans 150 ans et Schengen) sont largement diffusés
en radio.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Schengen
Schengen est une chanson militante qui parle
essentiellement de la condition de l’immigrant. Le
chanteur Raphaël, dont la consécration s’est
produite avec son troisième album : Caravane,
évoque indirectement dans la chanson appelée
"Schengen" le sort des sans-papiers confrontés à
la fermeture croissante de l'Europe de l'espace
Schengen. Le trait n'est pas trop appuyé, mais le
choix du titre et quelques lignes annoncent
clairement la couleur : Et que même dans l'espace
Schengen/ Ils ont pas voulu de ma peau
L’Espace Schengen
L'espace Schengen est l'espace constitué par le territoire des États ayant mis en
œuvre en totalité l'acquis Schengen, à savoir les États qui, notamment :
délivrent des visas valables pour l'espace Schengen ;
acceptent la validité des visas délivrés par les autres États Schengen pour entrer
sur leur territoire ;
ont supprimé les contrôles aux frontières intérieures ;
appliquent le code des frontières à leurs frontières extérieures.
La convention de Schengen promulgue l'ouverture des frontières entre les pays
signataires. Le territoire ainsi créé est communément appelé « espace Schengen », du

3
nom du village luxembourgeois de Schengen, tripoint frontalier entre l'Allemagne, le
Luxembourg (donc le Benelux) et la France (au bord de la Moselle), où a été signé
l'accord, le 14 juin 1985. Le premier accord de Schengen a été signé par cinq des
membres de la Communauté européenne d'alors : l'Allemagne, la France et les pays du
Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), déjà régis par un accord de libre circulation.
Souvent présenté comme un « laboratoire de l'Europe », cet accord a en fait été
signé dans l'improvisation par des États qui n'étaient pas nécessairement les plus en
faveur d'une liberté de circulation des biens et des personnes. Il fait suite en particulier à
une grève du zèle des douaniers italiens, puis des douaniers français, en janvier 1984,
confrontés à l'intensification de leur travail suite à l'augmentation des passages de
frontières, à laquelle fait réponse une grève des camionneurs qui paralyse le territoire
français en février 1984. Malgré l'opposition du ministre des Transports Charles Fiterman
(PCF), le Premier ministre Pierre Mauroy veut envoyer l'armée pour briser la grève.
Finalement, il envoie des grues, accompagnées de chars, pour dégager les camions, et
tente de faire émerger un interlocuteur représentatif.
Si la première convention de Schengen date de 1985, l'espace Schengen a été
institutionnalisé à l'échelle européenne par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997.
L'espace Schengen comprend actuellement 25 pays membres (le chiffre a changé
récemment et pourrait augmenter encore dans les prochaines années) : (première série)
la Suède, le Portugal, les Pays-Bas, la Norvège, le Luxembourg, l’Italie, l’Islande, la
Grèce, la France, la Finlande, l’Espagne, le Danemark, la Belgique, l’Autriche,
l’Allemagne, (deuxième série depuis 2008) la Malte, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la
Hongrie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse. Pour
trois pays de l'Union européenne signataires de la Convention, les accords ne sont pas
encore appliqués : La Roumanie, la Bulgarie, le Chypre.
Le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, modifie les règles juridiques concernant
l'espace Schengen, en renforçant la notion d'un « espace de liberté, de sécurité et de
justice ». Celui-ci fait intervenir davantage de coopération policière et judiciaire, et vise à
une mise en commun des politiques de visas, d'asile et d'immigration, notamment par le
remplacement de la méthode intergouvernementale par la méthode communautaire.
Sept des 33 articles de l'accord portent sur l'immigration et/ou la coopération
policière, les autres étant concernés par la libre circulation (suppression des contrôles
douaniers, mais aussi harmonisation de la TVA et des politiques d'accords de visas).
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Schengen)
Activités
Activité 1. Ecoutez une première fois la chanson Schengen, écrite et interprétée par
Raphaël à partir du site http://www.youtube.com/watch?v=Kp4zhSh7LFI ou
http://www.youtube.com/watch?v=HNO8yXCFcGk&feature=related et notez sur une feuille
à partir de la musique et du texte.
Activité 2. Réécoutez la chanson. En vous aidant des éléments retenus après la première
et la seconde écoute :
a. appuyez l’argumentation en l’orientant dans la même direction que celle qui se
manifeste dans la chanson (connecteurs/opérateurs : en effet, même, c’est
pourquoi, conformément à, encore) ;
b. contredisez le contenu de la pièce en fondant votre argumentation sur le schéma
classique thèse – antithèse – synthèse et en vous servant des connecteurs de
contradiction : au contraire, mais, ou, par contre, en revanche.

4
Activité 3. Cherchez sur la carte de l’Europe la localité Schengen et justifiez sa notoriété.
Activité 4. Recomposez la carte des pays membre de l’Espace Schengen en identifiant le
nom des pays auxquels appartiennent les drapeaux du tableau ci-dessous :
Carte de
l’Espace
Schengen
Activité 5.Répondez aux questions :
1. Qui est le personnage dont la chanson raconte l’histoire dramatique ?
2. Quels sont les vers décrivant le drame de l’immigrant ?
3. Que faut-il comprendre par l’orgue de barbarie qu’il possède ?
4. Quelle est l’idée fondamentale suggérée par le refrain ? A quoi pense notre
personnage « depuis mille ans » ?
Activité 6. Elucidez le sens des vers suivants :
1. J’étais trop grand pour me courber/Parmi les nuages de poussière
2. Le ventre à l’air dans le ruisseau
3. Tellement de nuits sous la paupière
4. Je vais pourrir leur pays
Activité 7. Mis à part le thème principal, indiquez d’autres thèmes, cette fois-ci
secondaires, que le texte suggère. Repérez-les à l’aide de certains mots ou syntagmes-
clés :
Modèle : « se courber » = refus de l’humiliation
«sous la mitraille et le fer », « la bombe atomique » = guerre et menace de guerre
Activité 8. Comment ces fils thématiques concourent-ils à la création de l’atmosphère et
du sens de la chanson ? Relevez la texture des idées du texte.
Activité 9. Dans la strophe suivante, mettez à la place des blancs le terme du texte
d’origine : Je suis……………d’un bout du……………
J’étais trop……………pour me……………….
Parmi les………………de poussière
Juste au…………….de la terre
Et j’ai ………………le long des …………………
Le ventre à l’air dans le………………………..
Et même que le…………………..nous …………………..

5
Et la…………………….va tomber………………….
Activité 10. Découpez à l’aide des ciseaux chaque vers de la troisième strophe ;
mélangez les morceaux de papier résultés, puis recomposez de mémoire la strophe en
question.
Activité 11. Vérifiez le résultat des deux activités antérieures en faisant appel à la variante
karaoké de la chanson à partir du site
http://www.youtube.com/watch?v=vBFafjSyWdI
et ensuite donnez-en votre propre interprétation.
Exercices
Rappel grammatical
Grammaire : les pronoms personnels :
-formes : - non accentuées : je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, eux, elles ;
- accentuées (toniques) : moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles ;
- accentuée réfléchie : soi (3e pers.sg. et pl.)
Exercice 1. Cherchez les formes du pronom personnel ci-dessus :
a. dans le texte de la chanson ;
b. dans les phrases suivantes :
1. Je te crois sur parole. ; 2. Fais-moi confiance, cher ami !; 3. C’est son livre à lui !; 4.
Toi, tu ne mettra pas ce chapeau !; 5. Il est revenu à soi. ; 6. Nous, nous n’irons pas à la
réunion, vous, vous êtes obligés d’y aller. ; 7. Eux, ils ne font que ça !; 8. Elle ne perd
jamais son sang froid. ; 9.Chacun pour soi et Dieu pour tous. ; 10. Je ne viendrai pas,
moi !; 11. Elles, elles le feront à coup sûr !
Rappel grammatical
Fonctions syntaxiques du pronom personnel :
Formes non-réfléchies – formes atone/forme tonique
fonction
1e pers.
2è pers.
3è pers.
1e pers.
2è pers.
3è pers.
Sujet
je/moi
tu/toi
il/lui/ ;
elle/elle
nous/nous
vous/vous
ils/eux ;
elles/elles
C.O.D
Me,
m’/moi
Te, t’/toi
Le/lui ;
La/elle
Nous/nous
Vous/vous/
Les/eux
Les/elles
C.O.I/
C.O.I
prép.
Me,
m’/(à)
moi
Te, t’/(à)
toi
Lui/(à)
lui ;
Lui/(à)
elle
Nous/(à)
nous
Vous/(à)
vous
Leur/(à) eux
Leur/(à)elles
Formes réfléchies
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%