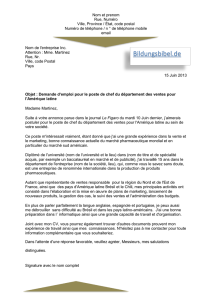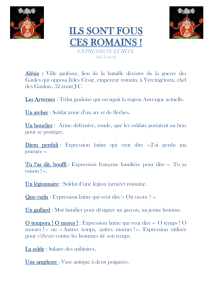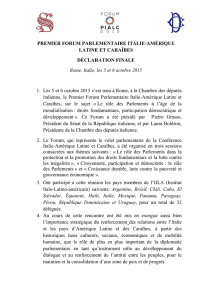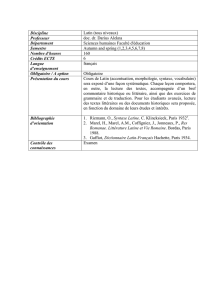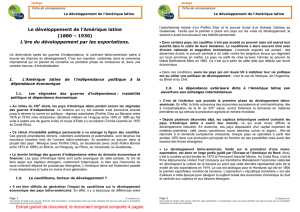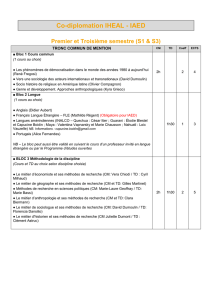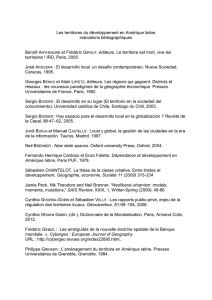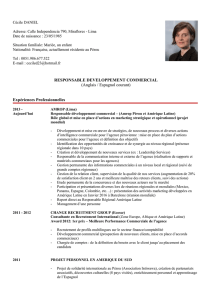La souveraineté des Etats latino-américains (XIXe – XXe siècles)

La souveraineté des Etats latino-américains (XIXe – XXe siècles)
La colonisation de l’Amérique latine est précoce et sera donc longue : les espagnols et les
portugais seront présents du XVIe au XIXe siècle, et ont donc marqué les sociétés latino-
américaines en profondeur. Au XIXe siècle, on assiste à une prise d’indépendance politique
progressive et violente des différents pays d’Amérique latine face à leurs colonisateurs
européens. On pouvait donc s’attendre à un développement rapide de ce qu’on considérait
alors comme un « Nouvel Occident ».
Le concept de souveraineté s’applique au caractère suprême d’une entité politique qui
n’est soumise à aucune autre. On parle donc de souveraineté d’un Etat lorsque celui-ci est
libre de définir de lui-même sa politique et ses orientations socio-économiques, sans
pression aucune de la part d’autres Etats, ou d’organisations internationales.
Quelle acception, ensuite, donner au concept d’Amérique latine, concept qui semble
réunir plusieurs réalités, une pluralité de sociétés ? Si économiquement l’Amérique latine
semble plutôt appartenir au Tiers-Monde, il ne faut pas perdre de vue ses références
culturelles, plutôt proches de celles de l’Occident, qui conduisent Alain ROUQUIE à parler
dans son livre Amérique Latine, une introduction à l’Extrême-Occident d’une Amérique
Latine « synthèse entre Occident et Tiers-Monde ». Pour autant, nous la définirons bien en
suivant une démarcation économique entre pays développés et Tiers-Monde, définition
négative, qui fait référence aux pays « émergents » de l’Amérique Latine, par différenciation
avec l’Amérique du Nord des Etats-Unis et du Canada, deux pays industrialisés et
développés. Nous limiterons de plus notre analyse aux XIXe et XXe siècles.
Peut-on, à partir de leurs indépendances successives au XIXe siècle jusqu’à la fin du
XXe, parler d’une souveraineté des Etats latino-américains au sens de la définition donnée
plus haut ? C'est-à-dire, ces Etats ne sont-ils soumis à aucune entité ou puissance
extérieure ? Sont-ils les seuls maîtres de leurs politiques et de leurs économies ?
I. L’Amérique latine, périphérie économique
Nous allons d’abord voir que l’Amérique latine est économiquement dépendante du centre
occidental, et surtout états-unien, avant de nous pencher sur l’ingérence dans l’économie de
la région.
A. Une dépendance économique au centre
Une dépendance commerciale : l’Occident comme marché et comme
fournisseur
Au sortir de la colonisation, l’Amérique latine, si elle s’est libérée du monopole espagnol
sur le commerce en même temps que de la domination politique, va subir l’hégémonie
économique britannique, du fait de la production fortement excédentaire de l’Angleterre, qui
peine à trouver des débouchés commerciaux sur le continent européen. L’Amérique latine se
trouve donc entraînée dans une sorte de pacte néocolonial, une nouvelle dépendance :
l’Angleterre offre des débouchés aux matières premières, ressources du sol et produits
agricoles latino-américains, et l’Amérique latine, à l’inverse, importe d’Angleterre et du reste
de l’Europe les biens manufacturés. Les pays se spécialisent dans quelques produits qu’ils
produisent à grande échelle (caoutchouc, café, canne à sucre, cacao…) et se lie par là à
l’économie européenne : une récession en Europe et la demande et donc les revenus
d’importation s’effondrent. L’expansion économique de l’Amérique latine est donc fragile et
dépendante de l’extérieur, le centre européen, qui définit par ailleurs, comme nous le verrons
plus tard, le politique de ces Etats selon ses intérêts économiques. A la fin du XIXe siècle,
l’économie européenne perd peu à peu pied face à la puissance montante des Etats-Unis, et
c’est donc logiquement que la dépendance latino-américaine s’ancre également à un
nouveau centre, qui s’emploiera à partir de la fin du XIXe siècle à monopoliser les échanges
commerciaux sur tout le continent américain.

Une dépendance financière : le rôle du dollar en Amérique latine
Dès le XIXe siècle, la présence commerciale de l’Occident en Amérique latine se double
d’une hégémonie financière, notamment britannique, avec un grand nombre de banques
européennes présentes sur le sol latino-américain. Ces banques font principalement reposer
leurs profits sur les emprunts publics des nouveaux Etats. Si ces emprunts permettent aux
Etats d’engager les grands travaux nécessaires au développement du pays, et de s’imposer
sur le continent les uns par rapport aux autres, il est souvent difficile pour les gouvernements
de les rembourser, ce qui entraîne la création de nouveaux emprunts, où la prise de contrôle
par les détenteurs européens du capital de services publics ou d’entreprises.
Lorsque les Etats-Unis deviennent la puissance économique la plus importante, ensuite,
c’est vers eux que se déplace la dette latino-américaine, ce qui a encore accru leur
hégémonie, ainsi que celle du dollar.
De plus en plus, en effet, les pays latino-américains ont été tentés, au XXe siècle,
d’ancrer leur monnaie au dollar américain pour en stabiliser la valeur, et donc stabiliser les
échanges commerciaux, ce qui a eu pour conséquence de les empêcher d’avoir une
politique monétaire propre : il s’agit bien d’une perte de souveraineté de ces Etats.
Aujourd'hui, même, des Etats latino-américains (l’Equateur et le Salvador) ont abandonné
leur monnaie nationale et adopté le dollar américain : on parle de « dollarisation ».
Outre cette dépendance de la périphérie au centre, on peut d’autre part noter l’ingérence
du centre dans l’économie latino-américaine.
B. L’ingérence du centre dans l’économie de la région
La forte présence états-uniennes
Au XXe siècle, les firmes multinationales états-unienne se sont massivement installées en
Amérique latine, profitant des privatisations par exemple pour entrer dans l’extraction de
ressources minières, ou d’autres secteurs de l’économie.
Mais dès la fin du XIXe siècle, déjà, les ambitions états-uniennes dépassaient le simple
cadre de l’implantation industrielle. En 1889 se réunit la première Conférence Internationale
Américaine. Le programme concernait l’essor des échanges commerciaux, la mise en place
d’une union douanière, déjà, et même l’adoption d’une monnaie commune, dans le cadre du
continent américain dans sa totalité. Derrière ce projet panaméricain, qui se concrétisa par la
création d’une union Panaméricaine et de nombreuses conférences, se trouvait déjà la
volonté des Etats-Unis d’imposer leur domination sur les échanges économiques sur le
continent, ce que plusieurs nations ont refusé dès cette première conférence.
A la fin du XXe siècle, le panaméricanisme cherche à nouveau à s’imposer. En 1990, G.
Bush Senior expose son idée de la création d’une zone de libre-échange sur l’ensemble du
continent. Ce projet connaît une première étape avec la création de l’ALENA en 1994, puis à
partir de 1998, et le début de négociations pour la création d’une Zone de Libre Echange des
Amériques, et un traité ratifié en 2001. le risque de ZLEA est à nouveau de diminuer la
souveraineté de ces Etats en augmentant la place des firmes états-uniennes en Amérique
latine, et en laissant les Etats-Unis imposer leur marque sur cette association.
L’importance des organisations économiques internationales…
…notamment le FMI et la Banque Mondiale (BIRD), qui, depuis leur création, sont
souvent intervenues en Amérique latine. Seulement ces interventions, qui étaient le plus
souvent la création de nouveaux prêts à des Etats d’Amérique latine toujours endettés, ont
conduit ces Etats à accepter ce qu’on appelle le consensus de Washington, c'est-à-dire les
principaux points à respecter dans la conduite de leurs politiques économiques. Parmi ces
points, on peut noter la discipline budgétaire, la libéralisation des échanges, ou encore les
privatisations : ainsi, en contractant un prêt auprès de ces instances, les Etats latino-
américains sont entrés dans le néo-libéralisme, ce qui n’a pas amélioré une situation sociale
déjà très mauvaise, ni réduit les inégalités.

=> On peut donc noter une claire dépendance des Etats d’Amérique latine par rapport au
centre occidental et notamment états-uniens, ce qui conduit donc à remettre en cause l’idée
de souveraineté de ces Etats dans un premier domaine, le domaine économique. Qu’en est-
il à présent au niveau politique ?
II. Une souveraineté politique limitée par les intérêts états-uniens
Nous allons d’abord voir que l’Amérique latine a longtemps été considérée comme la
quatrième frontière des Etats-Unis, puis nous allons nous intéresser à l’interventionnisme
états-unien en Amérique latine au cours de la Guerre Froide.
A. L’Amérique latine, quatrième frontière des Etats-Unis
La doctrine Monroe (1823) : l’hégémonie états-unienne sur le continent
américain
Le 2 décembre 1823, le président des Etats-Unis, James Monroe prononce un discours
dans lequel il définit trois principes :
- Le continent américain est désormais fermé à la colonisation européenne
- Toute intervention européenne sur le continent sera considérée comme une
manifestation inamicale à l’égard des Etats-Unis
- En contrepartie, les Etats-Unis n’interviendront pas dans les affaires européennes.
Cette doctrine a pu, au début, être résumée par la phrase « L’Amérique aux américains »,
mais peu à peu, un glissement s’est opéré vers « l’Amérique aux Nord-Américains », ce qui
est montré par le déclenchement d’une guerre contre le Mexique, qui a abouti en 1848 à la
cession aux Etats-Unis d’une partie du territoire mexicain, et notamment la Californie ou
encore le Texas. Les pays d’Europe ne peuvent dès lors plus se prévaloir d’une quelconque
autorité politique sur l’Amérique latine, qui appartient à la zone d’influence états-unienne.
Plus qu’une simple volonté d’expansionnisme territoriale, il s’agit en fait pour les Etats-Unis
de protéger leur quatrième frontière, et d’assurer leur sécurité. C’est pourquoi ils n’hésiteront
pas, plus tard, à intervenir dans les affaires intérieures des Etats latino-américains pour
protéger leurs intérêts.
De la politique du « big stick » de T. Roosevelt à la politique de « bon
voisinage » de F. Roosevelt
Sous la présidence de Theodore Roosevelt (1901-1909), l’expansionnisme états-unien se
transforme en impérialisme, les Etats-Unis étant devenus la première puissance économique
mondiale.
La première expression de cet impérialisme a lieu en 1903, lorsque les Etats-Unis tentent
d’obtenir de la Colombie la souveraineté sur l’isthme de Panama. Comme la Colombie
refuse, les Etats-Unis provoquent un soulèvement populaire au Panama, qui se déclare
République indépendante, et accorde à Washington l’exploitation du canal à perpétuité. Ce
premier épisode illustre la politique du « big stick » prônée par Roosevelt, c'est-à-dire la
politique du bâton : si les Etats latino-américains refusent d’accéder à une demande, les
Etats-Unis interviendront directement. Ayant toujours pour objectif de préserver les intérêts
des Etats-Unis, notamment les intérêts économiques, et de prouver aux européens que le
continent américain est la chasse gardée des Etats-Unis, cette politique sera mise en œuvre
de nombreuses fois jusque l’arrivée au pouvoir de Franklin Delano Roosevelt en 1933.
Celui-ci en effet, au vu de la montée des tensions au niveau international, a mis en place
une politique de bon voisinage pour améliorer les rapports entre le Nord et le Sud du
continent américain : il promet donc de renoncer à toute intervention militaire en Amérique
latine, ce qui n’exclura pas pour autant la domination économique ou les pressions
politiques, notamment pendant la Seconde Guerre Mondiale, pour inciter les pays
d’Amérique latine à s’engager à leurs côtés et en leur faisant partager le coût économique du
conflit.
B. La Guerre Froide : interventionnisme anticommuniste en Amérique Latine

Réduire les marges de manœuvre des gouvernements non-alignés sur les
Etats-Unis
Après la Seconde Guerre Mondiale, toute la politique extérieure des Etats-Unis est
tournée vers l’affrontement idéologique contre l’URSS et le communisme. En conséquence,
l’Amérique latine, du fait de sa proximité géographique avec les Etats-Unis sera l’un des
terrains essentiels de cette lutte à l’échelle mondiale. Il s’agit pour Washington d’empêcher
tout développement de l’idéologie communiste en Amérique latine, et de s’y assurer du
soutien de tous les Etats.
Et lorsqu’un gouvernement socialiste arrive au pouvoir au Chili en 1970 avec Allende,
tous les moyens, sauf l’intervention militaire, seront utilisés pour le faire tomber. En 1970, un
rapport de la CIA résume les raisons de cet interventionnisme : cette victoire porte atteinte
aux intérêts politiques – de crainte d’une contagion communiste – et économiques des Etats-
Unis. On assiste à des tentatives états-unienne pour fomenter des soulèvements populaires,
déclencher des grèves, déstabiliser le pays économiquement, en intervenant auprès du FMI
et de la BIRD pour bloquer le crédit au Chili, et finalement soutenir le putsch militaire. On
retrouvera le même schéma concernant le Nicaragua sandiniste sous Reagan une dizaine
d’années plus tard.
Cela ne fonctionnera par contre pas à Cuba, aux portes des Etats-Unis après la révolution
communiste. Les Etats-Unis sont allés jusqu'à une tentative militaire, avec le débarquement
de la Baie des Cochons, sans réussir à déstabiliser le régime castriste qui tient toujours
aujourd'hui.
Faciliter l’installation de gouvernements favorables
La seconde partie de la politique états-unienne en Amérique latine durant la Guerre
Froide a été de faciliter la prise de pouvoir de gouvernements favorables, et ce de deux
façons : d’abord en finançant ou en organisant des coups d’Etats, comme celui de Pinochet
au Chili, et ensuite en intervenant plus ou moins directement dans les élections. Je vais ici
m’appuyer sur l’analyse de Noam CHOMSKY de la manipulation par les officiels et les médias
nord-américains des répercussions des élections de 1982 au Salvador, et de 1984 au
Nicaragua.
Au Salvador, il s’agissait de légitimer un gouvernement qui faisait face à une guérilla de
gauche. Dans les médias nord-américains, on met en avant les concepts symboliques de
démocratie, de forte participation aux élections, etc… en laissant de côté dans les
reportages l’obligation de voter, les assassinats de journalistes, en oubliant de se poser la
question de savoir quelle était la liberté aux opposants de faire campagne, et la liberté de
choix des électeurs. Les observateurs états-uniens présents sur place ne tiennent pas
d’autre discours.
Au Nicaragua, au contraire, Washington tenait à décrédibiliser les élections sur le point de
légitimer le régime Sandiniste. On ne parle cette fois pas des observateurs officiels
étrangers, ni d’enthousiasme électoral… Cette présentation pour le moins négative suffit à
discréditer les élections et le gouvernement sandiniste qui les a remportées et donc à
légitimer aux yeux des habitants des Etats-Unis le financement par l’administration Reagan
des groupes contre-révolutionnaires.
En conclusion, il semble clair que les Etats d’Amérique latine, tout au long des deux
derniers siècles, ne sauraient être qualifiés de totalement souverains, puisque l’emprise
économique et politique de l’Europe dans un premier temps mais surtout des Etats-Unis sur
ces Etats n’a cessé de conduire les Occidentaux à intervenir dans leurs affaires intérieures.
Mais depuis les élections d’Hugo Chavez à la présidence du Venezuela en 1998, puis de
Lula au Brésil en 2002, d’Evo Morales en Bolivie en 2005 et de Michelle Bachelet en 2006, le
paysage semble changer en Amérique latine, vers une prise de distance avec les Etats-Unis,
et la recherche d’une alternative commune. Entre la nationalisation des ressources
naturelles et des grandes entreprises dans ces pays, les rapprochements de Chavez et
Morales avec Cuba, avec qui ils ont fondé une organisation de coopération économique,
l’Alternative Bolivarienne pour les Amériques (ALBA), et la recherche d’une indépendance au

sein des organisations internationales, l’Amérique latine a peut-être trouvé la voie de la
souveraineté, deux siècles après son indépendance.
1
/
5
100%