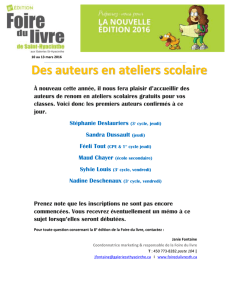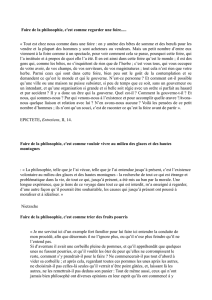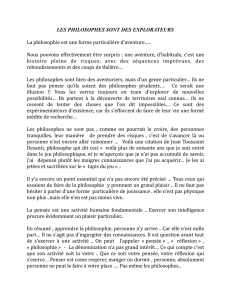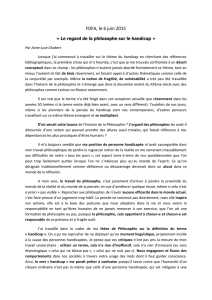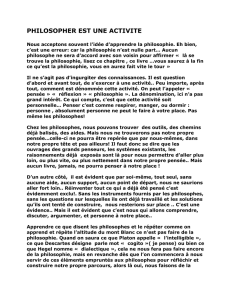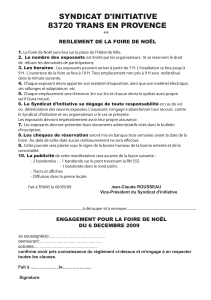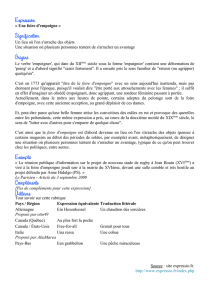texte tiré des Entretiens - Dialog, académie de Reims

EPICTETE, Entretiens, II, 14.
« Tout est chez nous comme dans une foire : on y amène des bêtes de somme et des bœufs pour
les vendre et la plupart des hommes y sont acheteurs ou vendeurs. Mais un petit nombre d’entre
eux viennent à la foire comme à un spectacle, pour voir comment cela se passe, pourquoi cette
foire, qui l’a instituée et à propos de quoi elle l’a été. Il en est ainsi dans cette foire qu’est le
monde ; il est des gens qui, comme les bêtes, ne s’inquiètent de rien que de l’herbe ; c’est vous
tous, qui vous occupez de votre avoir, de vos champs, de vos serviteurs, de vos magistratures ;
tout cela n’est rien que votre herbe. Parmi ceux qui sont dans cette foire, bien peu ont le goût de
la contemplation et se demandent ce qu’est le monde et qui le gouverne. N’est-ce personne ? Et
comment est-il possible qu’une ville ou une maison ne puisse subsister, si peu de temps que ce
soit, sans un gouverneur ou un intendant, et qu’une organisation si grande et si belle soit régie
avec un ordre si parfait au hasard et par accident ? Il y a donc un être qui la gouverne. Quel est-
il ? Comment la gouverne-t-il ? Et nous, qui sommes-nous ? Par qui venons-nous à l’existence et
pour accomplir quelle œuvre ?Avons-nous quelque liaison et relation avec lui ? N’en avons-nous
aucune ? Voilà les pensées de ce petit nombre d’hommes ; ils n’ont qu’un souci, c’est de raconter
ce qu’est la foire avant de partir ».
IDEE GENERALE DU TEXTE.
- (thème) : Il suffit de regarder les hommes vivre pour s'apercevoir que la plupart d'entre eux ne se soucie
guère de philosopher et préfère jouir de son avoir et des plaisirs immédiats de Inexistence. En revanche,
peu nombreux sont ceux qui se consacrent à la contemplation, à la philosophie et veulent comprendre le
monde par eux-mêmes. - (Question du texte): A quoi sert donc la philosophie ? Il semble, en effet, que
l'on puisse parfaitement vivre sans philosopher... Certes, on admet volontiers qu'elle puisse contribuer à la
"culture générale" de chacun (connaissance des doctrines des philosophes, art de l'argumentation, etc.).
En revanche, elle semble dénuée de la moindre efficacité pour affronter les difficultés de la vie réelle. -
(thèse): Epictète, en s'appuyant sur une comparaison entre notre monde et une foire, se propose de
montrer que la philosophie, en tant qu'elle est oeuvre de la Raison, est indispensable à l'homme. C'est par
elle qu'il accédé à la partie la plus haute de lui-même (l'esprit) et, par là même, se sépare de l'animalité.
Mais surtout, elle peut l'éclairer sur lui-même et sur le monde qui l'entoure.
B) POINTS DE COMMENTAIRE.
1. Comparaison du monde avec une foire.
'Tout est chez nous comme dans une foire...elle l'a été'
Le texte s'ouvre sur une comparaison du monde avec une foire:
+ ‘La plupart des hommes y sont acheteurs ou vendeurs: Une foire =l lieu où pour échanger des
marchandises (aliments, animaux, objets, etc..) et pour se distraire. Le principal souci est de jouir de
leur avoir (faire des affaires acquérir, conserver ou augmenter des biens..) et des plaisirs immédiats de
l’existence.
+ Seul 'un petit nombre', càd les philosophes, préfère se consacrer à la contemplation (effort pour
comprendre et expliquer le réel). Pour eux, le monde n'est pas un objet à conquérir mais à découvrir et
à comprendre ('pour voir comment cela se passe, pourquoi cette foire, qui l'a instituée et à propos de
quoi elle l'a été')
Philosopher, c'est regarder le monde comme "un spectacle' et chercher à savoir quelles sont les lois, les
causes et le sens de tout ce qui se produit dans la réalité ( l'ordre des choses = le monde humain et le
monde naturel).
2. Deux attitudes possibles dans L’existence.
'Il en est ainsi dans cette foire .... qui le gouverne. "

a) Distinction entre attitude pragmatique et attitude théorique.
Comparaison qui introduit la distinction entre les non-philosophes et les philosophes:
+ les non-philosophes (acheteurs / vendeurs ) ont une attitude essentiellement pragmatique (qui a pour
but une action utile et efficace sur le monde) ; ils se désintéressent des questions d'ordre spirituel,
philosophique > pour eux, l'important n'est pas de comprendre mais de posséder.
+ les philosophes ont une attitude théorique (qui a pour but de comprendre le réel), mais négligent les
soucis de la vie concrète > l'important n'est pas d'acquérir des biens mais de comprendre.
b) une distinction trop dure et trop schématique ?
L'opinion commune pourrait objecter à Epictète que cette distinction est:
+ soit trop dure = elle semble rejeter les non-philosophes ressemblent-ils donc à des animaux ? Epictète
ne néglige-t-il pas le fait que L’important est de vivre (satisfaire les besoins fondamentaux -se nourrir,
se loger, se vêtir...- et acquérir des biens nécessaires au bien-être, au confort) ? C'est cela qui est
prioritaire et non la philosophie. + soit trop schématique = elle ne paraît pas envisager d'attitudes
intermédiaires : les hommes se divisent-ils donc en deux catégories exclusivement (non-philosophes et
philosophes) ?
c) Réponse d' Epictète
"Il est des gens qui, comme les bêtes, ne s'inquiètent que de leur herbe....' - La satisfaction des besoins et
des désirs matériels n'est pas condamnable ; elle est même indispensable... à la condition de n'être pas
exclusive ni excessive. L'herbe symbolise ici :
+ ce qui est nécessaire pour vivre sur le plan physique et matériel
+ les signes extérieurs de richesses (= magistratures = honneurs, hautes fonctions dans la société;
champs, serviteurs). Ce souci exclusif pour l'avoir rapproche l'homme de l'animal (borné à la seule
satisfaction de ses besoins immédiats) et l'entraîne dans L'ILLUSION , à savoir se tromper sur la vraie
valeur des choses, càd soit limiter son existence aux biens matériels (= nécessaire pour vivre) et se
détourner des choses de l'esprit; soit prendre l'accessoire pour l'essentiel, les apparences ( l’avoir', l'herbe)
pour la réalité.
- A l'opposé, les philosophes (et les poètes ?) se demandent 'ce qu'est le monde et qui le gouverne “quels
sont les principes et les lois qui le régissent? - La philosophie ( = amour de la sagesse) est recherche de la
vraie valeur des choses (sens de la vie, de l'amour, de l’existence..) ; elle n'est donc pas seulement
l'affaire de spécialistes (professeurs), mais celle de tout homme qui éprouve le désir de savoir par lui-
même. La distinction (non-philosophes et philosophes) n'est donc pas trop schématique: elle ne fait
qu'interroger chacun de nous sur notre désir de progresser ou non vers la sagesse.
3. Importance de la philosophie. (' N’est-ce personne ? par accident ? Pour montrer l'importance de la
philosophie, Epictète indique que dans le monde, rien ne va de soi et qu'il convient de chercher à
comprendre par soi-même, car:
- dans le monde humain (une ville., une maison), rien ne peut être laissé au hasard; il est important qu'il
y ait des lois/règles institués par les hommes, pour que tout se déroule bien, de façon cohérente et
harmonieuse sur le plan personnel et/ou collectif...
- De même, le monde de la nature est soumis à des lois causales qui régissent tous les phénomènes (
mouvement des astres, des marées, les saisons, la vie, la mort, etc..). Tout ce qui se produit dans la nature,
le réel est régi par un principe divin supérieur, (le LOGOS) qui lui donne un “ordre si parfait" (unité,
sens et harmonie).
- Donc, à plus forte raison, il importe de chercher à comprendre cette "organisation si grande et si belle'.
Car la vie de l'homme est soumise tout entière aux lois de la nature. Ne pas chercher à comprendre l'ordre
du monde, c'est s'exposer à le subir et à souffrir. La Raison seule peut nous aider à comprendre cet ordre,
à réfléchir et à nous déterminer dans nos conduites. (Ex.: vaincre l'angoisse devant la mort, la maladie,
etc. cf. au cours : Il y a des choses qui dépendent de nous et il y a des choses qui ne dépendent pas de
nous.', Manuel I). En revanche, chercher à comprendre le réel, c'est se donner le moyen d’agir en
connaissance de cause, de savoir ce qui est en notre pouvoir : c'est la condition même de la LIBERTÉ.
Conclusion: La philosophie est tout entière mue par ce désir de savoir (amour de la sagesse) et de

comprendre le monde de la nature et le monde des hommes. C'est en ce sens que la philosophie propose à
l'homme d'accomplir sa vocation véritable d’“animal raisonnable”, capable de raison et vivant en société.
Elle est l'école de la liberté par la pensée.
1
/
3
100%