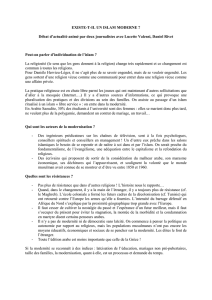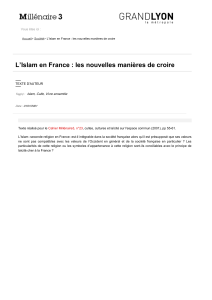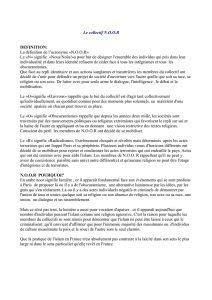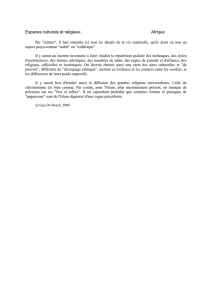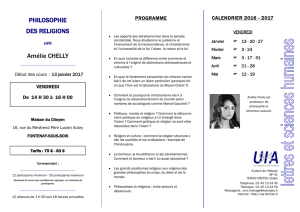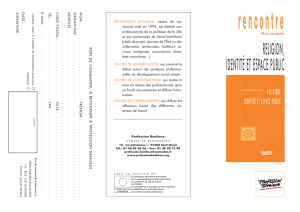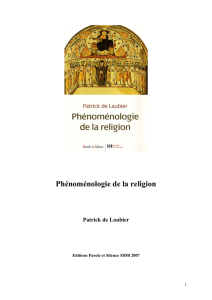Université d`automne du 27 au 30 octobre 2003 à l`IUFM d`Alsace de

1
ENSEIGNER LE FAIT RELIGIEUX
Notes de conférences, pistes pédagogiques, réflexions.
Une Université d’automne s’est tenue du 27 au 30 octobre 2003 à l’IUFM d’Alsace de Guebwiller.
En voici la présentation et les comptes- rendus, faits par une équipe de Versailles présente sur place
1
.
« Religion et modernité »
Présentation et objectifs :
Le thème général de cette Université : le rapport des trois grands monothéismes à la modernité définie
par trois traits culturels majeurs, l’affirmation de l’autonomie du sujet, l’avancée de la rationalité
scientifique, la différenciation des institutions. Trois axes ont été examinés :
le discours critique sur les religions, est il possible, comment ?
religions et sécularisation des sociétés,
les religions face à la modernité (affrontements ?adaptations ?).
Il s’agissait d’une approche du religieux, du comment penser le religieux, comment on a pensé le
religieux, comment les sphères d’activité des hommes se sont progressivement différenciées et
séparées.
Intérêts principaux
Tout le travail a été sous-tendu par la volonté d’examiner des sujets sensibles tout en se soumettant au
double impératif déontologique d’objectivité scientifique et de respect de la sensibilité des élèves.
Les débats, nombreux, qui ont suivi chaque intervention, ont permis à chacun de prendre la parole
autour de divers points, dont la laïcité dans une région, l’Alsace, à laquelle il faut ajouter la Moselle,
où un système particulier existe. Dans les établissements scolaires, en effet, il est fait une place à des
cours de religion, et les facultés de Strasbourg sont les seules en France à préparer à un double
enseignement, à la fois profane et religieux.
L ‘ensemble a été d’une très grande richesse, qu’on peut résumer autour de quelques points. Tout
d’abord le contact avec la recherche la plus pointue, les problématiques les plus récentes et les
avancées faites par les chercheurs dans l’étude des grands monothéismes. C’est ce contact qui facilite
pour l’enseignant du secondaire la nécessaire mise à distance pour aborder, par des approches
nouvelles, l’étude du judaïsme du christianisme et de l’islam. En la matière, et à ce jour, ce ne sont
pas les manuels qui le permettent.
Ensuite diverses conférences ont mis l’accent sur la nécessité et la possibilité d’avoir un discours
critique à propos du fait religieux. Une transmission critique des religions est réalisable dans les
classes des collèges et lycées. On l’a vu à propos du surgissement de ces grandes religions et des
grands textes qui leurs sont liés. La religion des Hébreux est le résultat d’un long processus
historique, tout comme la Bible, fruit d’un long processus rédactionnel. Il y a aussi une véritable
« aventure éditoriale » du Coran. Cette donnée est très importante et permet à l’enseignant d’aborder
sereinement la difficile question de la Révélation, acte de foi par excellence, de distinguer ce qui est
de l’ordre de la croyance, et ce qui est de l’ordre de l’historiquement vérifiable. La seule approche
possible, dans une salle de classe, c’est la démarche scientifique qui conjugue les sources
archéologiques, épigraphiques et les sources littéraires. Cela sans exclure, bien évidemment,
l’approche des croyances, en tant que telles, et en tant que produites par une société et productrices à
leur tour d’une société.
1
L’équipe présente à Guebwiller : Claudie Chantre, Alix Courtois, Nicole Dayan, Annie Fajoles, Marie
Christine Peureux, Claire Podetti, M.Jean Michel Solente. Tous professeurs en collège ou en lycée, de
différentes disciplines ( lettres, histoire-géographie, sciences physiques).
Le travail a été réalisé sous la direction de Danièle Cotinat, IA-IPR d’histoire géographie

2
On est là très exactement dans notre mission, qui consiste à transmettre, à aider les élèves à se
construire, à avoir un jugement critique.
Sur les contenus, les interventions de cette université d’automne permettent de voir combien le
phénomène religieux a une épaisseur historique. Le christianisme est souvent présenté comme
quelque chose qui arrive brutalement, et ayant dès sa naissance des caractères achevés, tout proche de
ce qu’est cette religion aujourd’hui. L’islam est souvent réduit aux cinq piliers. Les religions ont une
histoire, les problèmes, les attitudes d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier mais ne peuvent se
comprendre que par l’hier. L’entrée par la modernité était très pertinente pour percevoir cet aspect. Il
y a eu, et il y a toujours, un choc de la modernité, pour le christianisme, pour le judaïsme, pour
l’islam.
L’approche de ces sujets a été constamment plurielle. Ont été convoquées la philosophie, la
sociologie, l’histoire. Sur les manières d’enseigner les faits religieux, l’approche interdisciplinaire a
été privilégiée, l’histoire, la peinture, la musique, la littérature, la poésie. On pourrait rajouter les
regards de l’anthropologie, pour cerner le fait religieux, élargir aux polythéismes et à toutes les aires
géographiques. Ces journées nous donnent des outils, des stratégies d’approche possibles pour le
faire.
Les comptes-rendus qui suivent vous permettront de renouveler ou compléter vos connaissances et de
vous donner des pistes de réflexion et des ouvertures pédagogiques. Un tableau, certes un peu
réducteur et utilitariste, présente les corrélations possibles avec les programmes d’histoire.
TABLEAU DES CONFERENCES
Titre de la conférence
N° du CR et auteur de la
conférence
Programme d’histoire
concerné ou autre intérêt
Enseigner le fait religieux
1- M. Dominique Borne
Méthodologie, problématique
L’approche historique des
documents fondateurs : la Bible
2- M. Jean Marie Hussser
6e et 2e
L’approche historique des
figures religieuses : Mahomet
3- M. Alfred De Premare
5e et 2e
La Réforme, affrontement du
christianisme à la modernité
4- M. Gérald Chaix
5e, 2e, la fin du Moyen Age, la
Renaissance, les Lumières.
Regard critique sur la notion de
sécularisation
5- M. Gilbert Vincent
Réflexion philosophique
L’Islam en France : Islam
minoritaire dans un espace
sécularisé et laïc
6- M. Franck Fregosi
Histoire contemporaine
Ethique protestante et instance
du sacré
7- Mme Isabelle Ullern-Weite
Réflexion philosophique
L’approche sociologique des
faits religieux
8- M.Jean Paul Willaime
Structure toute la réflexion sur
l’impact du fait religieux dans
les sociétés
Catholicisme et modernité
9- M. Luc Perrin
4e et 1ère
Islam et modernité
10 - Mme Comerro
4e, 2e, 1ère
Judaïsme et modernité
11- Mme Sophie Nizard
6e, 2e, 1ère
La critique philosophique de la
religion au XVIIIe siècle
12- M. Mark Sherringham
Réflexion philosophique, les
penseurs et la religion
La sécularisation de l’art
13- M. François Boespflug
L’art et la religion, toutes

3
religieux occidental
classes.
Les conclusions du séminaire
14-M. Guy Mandon
Réflexion générale
TABLEAU DES ATELIERS OU PISTES PEDAGOGIQUES EXPLOREES
Les Hébreux : histoire et histoire sainte
6e et 2e
Le retable d’Issenheim
2e
Catholicisme et modernité
1ère
________________________________
1-INTRODUCTION
M. Dominique Borne, Doyen de l’Inspection Générale.
Après avoir rappelé le récentes parutions
2
concernant l’enseignement du fait religieux, D. Borne
essaie de répondre à deux questions :pourquoi et comment enseigner le fait religieux?
Pourquoi ?
- L’enseignement de ce fait permet de mieux comprendre le monde contemporain. Il y a de nombreux
exemples d’une irruption du religieux ( du pape polonais, à la présence du religieux dans l’éclatement
de la Yougoslavie et d’autres évènements récents, de la religion utilisée pour affirmer son identité à
l’Islam qui fait rupture..)
- Perte de la connaissance d’un patrimoine de l’humanité, patrimoine religieux et mythologique ; il
s’agit du sens des lieux où nous vivons.
- Le religieux est une catégorie de la connaissance, comme il y a le politique, le social, l’économique.
- Le religieux est un langage spécifique, assez proche du langage de l’art, dans ce langage symbolique,
toutes les disciplines ont quelque chose à dire; on peut reconnaître les signes du religieux dans un
poème, une architecture, un texte philosophique.
- Il y a une « demande sociale » qui doit tenir compte du fait qu’il existe une morale, une éthique
laïque.
De quoi parle t-on ?
Une religion c’est toujours porteur d’une certaine vision du monde, d’un au-delà du monde, l’art tente
de figurer cet au-delà. Il y a aussi des textes fondateurs. Mais jusqu’où peut on aller : les Sagesses
aussi ? et alors la superstition, la voyance, les horoscopes ? Peut- on dire aux élèves qu’il y a du faux
religieux et du vrai religieux ?
En fait depuis toujours on parle de « l’institué » ( exemple, le pape et les empereurs au Moyen Age) ;
on parle surtout de la trace de la religion dans les civilisations, la religion comme puissant marqueur.
On parle aussi de l’anthropologie historique. Alphonse Dupront a fondé une anthropologie du
religieux : étude des gestes, des rites, une procession dans une ville, pèlerinage. C’est bien l’entrée
qu’il faut privilégier, et refuser l’entrée par les dogmes. Il faut contextualiser. Il faut replacer les
2
- L’enseignement du fait religieux, « les Actes de la DESCO », CRDP, Académie de Versailles, juin 2003
- Europe et Islam, Islams d’Europe, « Les Actes de la DESCO », CRDP, Académie de Versailles, mai 2003
- Art et culture religieuse aujourd’hui, hors série du Monde de la Bible, actes du coloque organisé à l’Ecole
du Louvre, « Intelligence de l’art et culture religieuse aujourd’hui ».
- La documentation phototographique, Le fait religieux, Régine Azria, N°8033La documentation
française.
- Islam, Islams, repères culturels et historiques pour comprendre le fait islamique, CRDP de
Besançon/Créteil, 2003.

4
religions dans une histoire, nous sommes dans une histoire et non pas dans l’immuable. Il est
important aussi de se défier de partir toujours d’un modèle judéo-chrétien, modèle intériorisé du
spirituel et du temporel, pour les Islams cela ne se pose pas de la même manière.
Comment faire ?
- Partir des textes et des œuvres. Mais attention les Evangiles ne sont pas une source documentaire sur
la vie de Jésus, le texte n’a pas de finalités historiques ( comme dans le voyage d’Ulysse, on est dans
le symbolique, « cela dit autre chose »).
- Mettre en évidence ce qui rassemble. Abraham est souvent absent des manuels or il est commun aux
trois monothéismes.
- Utiliser la force des images. Exemple en montrant une Vierge à l’Enfant, la face joyeuse, et une
Pieta, la face sombre, on a dans cet exemple tout le christianisme.
- L’usage du musée est intéressante, mais pose aussi des questions : la statue montrée là, a-t-elle
encore un sens ? dans ce cas , lequel ?
- Penser à la place du religieux dans le patrimoine national. Là aussi problème, la cathédrale
appartient au patrimoine religieux et national, où placer le religieux dans le national ?La population
musulmane ne trouve pas là son héritage, il y a un manque de références culturelles et religieuses à
leur appartenance. Depuis la chute du Mur, qui est l’autre pour l’Europe ?L’Islam est en Europe, les
« immigrés » est d’ailleurs un terme à revoir, cf Dominique Schnapper « On n’hérite pas de
l’immigration »
Lors des questions D. Borne insiste sur le fait que la laïcité fait partie des valeurs de la République. Il y a des
textes forts sur lesquels s’appuyer :
- L’article 10 de la Déclaration des Droits de l’homme. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, sauf à
troubler l’ordre public.
L’article 1 de la Loi de 1905 qui confirme la liberté d’expression religieuse
Loi Debré de 1959, l’Etat assure aux enfants des établissements publics de recevoir un enseignement dans le
respect des consciences, liberté des cultes et de l’instruction religieuse.
La laïcité c’est l’accueil de tous pour faire de chacun des citoyens.
___________________________________
2-Approche historique des documents fondateurs, la Bible
Conférence de Jean-Marie Husser, Professeur à l’Université Marc Bloch, Strasbourg
Il y a une tension entre les interprétations historiques des textes et des images et la réception de la foi
par les croyants que l’historien doit respecter.
I Les historiens face à la Bible
La Bible met en scène la Révélation, sur le continuum de l’histoire. Le Pentateuque est partagé entre
des récits historiques (avec une part considérable de la narration , ainsi les origines du monde, les
tribulations des Patriarches, la sortie d’Egypte) et les Lois. Les Lois sont insérées dans un cadre
narratif pour tout faire remonter à Moïse. Puis viennent les six livres du Deutéronome. L’ensemble de
la fresque, menée jusqu’à la destruction du Temple de Jérusalem, est marqué par l’idée que les
malheurs présents sont des châtiments annoncés et mérités.
Il existe un autre corpus datant des Perses. Il s’agit de deux livres, les Chroniques, puis Esdras et
Néhémie.

5
La critique historique commence au XVIIe s. avec Spinoza, et Jean Astruc auteur de « Conjectures sur
les Mémoires originaux dont il paraît que Moyse s’est servi pour composer le récit de la Génèse ». la
question du Pentateuque est ouverte comme la question homérique.
Les questions essentielles : les dates, les auteurs ?
L’exégèse libérale a abandonné l’idée de Moïse auteur du Pentateuque, on est passé à la notion
« d’écoles » et de « rédacteurs » ( c’est d’ailleurs la même chose pour les Psaumes, et David, ou la
Sagesse et Salomon).On a employé la même méthode que pour les textes de l’Antiquité : critique
philologique et analyse rédactionnelle. A la fin du XIX e s. sont étudiés les premiers textes Akkadiens
dont le Déluge : la Bible sort de son isolement culturel.
Après trois siècles d’analyse critique des textes bibliques, les acquis sont considérables.
La Bible est le résultat d’un long processus rédactionnel :
- une étape initiale, collation de traditions orales et de textes épars, constituant les écrits primitifs ;
- puis diverses écoles et auteurs développent, complètent et actualisent en fonction des besoins
nouveaux de la communauté ; on date la plupart des textes de la période du VIIIe au IVe s. avec une
intense période pendant l’Exil, fin VIIe-VI e s.
S’est ajouté l’accroissement des données archéologiques et épigraphiques, au XX e s. et les cinquante
dernières années. I.Finkelstein
3
montre que les acquis scientifiques sont peu développés dans
l’opinion et les manuels.
II L’origine des Hébreux
La recherche historique a renoncé à reconstituer une trame événementielle de la protohistoire d’Israël
mais essaie de rétablir le contexte. De nombreux textes du Pentateuque peuvent transmettre des
traditions orales, sont des fragments d’histoire d’une mémoire collective. Abraham, Isaac, Jacob, sont
des individus derrière lesquels il y a des population qui migrent, l’archéologie le montre. Les
Patriarches, la sortie d’Egypte, les 40 ans dans le désert, Canaan.. sont un ensemble de traditions
primitivement indépendantes les unes des autres, leur fusion a été le fait d’une reconstitution du
passé.
Aujourd’hui les textes et les reste matériels, ce sont deux méthodes différentes, mais des disciplines
qui dialoguent.
La Bible serait le résultat de deux ensembles de traditions distincts, à la base deux origines
simultanées : une migration de clans nomades du NE et en de Mésopotamie allant vers la Cisjordanie
(Génèse 1-35) ; et une autre de clans venus d’Egypte, traversant le Sinaï et le Neguev, allant en
Cisjordanie par le Sud et l’Est. ( Exode, Nombres). Les deux clans ont fusionné ensuite.
Archéologiquement : les premières traces datent du XIII-XII e s. sur les hauteurs des massifs Judéens
et de Cisjordanie, il y a alors un processus de sédentarisation de populations nomades mais pas de
destruction des cités cananéennes.
III les origines du monothéisme biblique
Se pose dans les mêmes termes que la question précédente. Il y a eu de nombreux travaux ces quinze
dernières années. La Révélation à Abraham et Moïse, relèvent de l’histoire sainte et de la foi. Les
historiens bibliques sont des théologiens, la recherche historique conteste leur vision. La sortie
d’Egypte, l’épisode du désert sont insaisissables, Moïse est à jamais une énigme historique. On peut
toutefois reconstituer la religion de ces groupes semi-nomades avant d’être « les Hébreux ». Une
religion tribale du dieu du père, El, épithète de dieu créateur du ciel et de la terre, nom de Yahvé fin
IXe s. Il apparaît alors comme le dieu national du royaume d’Israel. Ce culte de Yahvé est originaire
du Sud du Neguev, en bordure du Sinaï. Mais il ne s’agit pas de monothéisme mais monolâtrie : un
culte officiel rendu à un seul dieu exclusif, sans nier l’existence d’autres dieux des nations alentour.
Cette situation n’est pas isolée alors. L’épigraphie de certains Etats voisins montre l’existence de
dieux analogues. De nombreux cultes étrangers étaient pratiqués en Israel ; à côté de Yavhé il y avait
peut être une divinité féminine, Astera
3
I. Finkelstein et NA Sielberman, La Bible dévoilée, Bayard, 2002.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%