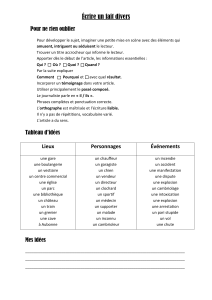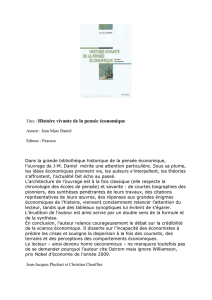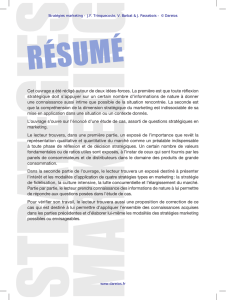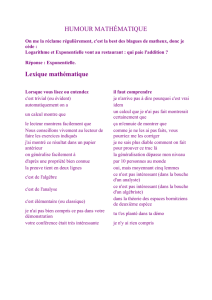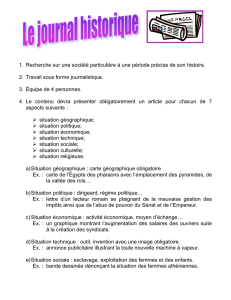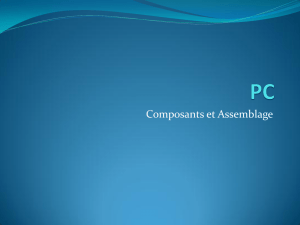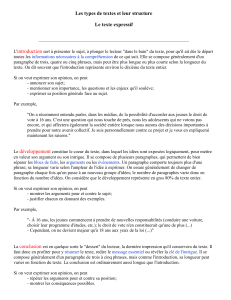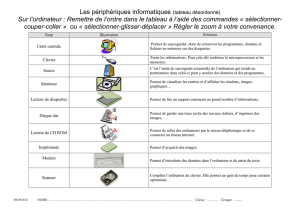Psycholinguistique cognitive Lecture, compréhension et

Piraux Amandine Option de recherche n°10 26 Janvier 2011
1
Psycholinguistique cognitive
Lecture, compréhension et production de textes
Legros Denis, Marin Brigitte, 2008, Psycholinguistique cognitive. Lecture,
compréhension et production de texte, Bruxelles, De Boeck, 161 pages
I. Fiche de lecture
Dans cet ouvrage, les auteurs, D. Legros et B. Marin, proposent une présentation des
différents modèles théoriques issus de la psycholinguistique cognitive relatifs à la lecture, à la
compréhension et à la production de textes.
Ils choisissent une organisation en chapitres dans laquelle ils présentent d’abord, en un
chapitre, un domaine selon les différents modèles théoriques puis, dans le chapitre suivant,
proposent des solutions et des aides pour remédier aux difficultés rencontrées dans le domaine
en question.
Le premier chapitre présente la psycholinguistique cognitive du traitement de texte.
Cette science, à la frontière des sciences du langage et des sciences de la cognition, a pour
objectif la construction des modèles du traitement de l’information par un individu ainsi que
la mise en exergue des différents processus cognitifs mobilisés pour parvenir à la lecture, à la
compréhension et à la production de textes.
Afin de faciliter la compréhension de la suite de l’ouvrage au lecteur, les auteurs,
dans ce premier chapitre, établissent Ce premier chapitre présente les bases de la
compréhension et de la production de textes en définissant les termes de connaissances et de
croyances, indispensables à l’apprenant pour construire des représentations qui l’aideront dans
l’assimilation des textes.
Nous apprenons ici que La compréhension et la production de textes se font par
l’établissement d’une cohérence entre microstructure et macrostructure d’un texte, puis par
adjonction de connaissances relatives au contenu du texte, stockées dans la mémoire de
l’apprenant. La mobilisation de connaissances en rapport avec le contexte textuel est appelée
« inférence » par les auteurs et cette dimension leur permet d’insister sur le rôle de la
mémoire. dans laquelle sont stockées des informations sous formes de schémas,
autrement dit de structures préconstruites activées lors de la compréhension ou de la

Piraux Amandine Option de recherche n°10 26 Janvier 2011
2
production d’un texte. Un premier modèle théorique présente la mémoire comme un
ensemble de schémas (structures préconstruites), dans lesquels sont stockées les informations
activées lors de la compréhension et de la production de texte. Au fil du temps, les chercheurs
ont abandonné ce modèle, insuffisant pour expliquer la compréhension de textes scientifiques,
tout en en conservant des éléments, au profit du modèle théorique de Van Dijk et Kintsch,
définissant un « modèle de situation », comme une représentation cognitive de la situation
qu’évoque un texte. Grâce à ce modèle, les croyances/représentations de l’individu sont prises
en compte, ce qui n’était pas le cas avec la théorie des schémas.
Le second chapitre s’intéresse à la psycholinguistique cognitive de la lecture. Les
processus mentaux et les compétences mobilisées par l’individu lui permettent l’identification
des mots, par une mise en relation des graphèmes et des phonèmes. Les difficultés en lecture
sont fréquentes dans la langue française de par les obstacles dus aux digrammes ou aux
graphèmes non biunivoques.
Un premier modèle théorique, dit « à double voie », affirme que l’apprenant peut
emprunter deux voies différentes pour lire un texte. La première voie est directe et est
nommée « adressage » et est fondée sur le traitement du code orthographique. Le lecteur
utilise cette façon de procéder si les mots qu’il lit lui sont familiers et va « chercher » le
mot en question directement dans son lexique mental/interne, en mémoire, à partir de
son orthographe. Si les mots auxquels il est confronté sont trop difficiles à identifier, le
lecteur devra passer par la seconde voie, indirecte (ou assemblage) pour décoder le mot qu’il
ne peut pas identifier. Dans ce cas, il devra établir une correspondance entre graphèmes et
phonèmes.
Un autre modèle théorique à étapes atteste qu’il existe trois étapes phases dans
l’acquisition de la lecture qui sont la phase logographique, qui correspond à un traitement
visuel et non linguistique des mots, puis la phase alphabétique, dans laquelle le lecteur établit
une correspondance entre le code phonologique et le code sémantique, et enfin la phase
orthographique, qui est égale à l’adressage que nous mentionnions précédemment. A l’issue
de ces phases, le lecteur pourra emprunter le modèle à double voie cité précédemment.
Les modèles interactifs contestent les modèles à étapes, puisque, selon leurs
auteurs, les différents processus cognitifs de la lecture sont mobilisés ensemble.
Ces modèles à étapes sont contestés dans le sens où ils ne prennent pas en compte les
différences interindividuelles des enfants et fournissent peu d’informations sur la dynamique

Piraux Amandine Option de recherche n°10 26 Janvier 2011
3
des apprentissages. Dans les modèles interactifs, et notamment dans le modèle
connexionniste, les processus cognitifs de la lecture sont mobilisés simultanément.
Dans ce chapitre, nous apprenons également qu’une D’autre part, une grande
importance est accordée à l’étude des mouvements oculaires lors de la lecture. Les recherches
montrent que la distance entre deux points de fixations de l’œil varie en fonction de l’âge du
lecteur et augmentent avec la difficulté du sujet à comprendre le texte. D’autre part, Les
saccades régressives augmentent également avec la difficulté du texte.
La mise en place d’activités centrées sur les habiletés phonétiques et orthographique
faciliteraient la mise en place de connexions neuronales et seraient favorables à l’acquisition
de meilleures compétences en lecture.
Le troisième chapitre de l’ouvrage présente un trouble développemental, la dyslexie,
rencontré chez des enfants sans déficit intellectuel ou psychologique particulier. Ce trouble se
présente chez 8 à 10% des enfants scolarisés et se manifeste par des difficultés
d’apprentissage, notamment parce que les élèves dyslexiques inversent les sons et les
syllabes.
Il existe deux formes de dyslexie. Les enfants dysphonétiques, qui représentent environ
60% des dyslexiques, sont atteints de troubles dans le traitement phonologique, et les enfants
dyséidétiques sont atteints de troubles visuels, et doivent décoder les mots les uns après les
autres en les subvocalisant. La dyslexie phonétique relève de facteurs génétiques tandis que la
dyslexie de surface (chez les enfants dyséidétiques) relève de déficits visuels.
Selon les auteurs, un entrainement à la discrimination visuelle et auditive auraient des
conséquences favorables sur l’écriture, tant chez les dyslexiques que chez les normo-lecteurs.
Le quatrième chapitre s’intéresse à la compréhension de textes. Pour comprendre un
texte, le lecteur doit mettre en relation les informations syntaxiques et sémantiques du texte
avec ses connaissances sur le monde évoqué par le texte. Il assure ainsi, en faisant des
inférences, la cohérence du texte.
Plusieurs modèles théoriques se suivent et se complètent au niveau de la compréhension
de texte. Les modèles de première génération sont centrés sur le « produit » de la
compréhension, mais ne peuvent pas être appliqués à tous les textes. Les modèles de
deuxième génération prennent en compte les processus cognitifs mobilisés par l’individu et
notamment l’élaboration d’inférences afin d’établir la cohérence du texte. Les modèles de

Piraux Amandine Option de recherche n°10 26 Janvier 2011
4
troisième génération sont une « synthèse » des conclusions des deux premiers modèles, dans
le sens où ils associent les processus cognitifs et le produit de la compréhension.
A travers les explications des modèles théoriques relatifs à la compréhension de
texte, on arrive A la suite des différentes recherches sur la compréhension de textes, le
modèle le plus pertinent serait un modèle de compréhension qui serait réalisé en deux
étapes. La première serait l’élaboration d’une « base de texte », c'est-à-dire la construction
d’une cohérence entre micro et macrostructure du texte, et la seconde serait la constitution
d’un « modèle de situation », c'est-à-dire la création de connexions de connaissances du
lecteur sur le monde évoqué par le texte à la base de texte, afin de construire une structure
cohérente.
Le cinquième chapitre de cet ouvrage porte sur les aides aux difficultés de
compréhension. Les modalités de remédiation au niveau de la compréhension s’articulent
autour du lecteur, du texte et du couple lecteur/texte.
Les aides se situent surtout autour de la lisibilité des textes. En effet, on peut proposer à
l’apprenant, par exemple, de hiérarchiser les différentes informations en fonction de leur
importance ou de résumer le texte en ce qui concerne les textes narratifs. Pour aider à la
compréhension des textes scientifiques, plus complexes, il est possible d’apporter au lecteur
les connaissances requises pour élaborer des inférences, autrement dit, enrichir le modèle de
situation et ainsi comprendre le texte.
Les nouvelles technologies permettent une facilitation de la création d’inférences pour
le lecteur, en utilisant notamment les liens hypertextes.
Le sixième chapitre s’intéresse à la production d’écrits et propose plusieurs modèles
théoriques pour approfondir ce domaine. Nous retiendrons ici le modèle d’Hayes et Flower,
intitulé « modèle princeps », qui se soucie des contraintes d’écriture et du rôle de la mémoire
à long terme (MLT). Ce modèle décompose l’écriture en plusieurs sous-processus tels que la
planification, la reformulation et la révision. Ce modèle, bien qu’étant une référence, semble
de pas prendre suffisamment en compte les connaissances stockées en mémoire et leur
activation en MLT. D’autre part, il ne rend pas compte de la construction progressive des
compétences du scripteur novice et ignore l’aspect développemental. Baddeley, lui,
s’intéresse à la MLT et la place au cœur de l’activité de production de texte, puisqu’elle est,
selon lui, l’instance exécutive de la pensée. Son modèle, peu explicite et global est
complexifié par Kellog en 1996.

Piraux Amandine Option de recherche n°10 26 Janvier 2011
5
Un autre modèle, celui de Bereiter et Scardamalia décrit deux stratégies utilisées
respectivement par le lecteur novice et l’expert, la knowledge telling strategy et la knowledge
transforming strategy. La première est utilisée par l’enfant et pourrait se traduire par
« stratégie des connaissances rapportées ». L’apprenant récupère des connaissances en MLT
et les transcrit directement, sans les réorganiser, dans sa production d’écrits. L’adulte, quant à
lui, utilise la « stratégie des connaissances transformées », qui se traduit par la capacité à
réorganiser les connaissances présentes en MLT pour les rendre cohérentes avec les
contraintes thématiques. Ici, l’aspect développemental est privilégié mais le modèle reste très
général. Il faudra attendre Breninger et Swanson en 1994, pour l’explicitation de la mise en
place progressive des compétences rédactionnelles chez l’enfant de 5 à 10 ans.
Une tâche essentielle dans la production d’écrits est la révision, nécessitant un certain
niveau métacognitif. Lors de cette étape, le lecteur relit son texte et cherche à cerner l’origine
des écarts entre le texte produit et le texte souhaité, puis met en œuvre les modifications
nécessaires (suppression, addition, substitution de mots) pour que le texte produit corresponde
à celui souhaité.
Le chapitre sept concerne les aides à la production d’écrits. Les nouvelles technologies,
citées précédemment dans la remédiation aux difficultés de compréhension, peuvent faciliter
les productions écrites grâce à des bases de données textuelles proposées au lecteur. Ces
dernières lui fournissent les connaissances du monde et les outils linguistiques qui lui
manquent. Grâce à ces bases de données, la charge cognitive du scripteur est allégée.
Le contexte linguistique et culturel joue un rôle dans les difficultés de production
d’écrits. Ainsi, en contexte plurilingue, le recours à la langue maternelle (L1) favorise
l’activation des connaissances sur un domaine précis.
Le dernier chapitre fait le lien entre les nouvelles technologies et le traitement du texte.
La construction des connaissances est favorisée par les TICE, comme nous le mentionnions
précédemment, puisqu’Internet met à la disposition de l’élève énormément d’informations.
Cependant, l’apprenant doit développer de nouvelles habiletés pour rechercher sur Internet
puisqu’il doit gérer le processus de traitement des informations numériques et produire un
important raisonnement inférentiel. Les TICE permettent un nouvel apprentissage
individualisé ou à distance.
 6
6
1
/
6
100%