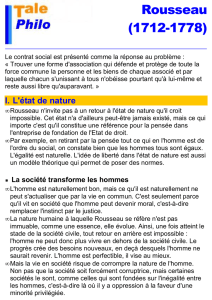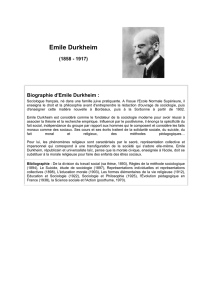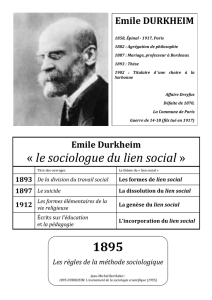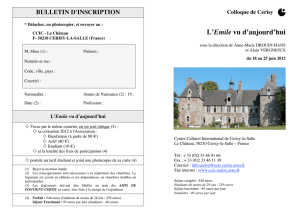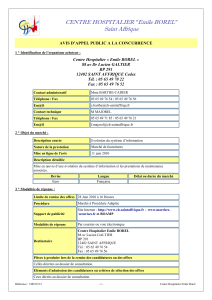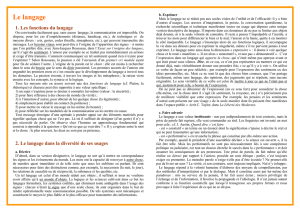enfant philosophe

ENFANT PHILOSOPHE ? ENFANT ARTISTE ? MODERNITE DE J.-J. ROUSSEAU
L'Emile et « le partage du sensible »
Alain Kerlan
1
Université Louis Lumière Lyon2
Laboratoire Education Cultures et Politiques (Lyon2/IFE/ENS)
Résumé
L’Emile: traité d’une radicale refondation de l’éducation sur l’enfance, traité d’une refondation de l’enfance elle-
même. La « découverte » de l’enfance si souvent attribuée à l’auteur, a pour centre de gravité cette déclaration
bien connue : « l’enfance a des manières de sentir et de penser qui lui sont propres ». Cette autre déclaration plus
abyssale est moins souvent citée : « Nul n’est assez philosophe pour se mettre à la place de l’enfant », affirme
Jean-Jacques. La chambre d’Emile sera le cadre de la toute première exposition du dessin de l’enfant. L’Emile,
traité de l’enfance qui désigne dans l’enfance le sensible, l’esthétique (aesthesis) comme cœur de notre humaine
condition. Mais aussi, et indissociablement, traité politique. Qu’en est-il alors, dans L’Emile, de ce « partage du
sensible » dans lequel Jacques Rancière situe l’enjeu du politique? Qu’en est-il de cette esthétique au fondement
de la politique? Quelles proximités entre « l’enfant philosophe », et « l’enfant artiste » ? Quels peuvent être les
bénéfices d’une lecture de l’Emile inspirée des thèses de Jacques Rancière ?
* * *
Si je devais tenter de dire comment se pose aujourd’hui, en ce début du 21ème siècle, la
question de l’enfance, comme question philosophique et anthropologique, je placerai cette
tentative sous deux exergues qui me semblent être particulièrement significatifs. Le
premier est un propos emprunté à Picasso : « J’ai mis toute une vie pour apprendre à
dessiner comme un enfant ». Le second se trouve sous la plume de Rousseau, dans
l’Emile : « Nul n’est assez philosophe pour se mettre à la place d’un enfant ».
Nous voici en un siècle en effet où le grand artiste en vient à regarder l’enfant comme
son modèle, un siècle dans lequel la philosophie jusqu’ici réservée au grand âge –
rappelons que Platon fixait le bon moment pour entrer en philosophie à la
cinquantaine ! – s’adresse aux enfants, que la « philosophie pour enfant » s’adresse au
plus jeune âge. Il m’arrive de le dire de façon plus ironique : notre siècle est celui où les
jeunes enfants font de la philosophie et tutoient le grand artiste, tandis que les grands-
pères font de la trottinette…
Mais laissons là les grands parents et leur joujou. Je voudrais tenter avec vous de
comprendre, pour l’enfance, et pour notre monde, l’émergence de ces deux figures :
« l’enfant philosophe », et « l’enfant artiste ». Il serait plus juste de parler de la figure de
« l’enfant au plus près du philosophe », et de la figure de « l’enfant au plus près de
l’artiste », même si la formule est un peu lourde. Quoi qu’il en soit, pour les comprendre,
je voudrais vous montrer tout l’intérêt d’une relecture de l’Emile, cette « bible » de la
découverte de l’enfance, comme on le dit si souvent. Vous montrer du même coup toute
1
Alain Kerlan est philosophe, professeur à l'université Lyon2, ex-directeur de l'Institut des Sciences et des
Pratiques d'Education et de Formation. Son travail se situe aux carrefours de la philosophie et de la
pédagogie, de l'art et de l'éducation. Il est auteur et directeur de plusieurs ouvrages, dont notamment:
L'art pour éduquer ? La tentation esthétique (PUL, 2004), Des artistes à la maternelle (Scérén, 2005), Paul
Ricoeur et la question éducative (PUL, 2011), Repenser l’enfance ? (Hermann 2012).

la modernité, et peut-être mieux encore toute la « postmodernité » de Rousseau sur
cette question qui nous vient aujourd’hui.
Sous le signe des paradoxes et des oxymores
Nous avons tous en tête quelques phrases de Rousseau tirées de nos lectures de l’Emile
et qui sonnent comme des aphorismes. Pour moi, celle-ci continue de briller comme une
bien étrange pépite, et de me saisir par son obscure clarté : « Nul d’entre nous n’est
assez philosophe pour se mettre à la place d’un enfant ». Voilà un propos qui en une
poignée de mots ouvre soudain deux abîmes sous nos pas et de surcroît les relie en un
jeu de miroirs vertigineux. Abîme du côté de l’enfance, abîme auquel serait vouée toute
tentative de penser l’enfance : aucune philosophie, aucune volonté de vérité, aucun
chemin de sagesse, aussi accomplis soient-ils, ne nous permettra de savoir ce qu’est
l’enfance, ce qu’il en est de l’état d’enfance, nous qui en sommes définitivement éloignés.
Abîme tout autant du côté de la philosophie, dès lors qu’elle trouverait sa limite et son
échec précisément dans cet état de l’être et de la pensée, l’enfance, qui en constitue
traditionnellement l’antithèse.
Rousseau, « découvreur » de l’enfance ? Oui, mais un découvreur et une découverte qu’il
faut placer sous le signe des paradoxes et des oxymores. Jean-Jacques d’ailleurs ne s’en
cache pas et même le revendique, qui « aime mieux être homme à paradoxes que
homme à préjugés ». Et de fait, L’Emile abonde en paradoxes, et il suffirait presque d’en
tourner les pages au hasard pour les cueillir en nombre. Je feuillette le livre II et je lis :
« Vous ne parviendrez jamais à faire des sages si vous ne faites d’abord des polissons »
(p. 149)
2
; un peu plus loin : « En le laissant ainsi maître de ses volontés, vous ne
fomenterez point ses caprices » (p. 150) ; ou un peu plus avant : « Les mensonges des
enfants sont tous l’ouvrage des maîtres, et vouloir leur apprendre à dire la vérité n’est
autre chose que leur apprendre à mentir » (p. 125).
Inutile de multiplier les exemples et les illustrations. En tant que traité d’éducation,
traité de refondation de l’éducation, L’Emile tout entier est comme le déploiement d’un
même paradoxe, qui est le paradoxe même de l’éducation telle que la conçoit Rousseau :
« Jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c’est de gouverner sans préceptes, et
de tout faire en ne faisant rien » (Livre II., p. 146). Tout faire en ne faisant rien. En
baptisant au livre II l’art de son gouverneur « méthode inactive », Rousseau en dit plus
que nous n’en disons en parlant, comme on le fait le plus souvent aujourd’hui,
d’ « éducation négative », expression certes choisie par Rousseau lui-même, mais dont la
banalisation atténue l’oxymore fondateur.
La leçon de dessin
De tous les nombreux paradoxes que déploie l’Emile, il en est un que je ne serai certes
pas le premier à relever, mais qui a pris à mes yeux un relief singulier. Il a trait au dessin
enfantin. L’intérêt porté au dessin d’enfant, on le sait, a une histoire et cette histoire est
très logiquement indissociable de celle de l’enfance. Il s’agit d’un intérêt relativement
récent. A cet égard, la place qu’occupe le dessin d’enfant dans l’Emile, le fait même que
cette activité de l’enfant y soit remarquée et considérée comme activité proprement
2
Toutes les citations de l’Emile sont faites dans l’édition Garnier-Flammarion.

enfantine participent assurément de la « découverte » de l’enfance dont l’Emile marque
une étape majeure, et même d’une refondation de l’enfance elle-même. Le regard porté
sur le dessin d’enfant dont elle témoigne vient tout droit de cette célèbre affirmation du
livre II : « L’enfance a des manières de voir, de penser, de sentir, qui lui sont propres » (p.
108). La chambre d’Emile est d’une certaine façon le lieu de la toute première exposition
de dessins enfantins, à l’initiative du gouverneur : « Nous étions en peine d’ornements
pour notre chambre, en voilà de tout trouvés. Je fais encadrer nos dessins ; je les fais
couvrir de beaux verres, afin qu’on n’y touche plus, et que, les voyant rester dans l’état où
nous les avons mis, chacun ait intérêt à ne pas négliger les siens. Je les arrange par ordre
autour de la chambre, chaque dessin répété vingt, trente fois, et montrant à chaque
exemplaire le progrès de l’auteur, depuis le moment où la maison n’est qu’un carré presque
informe, jusqu’à celui où sa façade, son profil, ses proportions, ses ombres, sont dans la plus
exacte vérité » (Livre II, p. 184).
Mais quel est ce « nous » ? C’est que le gouverneur, qu’on a vu à d’autres moments bien
plus soucieux de ne point se mêler de ce qui est l’affaire de son élève, qu’on a vu prôner
qu’il faut « considérer l’homme dans l’homme, et l’enfant dans l’enfant » (Livre II, p. 93),
et même exhortant les lecteurs en ces termes : « Aimez l’enfance ; favorisez ses jeux, ses
plaisirs, son aimable instinct » (Livre II, p. 92), c’est donc que ce même gouverneur,
s’agissant du dessin, met sans réserve la main au pinceau et au crayon : « Je prendrai le
crayon à son exemple ; je l’emploierai d’abord aussi maladroitement que lui. Je serais un
Apelle, que je ne trouverai qu’un barbouilleur » (Livre II, p. 184). A quoi rime ici cette
imitation par le maître de son imitateur d’’élève
3
? Elle s’explique par les fins qu’il
poursuit. Le gouverneur, constatant que tous les enfants s’essaient au dessin, certes
voudrait « que (le sien) cultivât cet art », mais « non précisément pour l’art même, mais
pour se rendre l’œil juste et la main flexible » (Livre II, p. 183). L’imitation de l’imitateur
est au service du progrès de l’élève vers la juste représentation. Rousseau pédagogue
défend alors une pratique qui paraît mettre en place comme une sorte d’anticipation de
ce que Vigotski appellera une zone proximale de développement : « Dans ce progrès, je
marcherai tout au plus à côté de lui, ou je le devancerai de si peu, qu’il lui sera toujours
aisé de m’atteindre, et souvent de me surpasser » (Livre II, p. 184). Quel progrès ? Celui
qui arrache l’enfant aux erreurs que comporte chacun de ses dessins, et même, devrais-
je dire, que constitue chacun de ses dessins : « Je commencerai par tracer un homme
comme les laquais les tracent contre les murs ; une barre pour chaque bras, une barre
pour chaque jambe, et des doigts plus gros que le bras. Bien longtemps après nous nous
apercevrons l’un ou l’autre de cette disproportion » (Idem).
Voilà donc le dessin enfantin, à peine découvert, « recouvert ». Mais pourquoi ? La
question, on l’accordera, doit être posée. Suffit-il d’y répondre en invoquant l’esthétique
de l’imitation, de la mimesis, à laquelle le dispositif éducatif du gouverneur est
entièrement suspendu ? Certes, son poids et son rôle sont visibles à chaque ligne des
quelques pages que Rousseau consacre à l’apprentissage du dessin. Mais il y a plus. Il y
a que le dessin enfantin, à peine découvert, renvoie la maladresse enfantine à reproduire
le sensible à la maladresse générale du peuple. Il y a ce sous-texte cinglant, qu’il faut
bien restituer sans détour : les enfants dessinent comme des laquais. Sous-texte qui se lit
tout autant dans l’autre sens : les laquais dessinent comme des enfants. Il ne s’agissait que
d’apprendre à « bien » dessiner, de faire le partage entre l’imitation fidèle à la nature et
3
« Les enfants, grands imitateurs, essayent tous de dessiner » (Livre II), p. 183).

l’image erronée. Voilà qu’il s’agit d’une ligne de partage entre l’homme du peuple et le
bourgeois éduqué, voilà qu’il s’agit de la différence entre une enfance maintenue dans
son état populaire et une enfance qui s’en arrache. Voilà qu’il s’agit d’une question
politique, au sens que lui donne Jacques Rancière : une question qui concerne le
« partage du sensible », c’est-à-dire, « le système d’évidences sensibles qui donne à voir
en même temps l’existence d’un commun et les découpages qui y définissent les places
et les parts respectives
4
».
Le sensible et les « politiques de l’enfance »
Entreprendre de relire l’Emile à la lumière des thèses de Jacques Rancière, et plus
particulièrement de cette notion au cœur de l’œuvre, puisqu’elle est déjà engagée en
1981 dans l’ouvrage fondateur, La nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier, et qu’elle
est toujours là dans l’un des derniers ouvrages publiés, Aesthesis. Scènes du régime
esthétique de l’art, pourrait passer pour l’une de ces acrobaties savantes dont nous
autres philosophes sommes parfois un peu trop friands. Je ne bouderai pas le plaisir que
peut procurer ce genre de défi. Mon entreprise s’adosse toutefois à quelques tentatives
qui m’ont convaincu non seulement de l’intérêt d’une lecture de cet ordre, mais aussi d’y
pressentir une réelle puissance théorique. Pour m’en expliquer brièvement – j’y
reviendrai – je dois au moins indiquer que la lecture que je vais amorcer s’inscrit dans
une ligne de réflexion portant sur l’enfance d’aujourd’hui, sur l’enfance d’aujourd’hui
comme question politique, et qu’elle en est venue à considérer le champ de l’art et de
l’esthétique comme l’un des lieux où s’élaborent ce que nous pouvons appeler les
politiques de l’enfance
5
.
Dans un entretien recueilli dans l’ouvrage qui donne sans doute au lecteur l’accès le plus
aisé et le plus développé à l’œuvre de Jacques Rancière, et qui le gratifie de surcroît d’un
titre étonnamment tonique : Et tant pis pour les gens fatigués, on peut lire cette
déclaration : « la politique est d’abord une bataille sur les données sensibles elles-
mêmes
6
». Eh bien je propose qu’on regarde la scène d’apprentissage du dessin et la
chambre d’Emile où elle s’expose au Livre II comme une bataille sur les données
sensibles. Je propose qu’on examine dans l’Emile le déploiement d’une politique de
l’enfance, et qu’on le fasse à la lumière de cette définition du politique selon Jacques
Rancière : « La politique consiste à reconfigurer le partage du sensible qui définit le
commun d’une communauté, à y introduire des sujets et des objets nouveaux, à rendre
visible ce qui ne l’était pas et à faire entendre comme parleurs ceux qui n’étaient perçus
que comme animaux bruyants
7
». Comment Rousseau, par exemple, entreprend-il au
Livre I de faire entendre comme parleurs ceux qui n’étaient perçus que comme animaux
bruyants ? Lire L'Emile donc comme traité pédagogique et politique, en se souvenant que
4
Jacques Rancière, Le partage du sensible. Esthétique et politique, La Fabrique, 2000, p. 12.
5
Cette réflexion s’inscrit dans les développements d’une recherche intitulée « Politiques de l’enfance : le
cas de l’éducation artistique » (acronyme POLEART). Elle a été soutenue et financée par l’Agence
Nationale de la Recherche (France), dans le cadre de son programme « Enfances ». La présente conférence
reprend une communication faite en ouverture d’une journée du colloque de Cerisy-la-Salle Emile
aujourd’hui, colloque organisé par la Société Francophone de Philosophie de l’Education (SOFPHIED) en
juin 2012 à l’occasion du deux cent cinquantième anniversaire de la publication de l’Emile (1762).
6
Jacques Rancière, « Littérature, politique, esthétique. Aux abords de la mésentente démocratique », in Et
tant pis pour les gens fatigués, Paris, Editions Amsterdam, 2009, p. 159.
7
Jacques Rancière, Malaise dans l’esthétique, Paris, Galilée, 2004, p. 38.

la politique « se joue toujours dans des questions de partages et de frontières
8
». Qu'en
est-il dans L'Emile de ces partages et frontières ? Quelle politique de l'enfance
déterminent-ils ? Et que dire à cet égard de l'éducation d’Emile et du partage du sensible
qu'elle opère ? Qu'en est-il dans l'Emile de ce « problème de partage symbolique qui est
beaucoup plus ancien et beaucoup plus large » et qui concerne « la distribution de la
parole, du temps, de l'espace
9
» ? Qu'en est-il en effet dans l'Emile et son économie
pédagogique de la distribution de la parole, du temps et de l'espace ? Ces questions,
selon nous, peuvent éclairer les figures de « l’enfant philosophe » et de « l’enfant au plus
près de l’artiste » qu’on voit aujourd’hui se lever et réinterroger l’enfance, la différence
enfant-adulte, la place et le statut de l’enfance dans les sociétés postmodernes.
Aesthesis et politique
Aussitôt que nous adoptons cette perspective, nous sommes conduits à regarder
autrement les deux premiers livres de l’Emile, et plus particulièrement le sensualisme
qui préside à la première éducation, à celle de la première et de la seconde enfance, à
l’éducation de l’infans, puis du puer. On loue à fort juste titre Rousseau d’une première et
fondatrice libération de l’enfant, celle de son corps, de sa mobilité, de sa relation
esthésique au monde. L’Emile, dès son livre premier, se trouve placé sous le double
signe, sous les signes conjoints du sensible et de la liberté. Le sensible y est désigné
comme le lieu où se joue aussitôt le destin de la liberté. Si L’Emile est un traité de
l’enfance qui désigne dans l’enfance le sensible, l’esthétique (aesthesis) comme cœur de
notre humaine condition, il est aussi, indissociablement, et pour cette raison même,
traité politique. On regarde souvent L’Emile comme le complément éducatif du Contrat
social : la philosophie politique commande l’entreprise éducative, l’Emile est l’homme tel
que doit être tout homme tel que le réclame l’effectivité du contrat social. Et nous avons
en tête l’image d’un Rousseau ayant ses deux manuscrits sous la main et allant de l’un à
l’autre d’une même plume. Certes, mais l’Emile commence par un vigoureux plaidoyer
pour que l’enfance soit libérée du carcan dans lequel l’enferme la pratique de
l’emmaillotage, commence par l’irruption du sensible dans le politique, la désignation du
sensible comme tout premier et fondateur lieu du politique. Rousseau y associe sans
détours le langage de la puériculture et celui de la politique ; sous sa plume les cris et les
pleurs de l’enfant font déjà entendre les dictats du tyran.
La dénonciation rousseauiste de l’emmaillotage ne se fait pas seulement dans le langage
d’un naturaliste, mais fondamentalement dans celui de la philosophie politique.
Rousseau cite bien le Buffon de l’Histoire Naturelle, en lui empruntant cette superbe
envolée : « A peine l’enfant est-il sorti du sein de la mère, et à peine jouit-il de la liberté
de se mouvoir et d’étendre ses membres, qu’on lui donne de nouveaux liens. On
l’emmaillote, on le couche la tête fixée et les jambes allongées, les bras pendants à côté
du corps ; il est entouré de bandages de toute espèce, qui ne lui permettent pas de
changer de situation. Heureux si on ne l’a pas serré au point de l’empêcher de respirer »
(Cité au livre premier, p. 43). Mais il l’aura fait précéder d’une déclaration qui place
résolument la pratique en usage à l’égard du nouveau-né dans le droit fil du célèbre
début du Contrat social et de la fière maxime qui ouvre le chapitre un : « L’homme est né
libre et partout il est dans les fers ». Pour Rousseau, « tous nos usages ne sont
8
Jacques Rancière, « Littérature, politique, esthétique. Aux abords de la mésentente démocratique », in Et
tant pis pour les gens fatigués, Paris, Editions Amsterdam, 2009, p. 151.
9
Ibid., p. 155.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%