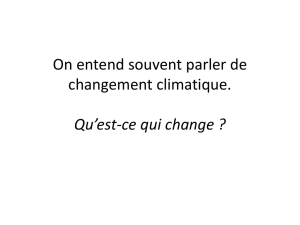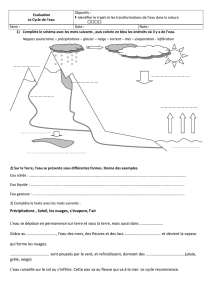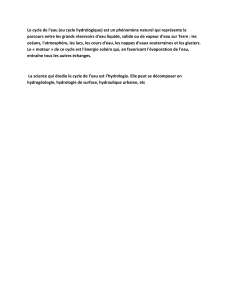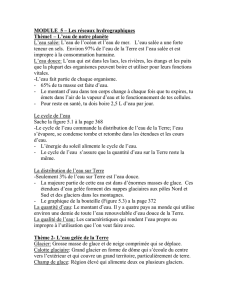dossier initial sur l`eau volume 1

1
L’eau en France
Dossier documentaire 1
Documents rassemblés par JM Dauriac – 2014

2
Généralités sur l’eau
1. Eau (ressources et utilisation) p.3 à 14
2. Eau (approvisionnement et traitement) p. 15 à 35
3. Eau (les défis de l’eau) p. 36 à 49
4. Hydrologie p. 49 à 67
5. Hydrologie urbaine p. 67 à 72
6. Glaciers p. 72 à 98
7. Fleuves p. 98 à 118
8. Lacs et limnologie p. 118 à 136
9. Hydrogéologie p. 136 à 155

3
EAU (Ressources et utilisations) notions de base
Article écrit par Jean-Paul DELÉAGE
Prise de vue
De toutes les planètes du système solaire, la Terre est la seule à être pourvue d'une hydrosphère. Celle-ci
recouvre plus des deux tiers de sa surface. Les propriétés de l'eau sont tout à fait exceptionnelles :
condition de la vie, solvant quasi universel, vecteur de chaleur, puissant régulateur thermique, etc. La
disponibilité en eau est l'une des clés de la distribution des êtres vivants à la surface de la Terre. Les
sociétés humaines elles-mêmes en sont totalement tributaires : elles l'utilisent pour les besoins de leur vie
quotidienne, pour leur agriculture et leur industrie, mais aussi comme moyen de transport, pour produire
leur énergie ou évacuer leurs déchets. La multiplication des conflits géopolitiques liés à l'eau ainsi que
la montée rapide des coûts de production de l'eau potable dans la plupart des pays industrialisés sont les
indices d'une crise majeure de cette ressource.
Patrimoine naturel le plus précieux de l'humanité, l'eau est très inégalement répartie dans le monde. Pour
des raisons climatiques, tout d'abord : les zones arctiques, tempérées et tropicales humides se partagent
98 p. 100 des eaux qui circulent sur l'ensemble des terres émergées, tandis que les zones arides et semi-
arides ne disposent que des 2 p. 100 restants. Mais les écarts dans les modes et les niveaux de
développement socio-économique jouent aussi un rôle déterminant dans les disparités des ressources en
eau réellement disponibles. Ainsi, au Sud (au sens géopolitique du terme), plus de 1,5 milliard d'individus
sont privés d'eau potable. Quant aux pays industrialisés, ils connaissent une crise latente, notamment en
raison des pollutions qui mettent en danger cet élément longtemps considéré comme indéfiniment
renouvelable. Les ressources naturelles en eau, potentiellement utilisables, varient suivant les régions de
200 litres à 2 millions de litres par jour et par habitant.
L'eau de notre planète (environ 1 385 millions de kilomètres cubes) est répartie dans cinq réservoirs
interconnectés. Le plus important d'entre eux est constitué par les océans (environ 97,4 p. 100). Les glaces
représentent environ 2 p. 100 du réservoir mondial, les eaux douces terrestres (lacs, fleuves, eaux
souterraines et humidité des sols) 0,6 p. 100 et la vapeur d'eau atmosphérique moins de 0,001 p. 100.
Quant à la totalité de l'eau contenue dans les cellules vivantes, elle correspond à moins de 0,000 1 p. 100
de l'ensemble, soit tout de même 1 100 kilomètres cubes.
I - Ressources

4
Le cycle de l'eau
Les cinq réservoirs d'eau de la planète subissent des transferts incessants selon un cycle bien connu
dont la phase initiale est l'évaporation des eaux de surface des océans et des continents. Chaque jour, plus
de 1 000 milliards de tonnes d'eau passent ainsi dans l'atmosphère, qu'elles quitteront un peu plus tard
sous forme de précipitations. La fraction P de ces précipitations qui retombe sur les continents se répartit
en deux flux. Une partie (Ev) de l'eau retombée subit à nouveau les phénomènes d'évapotranspiration,
après avoir, pour une part, transité par les êtres vivants ; le reste (Dr) est drainé vers les océans. Le bilan
s'écrit : P = Ev + Dr.
Les ressources en eau Dr, dites renouvelables, se répartissent elles-mêmes, en fonction de la perméabilité
du sol, en trois flux secondaires : le ruissellement, qui alimente les rivières et les fleuves ; le drainage par
infiltration superficielle, qui recharge les nappes aquifères ; le drainage souterrain profond, qui fournit les
nappes les plus profondes (plusieurs centaines de mètres de profondeur).
Au cours de ce cycle, la surface de l'océan fonctionne comme un immense distillateur. Cet évaporateur à
basse température joue le rôle d'une station d'épuration géante qui débarrasse l'eau de tous les déchets,
toxines et bactéries qui la polluent et remet l'eau douce à la disposition de la biosphère. À cette eau
évaporée viennent se joindre les eaux thermales et volcaniques mises en mouvement par la chaleur interne
du globe. À la distillation naturelle s'ajoute le flux des eaux douces obtenues artificiellement par les
usines de dessalement des eaux de mer, soit environ 15 millions de mètres cubes par jour.
Le cycle de l'eau comporte donc deux branches principales : une branche atmosphérique (réservoir
atmosphérique) et une branche « terrestre » (les quatre autres réservoirs). L'étude de la première relève de
la météorologie, la seconde de celle de l'hydrologie. La météorologie permet de comprendre le rôle de la
circulation générale de l'atmosphère dans le cycle de l'eau et donc la distribution géographique inégale
des précipitations. Dans les zones subtropicales et polaires, l'évaporation est plus importante que les
précipitations, tandis que les précipitations dépassent l'évaporation dans les ceintures de précipitation, à
savoir la zone de convergence intertropicale et les latitudes moyennes soumises aux perturbations
associées aux fronts polaires. Le bilan précis des processus d'apport et d'élimination de l'eau dans une
région donnée permet de connaître la répartition spatiale et temporelle de cet élément.
Les trois paramètres principaux caractérisant les précipitations – volume, intensité et fréquence – varient
selon les lieux et les saisons. Le volume des précipitations s'évalue en hauteur d'eau sur une période
donnée. Une fraction de la pluie est directement évaporée, une autre est interceptée par la végétation, une
autre enfin frappe directement le sol. Dans ce dernier cas, une partie s'infiltre, une autre peut stagner en
surface, une dernière est emportée par le ruissellement. On fait appel à la notion de pluie efficace pour
définir la fraction de pluie qui est effectivement utilisée par la végétation. Cette notion est essentielle,

5
puisque les végétaux constituent le premier niveau trophique des écosystèmes, celui de la photosynthèse
du vivant.
Une ressource primordiale pour la vie
L'eau de pluie est essentielle pour toute la chaîne du vivant, dont les végétaux constituent le premier
maillon. Ces derniers sont responsables des processus d'évapotranspiration en rejetant des masses
considérables d'eau par leur système foliaire. Leurs racines, qui peuvent aller chercher l'eau à plusieurs
mètres de profondeur dans le sol, accélèrent les mouvements ascendants sol-atmosphère. Le transit de
l'eau dans les végétaux est un phénomène d'une ampleur considérable. Ainsi, un hectare de forêt, en
région tempérée, peut absorber jusqu'à 4 000 tonnes d'eau par an (chiffre obtenu en Suède pour une forêt
d'épicéas sur sol humide). Le flux de vapeur d'eau provient de la transpiration des plantes et de
l'évaporation des surfaces de contact plante-atmosphère et sol-atmosphère. La valeur maximale de ce flux
constitue l'évapotranspiration potentielle, ou ETP, paramètre qui constitue l'un des fondements de la
classification biologique des climats.
Indépendante de la disponibilité réelle en eau et comparée au volume mesuré P des précipitations, l'ETP
permet d'établir, pour toute station, l'existence ou non d'un déficit climatique en eau DE. En termes très
simplifiés : DE = ETP − P.
Il y a déficit si ETP est supérieur à P, excédent dans le cas contraire. Avec ce type de calcul, on peut
estimer les besoins en eau des cultures en remplaçant dans l'expression précédente le facteur DE par le
terme ETR, représentant l'évapotranspiration réelle, autrement dit la quantité d'eau réellement
évapotranspirée au niveau d'une culture. Cette dernière dépend des conditions climatiques, de la
disponibilité en eau de surface et des caractéristiques aériennes des végétaux.
Élément fondamental de la croissance des végétaux, l'eau est plus généralement le constituant majeur de
toute matière vivante, le milieu où s'effectuent de multiples réactions métaboliques, chez les êtres vivants
terrestres aussi bien que chez les êtres vivants aquatiques. Si ces derniers ont toujours de l'eau à leur
disposition, il n'en va pas de même en milieu terrestre, où plantes et animaux doivent s'adapter à diverses
conditions hydriques pour assurer leur autorégulation.
À l'état liquide, l'eau solubilise les molécules motrices de la physiologie du vivant, et son mouvement
permet de structurer ce dernier. L'osmose de l'eau et la diffusion des sels assurent les échanges internes et,
ainsi, la vie elle-même. La vie est donc impossible sans la présence d'une certaine quantité d'eau dans les
organismes. Ces derniers mettent en œuvre diverses stratégies adaptatives, particulièrement sollicitées
dans les régions froides, où le gel peut provoquer la mort en entraînant l'immobilité du « milieu
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
1
/
170
100%