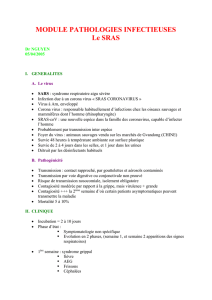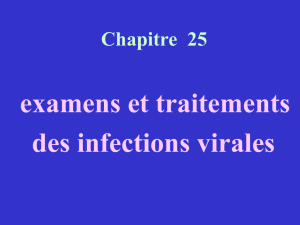Document

E.Thiry Pathologie des maladies virales
1
Chapitre 1
INTRODUCTION

E.Thiry Pathologie des maladies virales
2
1.1. LE VIRUS
Les virus sont des agents bien connus de maladie chez l'homme et l'animal. Ils sont présents
partout dans notre environnement immédiat.
Les virus restent des agents infectieux majeurs : le SIDA, la poliomyélite, la rougeole, les
hépatites virales sont des maladies humaines virales. La rage est une anthropozoonose virale,
c'est-à-dire une maladie affectant à la fois l'homme et les animaux. La maladie de Carré du
jeune chien, la panleucopénie féline, la fièvre aphteuse sont autant d'infections virales
affectant les animaux que le vétérinaire est amené à soigner.
Les virus sont des microorganismes capables de se multiplier et qui représentent une des
formes les plus petites de la vie. Leur simplicité est telle que leur multiplication requiert
l'environnement intracellulaire : elle est complètement dépendante des structures de la cellule
hôte et de son métabolisme.
Les virus ne contiennent qu'un seul type d'acide nucléique, ADN ou ARN, alors que les
microorganismes unicellulaires (protozoaires, champignons, bactéries, rickettsies,
mycoplasmes, chlamydia) en ont les deux types. Les virus possèdent deux phases bien
distinctes dans leur cycle vital, à l'inverse des microorganismes unicellulaires. Durant sa
phase extracellulaire, le virus est inerte ; il n'a pas de métabolisme propre. La phase de
multiplication est intracellulaire.
De nombreux virus peuvent se multiplier après pénétration du seul acide nucléique viral dans
la cellule : leur acide nucléique est infectieux. Ce n'est pas le cas de microorganismes
unicellulaires.
Les virus conventionnels les plus simples sont composés d'un acide nucléique et d'une capside
de protéines.
Enfin, des agents infectieux encore plus particuliers, appelés agents transmissibles non
conventionnels (ATNC) sont responsables des encéphalopathies spongiformes transmissibles
(tremblante du mouton, encéphalopathie spongiforme bovine ou maladie de la vache folle). Ils
semblent dépourvus d'acide nucléique et leur infectivité est associée à une protéine de
structure modifiée (le prion) dont la forme normale se trouve dans les neurones.

E.Thiry Pathologie des maladies virales
3
2. Pénétration
3. Décapsidation
4. Transcription des
mRNA précoces
5. Traduction des
protéines précoces
6. Réplication de l’acide
nucléique viral
7. Transcription des
mRNA tardifs
8. Traduction des
protéines tardives
9. Assemblage
des virions
1. Attachement
10. Sortie
Schéma de la multiplication du virus dans la cellule infectée

E.Thiry Pathologie des maladies virales
4
1.2. LA CELLULE INFECTEE
Le virus est un microorganisme inerte. Sa rencontre avec une cellule est indispensable pour
l'initiation d'un cycle de multiplication virale. L'action pathogène d'un virus est souvent liée à
sa capacité à détruire les cellules (effet cytopathogène).
Le raisonnement appliqué dans l'étude de la pathogénie des maladies virales repose toujours
sur le couple virus-cellule : les deux éléments sont indissociables. Un virus infectieux ne peut
se multiplier que dans une cellule qui possède les récepteurs adéquats au virus. A une échelle
plus grande, l'animal est sensible à un virus si certains de ses tissus ou organes ont des cellules
qui possèdent des récepteurs du virus. La maladie observée est directement dépendante du
type de cellules infectées et de la nature des lésions occasionnées dans cette cellule par la
multiplication virale (cytolyse pour les virus lytiques, cytoprolifération pour les virus
tumoraux).
Le mécanisme pathogène n’est pas toujours lié à un effet direct du virus sur les cellules d’un
tissu ou organe. En effet, certains virus appartenant aux familles des Poxviridae et
Herpesviridae expriment des protéines homologues de cytokines, appelées virokines, qui
peuvent modifier la régulation de la réponse immune. D’autres virus, comme le virus de
l’immunodéficience acquise humaine (SIDA), induisent spécifiquement une
immunodépression. Enfin, d’autres virus exercent leur effet pathogène par l’intermédiaire de
réactions immunopathologiques, comme par exemple la formation de complexes immuns
chez les chevaux infectés par le virus de l’anémie infectieuse équine.
L’interaction entre l’infection virale et la cellule peut aussi avoir pour conséquence l’entrée de
la cellule en apoptose, c’est-à-dire en mort programmée. Certains virus, par exemple certains
membres de la sous-famille des Gammaherpesvirinae, ont développé des stratégies de
prévention de l’apoptose de la cellule infectée ; cette propriété est liée à des phénomènes de
persistance virale dans certains types cellulaires.

E.Thiry Pathologie des maladies virales
5
1.3. LA MALADIE VIRALE
La maladie n'est pas la suite inéluctable de l'infection virale. Les virus possèdent une
spécificité d'hôte : l'infection d'une espèce animale résistante, réfractaire à l'infection, sera un
cul de sac pour le virus. Aucune cellule de l'organisme ne sera apte à permettre la
multiplication du virus. L'adaptation du virus à une ou plusieurs espèces animales cibles peut
se traduire par une très faible virulence du virus. En effet, beaucoup d'infections virales sont
inapparentes, subcliniques.
La gravité des signes cliniques dépend aussi du degré de virulence de la souche virale
infectante. En effet, dans une même espèce virale, plusieurs souches virales qui diffèrent par
certaines propriétés peuvent être décrites. Par exemple, les souches vélogènes, mésogènes et
lentogènes du virus de la maladie de Newcastle varient selon leur virulence. Ce caractère est
génétiquement déterminé et dépend de la faculté qu'a la protéine de fusion du virus d'être
clivée en deux sous-unités. Chez des virus plus complexes, comme les Herpesviridae, plus de
dix gènes sont responsables de la virulence.
Le virus peut également s'adapter aux nouvelles conditions. Les virus à ARN présentent un
taux important de mutations qui sont un véritable gisement pour la sélection de virus mieux
adaptés. Les virus influenza, responsables des grippes, subissent la dérive antigénique. Une
accumulation de mutations ponctuelles dans le gène de l'hémagglutinine provoque des
variations de l'antigénicité de cette protéine. Les "nouveaux virions" circulent plus facilement
dans une population animale qui est immunisée envers le virus précédent. Les phénomènes de
recombinaison chez les virus à ADN et de réassortiment de gènes chez les virus à génome
segmenté sont aussi responsables de modifications génétiques du virus qui l'autorisent
éventuellement à s'adapter à un nouvel environnement.
L'histoire récente de la virologie vétérinaire abonde d’exemples d'émergence de souches
virales plus virulentes et de nouvelles maladies provoquées par de "nouveaux" virus :
le parvovirus canin en 1978 ;
la réapparition de la maladie de Newcastle, début des années 80 ;
le syndrome hémorragique du lapin, 1984 ;
l’encéphalopathie spongiforme bovine, 1986 ;
le syndrome dysgénésique et respiratoire chez le porc, 1987 aux USA, 1990 en Europe ;
le syndrome d’immunodéficience féline, 1987 ;
le morbillivirus des phoques, 1988 ;
le morbillivirus équin, 1994 ;
le circovirus du porc, 1997.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
1
/
36
100%