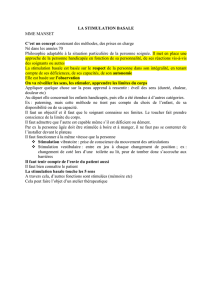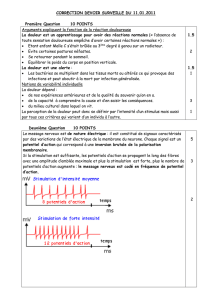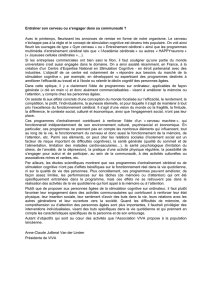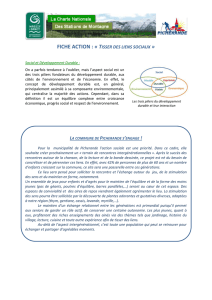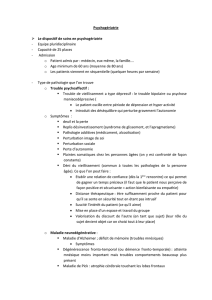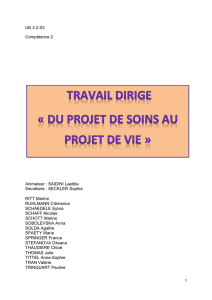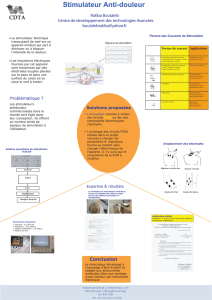projet stimulation pour pdf

Les dossiers du psychologue
Réfléchir, comprendre, analyser et pratiquer
N°1 Mai 2010
Editorial
Je suis heureux de vous présenter le premier numéro
des dossiers du psychologue. L’idée en est très
simple : vous proposer chaque trimestre un recueil
de quelques textes sur un thème bien précis
concernant notre travail quotidien dans
l’établissement.
Evidemment les thèmes seront explorés du point de
vue psychologique. Je ferai en sorte de vous proposer
des textes clairs et abordables. Ce ne sera pas
toujours possible car certains textes incontournables
sont quelquefois plus pointus. Mais je n’hésiterai pas
à faire, à l’occasion, des coupes franches dans les
textes afin de vous éviter les paragraphes rébarbatifs
qui n’apporteraient rien de plus à la démonstration.
Ces coupes seront néanmoins systématiquement
signalées par l’onglet suivant : …/… Je tiens à votre
disposition bien sûr les textes d’origine si vous
souhaitez les consulter.
Chaque dossier donnera lieu à des discussions en fin
de relève et selon un calendrier précis qui vous sera
donné à l’intérieur de celui-ci. Ce jour-là, la relève
devra être la plus courte possible afin que nous
puissions prendre un peu de temps pour discuter des
textes et du thème proposé.
Une fois par trimestre, je vous proposerai un temps
de débat plus long, organisé à la salle Marjorie. Cette
réunion sera aussi destinée aux transversaux et aux
personnels administratifs. Chacun à son niveau peut
réfléchir sur ces questions. Nous aurons donc un
débat plus élargi et plus long ce jour-là.
Notre travail de soignant nous contraint à réfléchir
sur beaucoup de questions, mais nous n’en avons
finalement que peu le temps. En vous proposant ces
lectures, je vous invite à prendre de la distance avec
les situations du quotidien. Souvent, durant les
relèves, nous abordons ces questions-là très
rapidement. Nous avons l’impression de voler de
précieuses minutes au quotidien. Pourtant, pour
quelques minutes dérobées, nous gagnons beaucoup,
vous le savez. Il faut savoir mettre quelques instants
en pause la course effrénée de la journée de travail et
se laisser le temps de penser, de remettre en
question, de débattre, de comprendre le monde
difficile qui nous entoure…
Richard Salicru
Psychologue
stimuler

Thème
Stimulation
cognitive, stimulation
sensorielle, stimulation corporelle, ce qui est
propre à la stimulation, c’est qu’elle a
toujours un objet et un but. On stimule une
fonction ou un organe dans un objectif bien
précis. Pour ce qui concerne notre travail, la
stimulation cognitive, par exemple, consiste à
faire fonctionner les fonctions cognitives,
comme la mémoire, en proposant des stimuli
appropriés dont l’efficacité a été en général
démontrée. Lorsque la stimulation est un
acte soignant réfléchi, éprouvé et bien
présenté, il s’agit d’un plus pour la personne
âgée, personne n’en doute.
Il n’y a donc pas de mauvais sens de la
stimulation, il y a une mauvaise
interprétation. Sous le prétexte de la
stimulation se cache souvent l’obligation, la
contrainte. Une personne âgée ne souhaite
pas prendre de douche, nous allons la
stimuler
mais, en réalité, nous allons l’obliger
à la prendre parce que nous pensons que cela
est bon pour elle. La stimulation sert trop
souvent d’alibi à l’exécution d’une tâche.
Lorsqu’une personne refuse de manger, pour
quelque prétexte que ce soit, nous allons la
stimuler
le plus souvent en lui demandant de
manger, en lui disant qu’elle va aller mal si
elle ne mange pas, en lui présentant une
cuiller à la bouche, en la laissant longtemps
devant son assiette, etc… Nous allons
employer des stratégies pour atteindre le but
que nous nous sommes fixé : elle doit
manger. Or, la stimulation alimentaire passe
par des stratégies complètement différentes
comme, par exemple, la présentation d’un
plat, l’attention portée à l’environnement à la
convivialité, la stimulation des sens comme
l’odorat, etc…
On confond donc le plus souvent « stimuler »
et « contraindre ». C’est une erreur banale,
Il s’agit là des textes à partir
desquels ce dossier a été
monté.
Dr Louis Ploton
,
La personne
âgée
,
Son accompagement
médical et psychologique et la
question de la démence
, Lyon,
2005
Claudine Badey-Rodriguez
, Les
personnes âgées en
institution
,
Vie ou survie
, Paris,
1997
Naomie Fiel, Validation
,
La
méthode de Naomie Fiel
, Rueil-
Malmaison, 2005
Dr Chantal Benoliel et coll., La
maladie d’Alzheimer
,
Mieux
communiquer avec les patients
et les familles
, Paris, 2006
Textes
« Il n'y a pas de stimulant d'action plus
efficace ni de guide plus précis et plus
docilement obéi que le plaisir»
Pradines (philosophe français)
Services EHPAD
L 07 : vendredi 28 mai
L 02 : vendredi 11 juin
L 03 : vendredi 18 juin
L 04 : vendredi 25 juin
P10 : mardi 29 juin
Services SSR et USLD
V0 : mardi 1er juin
V1 : mardi 8 juin
V2 : jeudi 17 juin
V3 : jeudi 24 juin
Réunion salle Marjorie
(pour tous)
le jeudi 1er juiillet
de 14h30 à 16h00
Dates
2
que tout le monde fait dans l’urgence de son
intervention quotidienne. Il est en effet plus
rapide de donner un ordre que de penser à
quelle stratégie on va mettre en place pour
donner l’envie de faire. Et cela est valable
dans chaque acte de la vie quotidienne.
Pourquoi en arrive-t-on là avec les personnes
âgées ? Parce que nous les considérons trop
souvent comme irresponsables (surtout
lorsqu’ils ont sombré dans la démence). Et
l’irresponsabilité nous renvoie aux enfants.
Les enfants doivent être éduqués. Il est
souvent nécessaire de les contraindre car
d’eux-mêmes ils ne vont pas faire les choses
spontanément.
Donc, sous l’égide d’un mouvement de bon
parent, que souvent nous sommes dans la vie
personnelle, sous l’égide de l’éducation, sous
le couvert enfin de la
stimulation
, nous allons
faire subir aux personnes âgées ce qui
apparait nécessaire à la vie communautaire,
à la vie de la personne, au bon sens, au
maintien d’une bonne santé, etc.…
Le résultat de ce type d’interprétation de la
stimulation se présente sous la forme de
conflits quelques fois terribles avec nos
résidents. Cris sous la douche, griffures lors
de la toilette, coups de poing, renfermement,
fugue, toutes sortes de violences que nous
vivons tous les jours ou presque dans
l’établissement et qui épuisent tout le
monde, les agents, les résidents et les autres.
Il faut donc réinterpréter le mot
« stimulation » et lui donner toute sa valeur
thérapeutique. On ne stimule pas n’importe
comment et on ne se sert pas de la
stimulation pour amener l’autre à faire ce
qu’il ne veut pas faire et que l’on voudrait
qu’il fasse.
Richard Salicru

Dr Louis Ploton
,
La personne âgée
,
Son
accompagement médical et
psychologique et la question de la
démence
, pp. 131 à 137
Savoir proposer, au lieu d’exiger
…/… Même si nous pratiquons le bon choix
pour un tiers, dès lors que d’une façon ou
d’une autre nous le lui imposons, pouvons-
nous le considérer comme réellement
autonome ? Lequel par exemple est le plus
autonome de deux vieillards : celui que
nous acceptons de bonne grâce de
conduire à sa demande sur 300 mètres avec
son fauteuil roulant, ou celui que nous
aurons obligé sans concessions à se
déplacer par ses propres moyens sur 20
mètres ? Lequel sera, à échéance, le plus
protégé et le plus porté à s’autonomiser ?
A notre sens,
tout ce qui retire l’exercice
d’une part de souveraineté contribue à
briser chaque fois un peu plus le moteur de
l’autonomie !
Combien de fois notamment, avons-nous
vu des personnes âgées se grabatiser puis
se laisser mourir (au terme de ce qu’il est
convenu d’appeler un syndrome de
glissement) parce que des intervenants
armés des meilleures intentions, mais
appliquant des principes désastreux,
voulaient à tout prix les remettre sur pied,
en ne leur laissant d’autre alternative que :
marcher ou rester au lit (ou éventuellement
dans un fauteuil fixe). Le mieux s’avère ici
l’ennemi du bien, cette politique se
révélant désastreuse parce qu’en l’espèce
elle ne tient pas compte du syndrome
subjectif qui se développe chez les
personnes âgées après une chute ou un
alitement, lequel associe : phobie de
tomber, et incapacité à prendre appui sur
les jambes du fait de la difficulté à
verrouiller les articulations.
Au risque de choquer, pour échapper à
cette version médicale de l’adage « marche
ou crève ! », nous pensons qu’une politique
d’autonomisation peut passer par
l’apprentissage du maniement d’un fauteuil
roulant (associé à une kinésithérapie
protectrice des capacités musculaires et
articulaires) permettant de reprendre
possession de l’espace, avec le goût de
vivre qui s’y associe, étant entendu que
dans un second temps (la provocation
représentée par le fauteuil roulant, aidant)
on pourra utiliser le désir de « s’en sortir »
du patient pour tenter de reprendre
progressivement, à son rythme, la marche
en cadre, puis avec de moins en moins
d’appui.
Dans un tel cas, où sont étroitement
intriqués les facteurs psychologiques et
somatiques, nous croyons le travail
psychologique absolument primordial, et la
démarche d’autonomisation sera fondée,
au rythme du patient, sur la reprise
progressive des forces, peut-être, mais
surtout de la confiance en soi qu’une
stimulation
invigorative (avec vigueur)
aurait brisée dans l’œuf.
Renoncer à la doctrine de la stimulation
est certes un pari osé, mais qui ne peut
être que fructueux, à l’usage, en termes de
restauration des ressorts psychologiques
profonds de l’autonomie.
…/…
Ainsi à propos des choses de la vie
quotidienne, dire oui ou dire non, accepter
ou refuser aboutit en matière de confort à
éprouver des sensations différentes.
…/…
A notre sens rien ne sert, en effet, de
bombarder les patients âgés
d’anxiolytiques ou d’antidépresseurs,
jusqu’à les rendre confus, mieux vaut
développer des techniques de contact
renarcissisantes, d’autant qu’
il est, par
exemple, tout aussi facile de dire à
quelqu’un : « Mr X. voulez-vous venir ? »
que de lui dire : « venez ! ».
La renarcissisation est de loin de maître
mot de la prise en charge, et il est temps si
l’on veut entrer dans l’ère du soin, d’en finir
avec les pratiques volontaristes, fondées
sur l’invigoration et sur la stimulation.
S’il y
a quelque chose à stimuler, c’est l’intérêt
du patient, son désir, sa confiance en lui, le
sens de sa valeur
. L’approche invigorative
constitue, il faut le redire et insister, un
mode de persécution, qui ne peut
qu’alimenter les symptômes ou
sélectionner une population de sujets
passifs, avec quelques exceptions qui fuient
dans la guérison.
Ainsi, nous conseillons à nos collaborateurs
de ne jamais pratiquer d’injonction, sauf
lorsque la sécurité d’une personne est en
cause, et en pratique, nous tentons
d’obtenir qu’ils offrent chaque fois que
faire se peut, aux patients, d’opter entre
deux possibilités.
S’il s’agit de sécurité, les alternatives
porteront donc sur les modalités
d’application de la prescription, et lorsqu’il
s’agit simplement de confort
nous insistons
pour que les solutions offertes permettent
cette fois-ci l’acceptation ou le refus,
en
bloc (« est-ce que je laisse la porte de votre
chambre ouverte ou fermée ? »).
Il va sans dire que lorsque le patient
n’exprime aucun choix, le soignant est en
droit de décider seul.
Ce type d’approche, appliqué à
l’incontinence, donne par exemple :
- la journée lorsque l’incontinence
dérange autrui : un choix sur les
modalités de la toilette.
- la nuit s’il n’y a pas de risque d’escarre,
la liberté d’être changé ou de ne pas
l’être (avec la possibilité pour la
personne âgée de changer d’avis
ultérieurement) ;
- lorsqu’il y a un risque d’escarre, on est
renvoyé au cas de figure de l’obligation
de la toilette, et du change, avec
seulement le choix des modalités, ne
serait-ce par exemple que de la
température de l’eau (ce qui n’est pas
négligeable).
Il va de soi qu’il est difficile d’obtenir qu’une
telle approche se généralise, mais des
progrès ont été faits, et des résultats
positifs ont été enregistrés.
D’une façon très générale, nous pensons
d’ailleurs qu’il est important de
toujours
expliquer au patient, avec des mots
simples, ce qu’on est en train de lui
proposer ou de faire, ce qui suppose bien
entendu de proscrire la poursuite des
conversations privées entre soignants en
présence d’un patient
. On notera à ce
propos que l’approche physique d’un
patient, doit elle-même être travaillée,
comme tout ce qui relève de contact
corporel, car il est évident que ce n’est pas
la même chose de tirer quelqu’un par la
main (ce qui est inadmissible) que de lui
donner convivialement le bras, tout en
3

marchant à son pas, et en lui parlant (geste
naturel, d’adulte à adulte, qui comme tous
les gestes du même ordre passe très bien).
…/…
De même, nous pensons qu’en institution
un grand pas aura été fait lorsque le
« client » d’un établissement pourra au
moins planter un clou dans le mur de sa
chambre, c’est –à-dire lorsque celle-ci sera
considérée comme une forme de domicile,
un espace où il pourra décider de la place
des objets comme du contenu d’un placard
(dans la limite d’un règlement intérieur),
une zone où l’on ne pénètre pas sans avoir
le réflexe de frapper préalablement à la
porte, quelque que soit le degré de
dépendance ou de confusion de l’occupant.
Toujours en institution, nous pensons que
des progrès seront accomplis lorsque
l’introduction de méthodes modernes de
gestion du linge permettra que le port des
vêtements personnels soit la règle absolue.
Un cap aura été également franchi lorsque
le « pensionnaire », le « patient » le
« client »… (on voit bien à quel point le
vocabulaire fait défaut) pourra choisir au
coup par coup de prendre ses repas soit en
salle à manger, soit dans sa chambre. Nous
pensons même que, chaque fois que
possible, il serait souhaitable non
seulement de choisir ses mets, mais aussi
sa place à table, car choisir ses
commensaux constitue dans la vie un
confort et un droit élémentaire, qu’il doit
être possible d’exercer sans être tenu de
mettre en avant une justification médicale.
Certes, on nous objectera que certains
choisiront de régresser, mais à ma
connaissance nul n’a jamais empêché de
force qui que ce soit de régresser, tout au
plus, la régression observée change-t-elle
d’aspect pour se placer sur les terrains
physique, relationnel, ou psycho-
intellectuel.
Si nous faisons le geste de satisfaire les
désirs d’autrui, n’aurons-nous pas plus de
chances qu’il en vienne à tenir compte des
nôtres ?
Nous sommes encore actuellement, les uns
et les autres trop imprégnés, parfois à notre
insu, de l’idée préhistorique, de l’idée
archaïque, que l’on nous a inculquée, qu’il
ne faut pas que nos aînés se replient sur
eux-mêmes, et pour qu’ils ne le fassent pas,
qu’il faut les stimuler, avoir une attitude
pédagogique, les rééduquer…
Mais peut-on croire vraiment, en y
réfléchissant à froid, que le meilleur moyen
d’obtenir quelque chose de quelqu’un est
de le « bassiner » à mort ! Quel que soit
l’âge, cela peut-il être bon, et être
mobilisateur des ressources vitales
profondes de l’être, celles qui permettent
aux voyageurs égarés de poursuivre leur
marche dans le désert même au-delà des
limites de la physiologie ?
N’avons-nous pas, maladroitement, depuis
des années fait l’impasse dans presque
toute l’action gérontologique sur tout ce
qui serait raisonnement en termes de
priorité à la recherche du plaisir de l’autre,
parce que culturellement nous ne sommes
pas préparés à l’admettre comme principe
fondateur, autant des institutions que nous
créons ou gérons, que de notre action
sociale ou thérapeutique ?
En matière de stratégie d’autonomisation,
nous pensons que toute est à reprendre et
à réinventer en permanence au fil d’une
réflexion critique prenant en compte les
données de la clinique relationnelle.
Ainsi ce n’est pas par hasard si dans les
commentaires qui précèdent, nous nous
sommes abstenus de faire référence au
sevrage sexuel imposé par la vie en
institution, mais bien parce qu’il s’agit de
l’exemple d’une question ne pouvant être
abordée qu’au terme d’une réflexion
approfondie qui, à notre connaissance
reste à entreprendre, si l’on suppose que
certaines formes de dépendance, comme
les syndromes démentiels, constituent
peut-être une véritable pathologie du
consentement.
En définitive, nous pensons que la
question de l’autonomisation n’est pas de
réapprendre quoi que ce soit à des
personnes qui savent déjà, mais qui sont
en proie à des handicaps de l’utilisation de
ce qu’ils savent, mais bien plus de
mobiliser leurs ressources les plus
profondes, et les plus inconscientes, pour
contourner autant que faire se peut les
méfaits du handicap. Pour cela nous
proposons de recourir à la réassurance et
à la revalorisation constante, pour
solliciter le moteur psychique de
l’autonomie relationnelle (dans sa
dimension globale la plus instinctive)
moteur dont le pivot est le jeu du désir,
que nous proposons de restaurer.
A notre sens, la démarche d’auto-
nomisation passe par un préalable
méthodologique consistant à renoncer à
regarder nos interlocuteurs âgés comme
des sujets ayant perdu quelque chose,
pour les considérer comme ayant recours
à d’autres mécanismes, d’autres façons de
faire, d’autres modalités relationnelles
dans un contexte donné (associant
pathologie individuelle et facteurs
d’environnement).
Dr Louis Ploton
Commentaire :
Le moins que l’on puisse dire de ce texte c’est qu’il est revendicatif d’une autre
forme d’envisager la prise en charge des personnes âgées. Rien d’étonnant là de la
part d’un psychiatre. Reste néanmoins que malgré une connotation sans doute
provocatrice, l’auteur désigne directement nos habitudes les plus ancrées sur la
question de la stimulation des personnes âgées. Nous ne pouvons rester indifférents
à de tels arguments, émanant d’un médecin qui a travaillé depuis 1975 auprès des
personnes âgées.
Il est évident aussi que ce qui est décrit dans cet extrait est déjà en évolution
dans les institutions qui ont le plus de moyens comme la notre. Peut-être que dans
certaines maisons de retraites récemment devenues EHPAD, certaines de ces
réflexions n’ont pas encore étaient menées.
A Villeneuve-de-Berg, je crois que nous avons sans doute encore beaucoup de
travail sur ce plan, mais néanmoins je suis convaincu aussi que d’énormes progrès ont
été faits depuis quelques années. On perçoit petit à petit que lorsque les soignants
proposent aux résidents cela se fait avec plus d’offre de choix. Mais la situation reste
encore assez hétérogène en fonction des personnalités et je pense qu’il faut continuer
de réfléchir sur la question de la stimulation.
Richard Salicru
4

Claudine Badey-Rodriguez
, Les
personnes âgées en institution
,
Vie ou
survie
, pp. 107 à 108
La stimulation cognitive.
La stimulation cognitive s’est
développée grâce aux avancées dans le
domaine des neurosciences. Un
programme d’activation cérébrale permet
l’application d’un ensemble de stimulations
ayant pour objectif de solliciter le cerveau
afin d’en accroitre l’activité. L’intervenant
propose donc aux participants des exercices
qui sollicitent une ou plusieurs fonction
cognitives, comme l’attention-
concentration, la perception, la mémoire, le
langage, l’intelligence. Les objectifs d’un
programme d’activation cérébrale sont de
deux ordres : psychotechnique et
psychothérapeutique. L’objectif psycho-
technique vise à développer les capacités
mentales des participants ou à entretenir
les facultés restantes fin de réduire les
troubles ou de ralentir leur aggravation ;
l’objectif psychothérapique est centré sur
un remise en confiance et la
« remotivation ».
…/…
Pour prendre tout son sens, la
stimulation cognitive doit être incluse dans
un projet plus large de prise en charge
globale de la personne âgée.
Pour ma part, je situe ce type
d’activité davantage sur le registre de la
« remobilisation », en m’appuyant
notamment beaucoup sur les activités
sensorielles et sur des objets significatifs
dans l’histoire de vie des personnes,
susceptibles de déclencher des associations
de souvenirs, des évocations et des
échanges entre les participants, avec, entre
autres effets escomptés, une restauration
narcissique.
A titre d’illustration, dans un
groupe, une majorité de femmes avaient été
couturières. J’ai donc proposé aux
participants de faire la liste de tous les noms
de tissus qu’ils connaissaient, puis de
reconnaitre au seul toucher, des tissus
différents. La discussion s’est alors animée,
chacun a commencé spontanément à
raconter ses souvenirs : les vêtements qu’on
portait, les tissus qu’on utilisait, les ateliers
de couture autrefois. Même les personnes
les plus diminuées psychiquement ont pu
évoquer un souvenir. Madame L. évoque la
soie de Chine qu’elle affectionnait
particulièrement et dit avoir encore un
chemisier en cette matière. A la séance
suivante, elle vient, rayonnante, portant son
chemisier, et nous passons encore un long
moment à parler de la mode d’autrefois,
puis à faire des comparaisons avec la mode
d’aujourd’hui, grâce à la présentation de
photos actuelles.
Toute occasion est à saisir pour que
des connexions se fassent et des liens se
tissent. L’influence de l’affectivité sur la
mémoire, bien connue, peut se vérifier
régulièrement avec des personnes âgées.
Certes, nous avons, dans ce cas précis, fait
appel à la mémoire ancienne, toujours
mieux conservée, mais nous avons aussi
jeté des ponts vers le présent et avons
sollicité des activités cognitives de
comparaison, classification. Mais il s’agit
davantage d’ouvrir à nouveau des portes
pour quelques instants et de redécouvrir
toutes les richesses qui sont derrière.
Chaque séance commence
habituellement par un travail sur
l’orientation : quel jour sommes-nous,
quelle est la saison ? Un jour, pendant l’été
je demande aux participants s’ils se
souviennent des fêtes traditionnelles en
cette saison. Monsieur V., originaire du
village dans lequel est implantée la maison
de retraite, nous parle alors des fêtes
propres au village et des légendes qui y sont
attachées. Des incertitudes restant quant à
l’origine de l’une de ces manifestations,
Monsieur V. et une autre résidente assez
valide auront pour mission d’aller se
renseigner au village dans la semaine qui
suite. Certes, il aura fallu que je le leur
rappelle une ou deux fois car ils avaient
oublié, mais à la séance suivant, ils
n’avaient pas oublié l’information
complémentaire qui leur avait été fournie.
En institution, l’état de
dépendance des personnes accueillies et la
faiblesse de la motivation justifient, à mon
sens, davantage ce type d’intervention
qu’une stimulation cognitive telle qu’elle
peut être envisagée dans d’autres
contextes.
Commentaire
Claudine Badey-Rodriguez, psychologue en maison de retraite, nous
expose ici le cadre même dans lequel la stimulation des fonctions
cognitives doit être proposée. Ce qui ressort de ce texte, c’est bien
qu’il s’agit d’un projet institutionnel qui s’applique à l’individu. Dans
ce cadre, chaque individu doit être pris en compte en tant que tel,
c'est-à-dire que c’est sur le projet de vie qu’il doit être noté de quelle
meilleure manière nous allons pouvoir stimuler, en évoquant quel
type de thématique et en référence à quel type de souvenir. C’est
bien pour cela que le recueil de l’histoire de vie revêt une grande
importance car il va déterminer le type de stimulation que nous
allons choisir en équipe afin de coller au mieux avec le désir de la
personne.
On comprend bien, dans cette lecture, combien les liens entre
l’affectif et la mémoire sont importants. Cela doit nous interdire
d’exiger quoi que ce soit d’une personne souffrant de troubles
cognitifs ou encore de croire que celle-ci sera la même avec tous les
soignants. La mémoire émotionnelle est en effet une mémoire qui
résiste très bien aux dégradations de la vieillesse. Une stimulation
qui aurait donc l’allure d’une obligation, d’une contrainte ou d’une
frustration ne pourrait que provoquer le souvenir d’émotions
négatives alors qu’une sensation de plaisir, d’avoir été bien traité
durant un soin permet de garder le souvenir d’une émotion agréable.
Ces émotions seront donc associées à des soignants particuliers, à
leur visage, au ton de leur voix, mais aussi à des actes particuliers
(infirmiers ou de nursing), à des odeurs (savon, détergent) etc...
5
L’association qui se crée durant une occasion agréable permettra
donc de renouveler l’acte dans de bonnes conditions et
durablement. Là où cette situation se complique, c’est que nous
savons bien que, dans toute équipe, les soignants sont différents.
De l’un à l’autre, d’un jour à l’autre, les attitudes, les approches
vont changer. Ainsi, la toilette pourra être différente, une fois
agréable, une autre fois stressante. Le résultat est que les résidents
ne peuvent fixer une émotion claire sur un tel moment de la
journée et du coup ont, au pire, des comportements complètement
incohérents durant la toilette en réponse à des stimuli chaque fois
nouveaux et évoquant des émotions mal définies.
Une des solutions à ces difficultés serait donc d’uniformiser la
manière d’être avec les résidents, la façon de faire une toilette, tant
au niveau des gestes que de la parole, de l’émotion transmise, etc...
Je pense que si les toilettes d’une personne étaient
systématiquement faites par la même personne, il y aurait moins
de difficultés. Néanmoins, nous savons que c’est impossible à
réaliser. Donc, la seule possibilité qu’il nous reste serait
d’uniformiser les gestes, la façon d’aborder la personne, et
l’attitude juste durant l’acte. C’est certainement ce qui fait la
réussite des formateurs en Humanitude. Une de leur force est qu’ils
interviennent directement sur les résidents et sur l’ensemble d’une
équipe et que du coup ils uniformisent des comportements rendant
les soins moins bouleversants par leur hétérogénéité.
Richard Salicru
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%