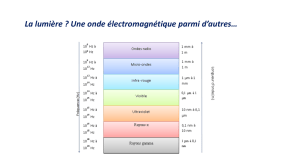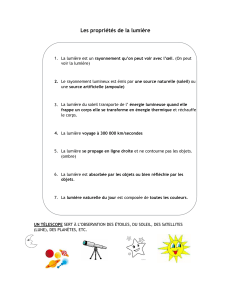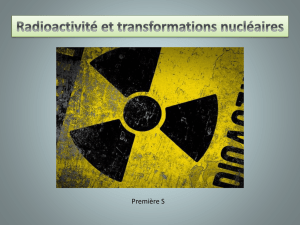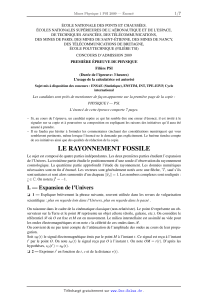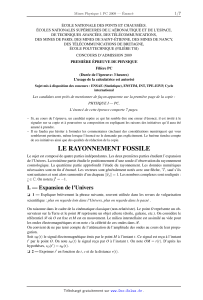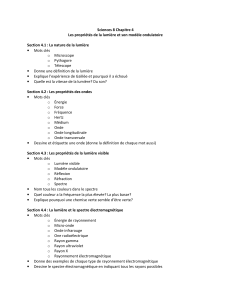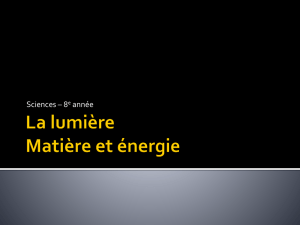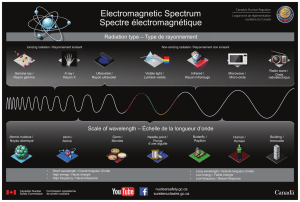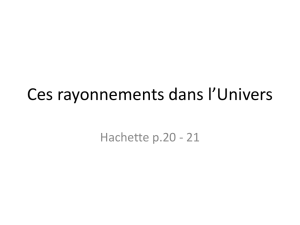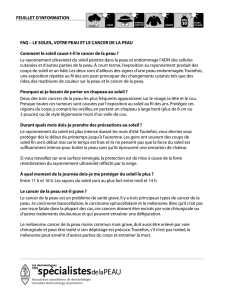le rayonnement fossile

´
ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSS´
EES.
´
ECOLES NATIONALES SUP´
ERIEURES DE L’A´
ERONAUTIQUE ET DE L’ESPACE,
DE TECHNIQUES AVANC´
EES, DES T´
EL´
ECOMMUNICATIONS,
DES MINES DE PARIS, DES MINES DE SAINT–´
ETIENNE, DES MINES DE NANCY,
DES T´
EL´
ECOMMUNICATIONS DE BRETAGNE,
´
ECOLE POLYTECHNIQUE (FILI`
ERE TSI)
CONCOURS D’ADMISSION 2009
PREMI`
ERE ´
EPREUVE DE PHYSIQUE
Fili`
ere PC
(Dur´
ee de l’´
epreuve: 3 heures)
L’usage de la calculatrice est autoris´
e
Sujet mis `
a disposition des concours : ENSAE (Statistique), ENSTIM, INT, TPE–EIVP, Cycle
international
Les candidats sont pri´
es de mentionner de fac¸on apparente sur la premi`
ere page de la copie :
PHYSIQUE I — PC.
L’´
enonc´
e de cette ´
epreuve comporte 7 pages.
– Si, au cours de l’´
epreuve, un candidat rep`
ere ce qui lui semble ˆ
etre une erreur d’´
enonc´
e, il est invit´
e`
a le
signaler sur sa copie et `
a poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il aura ´
et´
e
amen´
e`
a prendre.
– Il ne faudra pas h´
esiter `
a formuler les commentaires (incluant des consid´
erations num´
eriques) qui vous
sembleront pertinents, mˆ
eme lorsque l’´
enonc´
e ne le demande pas explicitement. Le bar`
eme tiendra compte
de ces initiatives ainsi que des qualit´
es de r´
edaction de la copie.
LE RAYONNEMENT FOSSILE
Le sujet est compos´
e de quatre parties ind´
ependantes. Les deux premi`
eres parties ´
etudient l’expansion
de l’Univers. La troisi`
eme partie ´
etudie le positionnement d’une sonde d’observation du rayonnement
cosmologique. La quatri`
eme partie approfondit l’´
etude du rayonnement. Les donn´
ees num´
eriques
n´
ecessaires sont en fin d’´
enonc´
e. Les vecteurs sont g´
en´
eralement not´
es avec une fl`
eche, −→
v, sauf s’ils
sont unitaires et sont alors surmont´
es d’un chapeau kb
exk=1. Les nombres complexes sont soulign´
es :
z∈C. On notera j2=−1.
I. — Expansion de l’Univers
1 — Expliquer bri`
evement la phrase suivante, souvent utilis´
ee dans les revues de vulgarisation
scientifique : plus on regarde loin dans l’Univers, plus on regarde dans le pass´
e.
On raisonne dans le cadre de la cin´
ematique classique (non-relativiste). Le point Orepr´
esente un ob-
servateur sur la Terre et le point Mrepr´
esente un objet c´
eleste (´
etoile, galaxie, etc.). On consid`
ere le
r´
ef´
erentiel Ro`
uOest fixe et Mest en mouvement. Le milieu interstellaire est assimil´
e au vide pour
les ondes ´
electromagn´
etiques et on note cla c´
el´
erit´
e de ces ondes dans R.
On convient de ne pas tenir compte de l’att´
enuation de l’amplitude des ondes au cours de leur propa-
gation.
Soit sM(t)le signal ´
electromagn´
etique ´
emis par le point M`
a l’instant t. Ce signal est rec¸u `
a l’instant
t′par le point O. On note sO(t)le signal rec¸u par O`
a l’instant t. On note OM =r(t). D’apr`
es les
hypoth`
eses, sO(t′) = sM(t).
2 — Exprimer t′en fonction de t,cet de la distance r(t).

LE RAYONNEMENT FOSSILE
3 — L’´
emetteur Ma une vitesse not´
ee −→
v(t), de norme v(t)et
faisant avec −−→
OM un angle
α
(t)(voir figure 1). L’´
emetteur ´
emet des
signaux p´
eriodiques de p´
eriode T. On suppose que la fr´
equence des
signaux est suffisamment grande pour pouvoir n´
egliger les variations
de −→
vet de
α
sur une p´
eriode. On suppose ´
egalement qu’`
a chaque
instant t,v(t)T/r(t)≪1. Exprimer, au premier ordre, la diff´
erence
r(t+T)−r(t).
4 — En d´
eduire, toujours au premier ordre, la p´
eriode T′des
signaux rec¸us par l’observateur en O. On exprimera T′en fonction
de T,v,cet
α
.
r
v
O
M
FIG. 1 – G´
eom´
etrie
5 — On appelle vitesse radiale de Mla quantit´
evr=vcos
α
. On note
λ
la longueur d’onde du
signal ´
emis par Met
λ
′la longueur d’onde du signal rec¸u en O. Donner la relation qui existe entre
λ
,
λ
′,vret c. On mettra cette relation sous la forme
λ
′/
λ
=1+Z. La quantit´
eZainsi d´
efinie s’appelle
le redshift.
6 — On suppose que Mse rapproche de O. Si M´
emet une longueur d’onde
λ
situ´
ee dans le jaune
(
λ
=585 nm), la longueur d’onde
λ
′rec¸ue en Oest-elle d´
ecal´
ee vers le rouge ou bien d´
ecal´
ee vers
le bleu par rapport `
a
λ
? On justifiera la r´
eponse.
FIG. 2 – Loi de Hubble
En 1929, le physicien Edwin Hubble a relev´
e
le spectre de la lumi`
ere issue des galaxies dont
la distance `
a la Terre ´
etait connue. En compa-
rant ces spectres `
a ceux d’´
el´
ements chimiques
connus, il en a d´
eduit le redshift Z de ces
galaxies. Les points exp´
erimentaux pour plu-
sieurs galaxies sont repr´
esent´
es sur la figure 2.
En notant dla distance Terre-galaxie et vrla
vitesse radiale de la galaxie par rapport `
a la
Terre, les mesures sugg`
erent une loi lin´
eaire
du type vr=H×d. Cette loi porte le nom de
loi de Hubble et Hs’appelle la constante de
Hubble (le mot constante signifie qu’il s’agit
d’une constante par rapport `
a l’espace et non
dans le temps).
d0,87 1,05 1,56 1,76 2,11 2,26 2,48 2,77 3,92 4,59 4,30 5,32 6,92 7,21 11,22 14,47
Z×1020,71 0,83 1,06 1,23 1,67 1,72 1,92 1,92 2,68 2,93 3,23 3,69 4,55 4,95 7,42 10,00
Donn´
ees exp´
erimentales ayant permis la construction de la figure 2, dest exprim´
ee en unit´
e de 1024m.
7 — Donner une estimation num´
erique de Hen unit´
es du syst`
eme international, puis en km.s−1par
million d’ann´
ees-lumi`
ere. Que signifie cette unit´
e. On ne s’offusquera pas du fait que la loi de Hubble
puisse donner des vitesses radiales d´
epassant cpour des galaxies tr`
es ´
eloign´
ees. Cette impossibilit´
e
n’apparaˆ
ıt pas lorsque les ph´
enom`
enes relativistes sont pris en compte.
8 — La loi de Hubble sugg`
ere que l’Univers soit en expansion. Le mod`
ele du big-bang permet
de postuler que cette expansion a commenc´
e depuis un temps fini et donc que l’Univers peut se voir
attribuer un ˆ
age. Avec des arguments qualitatifs simples, expliquer pourquoi l’inverse de la constante
Page 2/7

Physique I, ann´
ee 2009 — fili`
ere PC
de Hubble est un bon ordre de grandeur de l’ˆ
age de l’Univers. Estimer num´
eriquement l’ˆ
age de
l’Univers en milliards d’ann´
ees.
9 — Dans cette question, on veut savoir si l’expansion de l’Univers va un jour s’arrˆ
eter ou non.
Pour cela, on mod´
elise l’Univers par une boule homog`
ene de masse volumique
ρ
constante et dont
le rayon R(t)suit la loi d’expansion de Hubble. On consid`
ere une galaxie (suppos´
ee ponctuelle) de
masse msitu´
ee `
a la surface de la boule et s’´
eloignant radialement `
a la vitesse ˙
R=dR/dt du centre de
la boule. Exprimer l’´
energie m´
ecanique de cette galaxie. En d´
eduire qu’`
a partir d’une certaine masse
volumique de l’Univers, not´
ee
ρ
c, la galaxie ne pourra pas s’´
eloigner ind´
efiniment. Exprimer
ρ
cen
fonction de la constante de gravitation Get de la constante de Hubble H=˙
R/R.
10 — Donner la valeur num´
erique de
ρ
c. Les observations de la mati`
ere visible de l’Univers
donnent une masse volumique moyenne
ρ
≃3×10−28 kg.m−3. D’apr`
es cette donn´
ee, l’expansion
durera-t-elle ind´
efiniment?
FIN DE LA PARTIE I
II. — Le rayonnement fossile
II.A. — Propri´
et´
es g´
en´
erales
D`
es 1948, le physicien Gamow a pr´
evu que le big-bang a
dˆ
u laisser une trace dans l’Univers sous forme de rayon-
nement ´
electromagn´
etique, appel´
erayonnement fossile. Ce
rayonnement a ´
et´
e d´
ecouvert en 1962 par Penzias et Wil-
son (prix Nobel 1978). La densit´
e volumique w
λ
d’´
energie
´
electromagn´
etique de ce rayonnement par unit´
e de longueur
d’onde
λ
est repr´
esent´
ee sur la figure 3.
11 — Quel type d’ondes ´
electromagn´
etiques est associ´
e
au rayonnement fossile ? On justifiera la r´
eponse en don-
nant des ordres de grandeur connus. FIG. 3 – Spectre du rayonnement fossile
La courbe de la figure 3 a exactement la mˆ
eme forme que celle correspondant `
a l’´
emission d’un
corps chauff´
e (braise chaude, int´
erieur d’un four etc.). Pour ce type de rayonnement, la longueur
d’onde
λ
mau maximum d’´
emission est li´
ee `
a la temp´
erature Tdu corps chauff´
e par la loi de Wien :
λ
m×T=constante ≃2,9mm.K. Par abus de langage, Test appel´
ee temp´
erature du rayonnement.
12 — D´
eterminer la temp´
erature actuelle du rayonnement fossile.
On d´
ecide qu’`
a chaque instant depuis son ´
emission, on peut identifier la temp´
erature de l’Univers `
a
celle du rayonnement fossile.
13 — Le rayonnement fossile est le r´
esultat d’un processus physique qui s’est d´
eroul´
e pendant
une phase tr`
es br`
eve de l’histoire de l’Univers durant laquelle sa temp´
erature Tvalait environ 3000K.
En admettant que les longueurs d’onde aient subi la mˆ
eme dilatation que l’Univers, de quel facteur
l’Univers s’est-il dilat´
e entre le moment de l’´
emission du rayonnement fossile et aujourd’hui?
II.B. — Propri´
et´
es thermodynamiques
On montre que la densit´
e volumique d’´
energie ´
electromagn´
etique par unit´
e de fr´
equence
ν
associ´
ee
au rayonnement contenu dans une enceinte dont les parois sont `
a la temp´
erature Tet r´
efl´
echissent
parfaitement ce rayonnement s’´
ecrit id´
ealement
w
ν
(
ν
,T) = 8
π
h
ν
3
c31
exph
ν
kBT−1
o`
uhest la constante de Planck, cla c´
el´
erit´
e de la lumi`
ere et kBla constante de Boltzmann.
Page 3/7 Tournez la page S.V.P.

LE RAYONNEMENT FOSSILE
14—Quelle est l’unit´
e de w
ν
? Montrer que la densit´
e volumique totale d’´
energie ´
electromagn´
etique
udu rayonnement se met sous la forme u=aT
δ
, o`
u
δ
est un nombre entier que l’on pr´
ecisera et a
une constante que l’on exprimera en fonction de kB,het cet dont on pr´
ecisera la valeur num´
erique.
On rappelle que Z∞
0
x3
ex−1dx=
π
4
15
L’Univers est assimil´
e`
a une enceinte sph´
erique de rayon Ret de volume V. On admet que le rayon-
nement fossile est mod´
elisable par un gaz `
a la temp´
erature Tet dont la pression pv´
erifie l’´
equation
d’´
etat p=u/3, o`
uud´
esigne toujours la densit´
e volumique totale d’´
energie ´
electromagn´
etique intro-
duite `
a la question 14. Cette hypoth`
ese sera justifi´
ee dans la partie IV. `
A cause de l’expansion de
l’Univers, ce gaz subit une d´
etente adiabatique suppos´
ee quasistatique.
15 — D´
emontrer que, dans ce mod`
ele, le rayon Rde l’Univers et sa temp´
erature Tob´
eissent `
a une
relation du type R×T=constante. On ne demande pas d’exprimer la constante.
FIN DE LA PARTIE II
III. — La sonde Planck
Afin d’´
etudier certaines propri´
et´
es du
rayonnement fossile, l’Agence Spatiale
Europ´
eenne va placer en orbite la sonde
Planck dans le courant du mois d’avril
2009! De mani`
ere `
a ce qu’elle ne soit
pas ´
eblouie par le soleil lors des me-
sures, cette sonde a ´
et´
e plac´
ee dans le
cˆ
one d’ombre de la Terre situ´
e`
a l’oppos´
e
du Soleil, comme indiqu´
e sur la figure 4
(cette figure ne respecte pas les ´
echelles).
FIG. 4 – Position de la sonde
16 — Donner la position du centre de masse du syst`
eme Terre-Soleil. Estimer l’erreur relative que
l’on commet si on assimile le centre du Soleil au centre de masse Terre-Soleil.
D´
esormais, on consid`
ere que le centre de masse du syst`
eme Terre-Soleil et confondu avec le centre
du Soleil. Le r´
ef´
erentiel h´
eliocentrique sera consid´
er´
e comme galil´
een. On assimile la Terre `
a un
point de masse MTse d´
eplac¸ant sur une trajectoire circulaire de rayon rautour du Soleil. On n´
eglige
l’influence des astres autres que le Soleil.
17 — Montrer que la Terre tourne `
a vitesse constante autour du Soleil. Exprimer la p´
eriode Tde
rotation de la Terre autour du Soleil ainsi que la vitesse angulaire
ω
de cette rotation en fonction de la
constante de la gravitation universelle G,ret de la masse MSdu Soleil. Calculer la valeur num´
erique
de T.
La sonde devant toujours ˆ
etre situ´
ee dans le cˆ
one d’ombre de la Terre, on travaillera d´
esormais dans
le r´
ef´
erentiel R′centr´
e sur le Soleil S, en rotation `
a la vitesse angulaire
ω
par rapport au r´
ef´
erentiel
h´
eliocentrique galil´
een. La Terre est donc fixe dans R′. Dans le r´
ef´
erentiel R′, on choisit un rep`
ere
cart´
esien orthonorm´
e direct (S,b
ex,b
ey,b
ez). Le vecteur rotation −→
ω
=
ω
b
ezest tel que
ω
>0. Le plan
(S,b
ex,b
ey)est le plan de r´
evolution de la Terre autour du Soleil.
Page 4/7

Physique I, ann´
ee 2009 — fili`
ere PC
On ne s’int´
eresse qu’aux cas o`
u la sonde est
dans ce plan. La vitesse de la sonde dans R′est
suppos´
ee toujours assez faible pour que la force
d’inertie de Coriolis soit n´
eglig´
ee. On note m
la masse de la sonde, rla distance Terre-Soleil,
rT=TM la distance sonde-Terre, rS=SM la
distance sonde-Soleil, et b
erle vecteur unitaire
qui pointe du Soleil vers la sonde FIG. 5 – R´
ef´
erentiel li´
e`
a la Terre
18 — Montrer que l’´
equation du mouvement de la sonde dans R′s’´
ecrit
md2−→
SM
dt2=−−−−−−→
grad(Ep)
o`
uEpest une ´
energie potentielle dont on donnera l’expression en fonction de
ω
,m,MS,MT,rSet rT.
Les positions d’´
equilibre de la sonde dans R′correspondent aux extrema de Ep, on montre qu’il en
existe cinq, toutes contenues dans le plan (S,b
ex,b
ey). Ces positions sont appel´
ees points de Lagrange.
19 — Montrer qu’il existe trois points de Lagrange sur l’axe (S,b
ex). Puis, `
a l’aide d’arguments
´
energ´
etiques, pr´
eciser si ces points d’´
equilibre sont stables ou instables vis-`
a-vis de perturbations
dans la direction b
ex.
On s’int´
eresse au point de Lagrange L2, situ´
e sur l’axe (S,b
ex)dans le cˆ
one d’ombre `
a l’oppos´
e du
Soleil par rapport `
a la Terre (voir figure 4). On note ℓla distance entre le centre de la Terre et L2.
20 — Donner, sans la r´
esoudre, l’´
equation alg´
ebrique v´
erifi´
ee par ℓ. En faisant l’hypoth`
ese que
ℓ≪r, trouver une expression litt´
erale approximative de ℓ, et en d´
eduire sa valeur num´
erique. V´
erifier
a posteriori l’hypoth`
ese sur ℓ.
Il est possible de montrer que L2est stable vis-`
a-vis de perturbations dans les directions b
eyet b
ez. On
consid`
erera donc, pour simplifier, que tout se passe comme si la sonde ´
etait astreinte `
a se d´
eplacer
uniquement sur l’axe (S,b
ex), sans frottement .
21 — La sonde ´
etant plac´
ee en L2, on envisage une petite perturbation de sa position de la forme
−→
ε
(t) =
ε
(t)b
ex.´
Ecrire l’´
equation diff´
erentielle v´
erifi´
ee par
ε
(t). Lin´
eariser cette ´
equation en supposant
qu’`
a chaque instant ton puisse ´
ecrire r≫ℓ≫
ε
(t). On fera apparaˆ
ıtre dans l’´
equation lin´
earis´
ee un
temps caract´
eristique
τ
dont on donnera l’expression litt´
erale en fonction de r,Get MS. En d´
eduire
un ordre de grandeur num´
erique de l’intervalle de temps s´
eparant deux repositionnements cons´
ecutifs
de la sonde Planck.
FIN DE LA PARTIE III
IV. — Pression de radiation
Le but de cette partie est de justifier l’expression de l’´
equation d’´
etat du rayonnement utilis´
ee dans
la partie II.B. Le rayonnement cosmologique peut ˆ
etre consid´
er´
e comme une superposition d’ondes
´
electromagn´
etiques planes progressives monochromatiques de fr´
equences et de directions de propa-
gation diff´
erentes. On note ul’´
energie du rayonnement par unit´
e de volume, moyenn´
ee en temps
et en espace et pla pression de radiation, c’est-`
a-dire la force par unit´
e de surface, moyenn´
ee en
temps, qu’exercerait le rayonnement sur les parois parfaitement r´
efl´
echissantes d’une enceinte qui le
contiendrait. Avec ces notations, on veut ´
etablir l’´
equation d’´
etat du rayonnement : p=u/3. Pour cela,
on commence par ´
etudier la r´
eflexion d’une onde ´
electromagn´
etique monochromatique en incidence
oblique sur un miroir m´
etallique parfaitement conducteur.
Page 5/7 Tournez la page S.V.P.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%