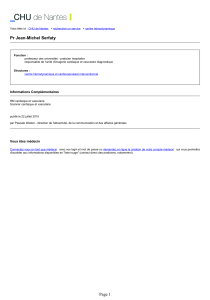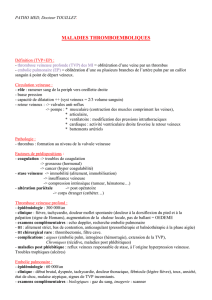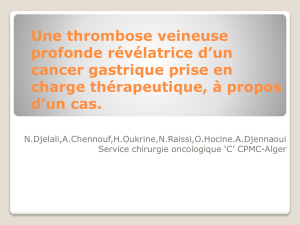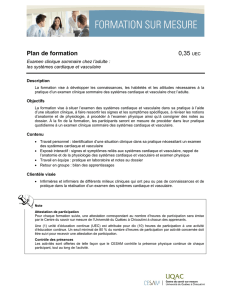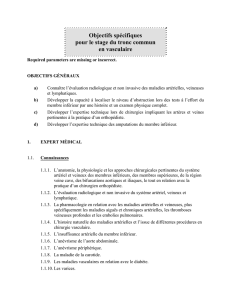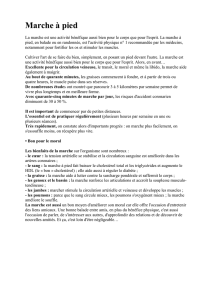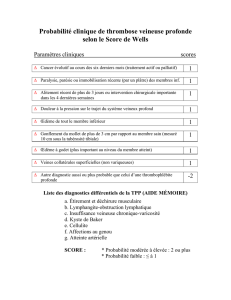SEMIOLOGIE VASCULAIRE

SEMIOLOGIE(VASCULAIRE(
Collège'National'des'Enseignants'de'Médecine'Vasculaire!

Collège National des Enseignants de Médecine Vasculaire
2
SOMMAIRE
I Généralités
● L’interrogatoire vasculaire
● L’examen physique vasculaire
● L’organisation du raisonnement vasculaire
II Sémiologie des maladies vasculaires périphériques
● Veines des membres inférieurs
- Thrombose veineuse profonde
- Thrombose veineuse superficielle
- Embolie pulmonaire
- Insuffisance veineuse chronique, maladie variqueuse
● Veines cervicales et des membres supérieurs (système cave supérieur)
- Thrombose veineuse
● Artères
- Artères des membres inférieurs
- Artères des membres supérieurs
- Tronc supra-aortiques
- Aorte et ses branches viscérales
● Lymphatiques
- Lymphoedème
● Microcirculation
● Mesure de la tension artérielle
III Grandes situations cliniques
● Grosse jambe aiguë
● Grosse jambe chronique
● Douleurs des membres
- A l’effort
- Au repos (incluant les aiguës)
● Douleurs thoraciques
● Douleurs abdominales et lombaires
● Troubles trophiques des membres inférieurs
● Malformations vasculaires
● Malaises

Collège National des Enseignants de Médecine Vasculaire
3
Ont participé à la rédaction de cet ouvrage :
Victor Aboyans
Claire Ambid-Lacombe
Michel Azizi
François Becker
Christian Boissier
Carine Boulon
Luc Bressollette
Alessandra Bura Rivière
Patrick Carpentier
Joël Constans
Nicole Ferreira Maldent
Mickael Frank
Bruno Guias
Jean Louis Guilmot
Claudine Hamel Desnos
Claire Le Hello
Asma El Jaouhari
Aurélie Khau Van Kien
Claude Kouakam
Philippe Lacroix
Anne Long
Youssef Moumouni
Claire Mounier Vehier
Gilles Pernod
Marc Antoine Pistorius
Marie Antoinette Sevestre Pietri
Jeannot Schmidt
Isabelle Quéré
Michel Vayssairat
Denis Wahl
Jacques Watelet

Collège National des Enseignants de Médecine Vasculaire
4
L’INTERROGATOIRE DU PATIENT VASCULAIRE
Chez le patient vasculaire comme dans les autres types de pathologies, l’interrogatoire est le
premier temps de l’examen clinique et le plus riche en informations qu’il faut recueillir avec
un souci constant d’exhaustivité et de précision. Cela nécessite une attitude médicale faite à la
fois d’ouverture attentive et d’esprit critique : l’interrogatoire est un véritable exercice de
communication où le médecin doit s’adapter au niveau socio-culturel du patient pour en être
compris, et établir la relation de confiance en montrant de l’empathie et en témoignant d’une
forte motivation à résoudre le problème posé. La conduite de l’interrogatoire doit être
maîtrisée, laissant le patient exprimer son histoire et ses éprouvés, mais en le guidant par des
questions permettant de canaliser le discours vers les informations utiles, et d’obtenir toutes
les précisions utiles au diagnostic. Ces questions doivent être formulées de façon neutre, non
suggestive, et le plus souvent ouverte, pour ne pas biaiser les réponses.
Les principaux thèmes couverts par l’interrogatoire du patient sont le motif de la consultation
ou de l’hospitalisation, l’historique du problème posé ou de la maladie si elle est déjà
identifiée, les antécédents, le mode de vie et les facteurs de risque, l’inventaire des
symptômes et les différents traitements. Dans une optique pré-thérapeutique qui dépasse le
cadre de cet ouvrage, cet interrogatoire est complété par l’évaluation des représentations du
patient, de ses craintes et de ses attentes. Il fait l’objet d’un compte-rendu détaillé, daté, signé
et qui comporte toutes les données d’identification et démographiques habituelles.
1. Le motif de consultation ou d’hospitalisation
L’ordre d’acquisition des informations au cours de l’interrogatoire ne répond pas à une règle
rigide. D’ailleurs, celui-ci n’est habituellement pas linéaire, avec de nombreux retours en
arrière pour recouper certaines informations et ainsi mieux les clarifier. Toutefois, il est
naturel de commencer par bien préciser le problème qui amène le patient et lui faire expliciter
le type d’aide qu’il attend du médecin : soulagement symptomatique, information
diagnostique ou pronostique, avis sur la prise en charge etc... cela permet de mettre d’emblée
les préoccupations du patient au centre de l’entretien, et d’être mieux à même d’y répondre
de manière adéquate. L’obtention de la confiance du patient en est aussi facilitée, ce qui
améliore la qualité du recueil d’information ultérieur.
2. L’historique du problème posé
L’historique des troubles apporte très souvent des informations diagnostiques ou pronostiques
importantes. L’analyse chronologique s’adresse d’abord au problème tel que le patient l’a
identifié, ou à la maladie si elle est déjà connue. Il faut lui en faire décrire un historique
précis, éventuellement complété des comptes rendus des examens complémentaires,
interventions et hospitalisations. Cette analyse chronologique sera reprise ultérieurement pour
chaque symptôme et fera, dans les cas complexes, l’objet d’une synthèse finale.
3. Les antécédents, le mode de vie et les facteurs de risque
Le recueil des antécédents familiaux et personnels est particulièrement précieux chez le
patient vasculaire, car la plupart des maladies vasculaires sont chroniques, et elles présentent
souvent un risque familial. C’est, par exemple, le cas des varices primitives ou du phénomène
de Raynaud primaire, et surtout de la maladie thromboembolique veineuse et de

Collège National des Enseignants de Médecine Vasculaire
5
l’athérosclérose dont il faut préciser le type d’accident, les circonstances de survenue et le
caractère documenté ou non du diagnostic. Pour les antécédents familiaux, il faut préciser le
degré de parenté des personnes atteintes, et même, dans certaines pathologies comme les
thrombophilies, rapporter ces informations à l’arbre généalogique de la famille.
Le mode de vie est important à préciser, non seulement pour déterminer les facteurs de risque
qui lui sont attachés, mais aussi pour adapter le projet de prise en charge thérapeutique aux
conditions de vie du patient.
La profession peut être à l’origine d’un risque vasculaire, ainsi la position debout immobile
prolongée pour la pathologie veineuse chronique (cf chapitre insuffisance veineuse chronique)
ou les longs trajets en avion pour la maladie thromboembolique (cf chapitre trhombose
veineuse profonde). Certaines maladies vasculaires sont même complètement d’étiologie
professionnelle et même reconnues comme telles sur le plan médico-social, comme le
syndrome des vibrations ou celui du marteau hypothénar. Ces derniers nécessitent non
seulement le recueil d’un historique professionnel, mais aussi, si le patient a exercé une
profession manuelle, la recherche de l’emploi de certains types d’outils (engins vibrants tenus
à la main) ou de gestes (percussion d’objets avec le talon de la main). Certains sports
pratiqués intensivement peuvent également induire des pathologies similaires (chocs répétés
au niveau des mains).
Par ailleurs, la plupart des maladies vasculaires sont multifactorielles, et l’évaluation des
facteurs de risque constitutionnels (âge, sexe, antécédents familiaux) mais surtout acquis et
donc modifiables (troubles métaboliques, traitements hormonaux, tabac, comportement
alimentaire, activité physique etc…). Ainsi en est-il de l’athérosclérose, des varices et de
l’insuffisance veineuse chronique, mais aussi de la maladie thromboembolique où l’on
distingue les facteurs de terrain et les événements déclenchants potentiels.
4. L’analyse des symptômes vasculaires
Comme pour les autres pathologies, la description de chaque signe fonctionnel ou symptôme
vasculaire doit en préciser l’ensemble de ses caractères.
Ainsi, pour une douleur, il faut en analyser le type, la topographie (siège et irradiation),
l’intensité, le mode évolutif (mode de début, durée, rythme), les signes d’accompagnement et
les circonstances d’apparition et de résolution, d’aggravation et d’amélioration. Notons que
dans la pathologie vasculaire, les circonstances sont plus informatives que le type de la
douleur ; c’est par exemple le cas de la claudication intermittente artérielle et de la gêne de
l’insuffisance veineuse). La plupart des douleurs vasculaires témoignent de la souffrance
tissulaire d’aval (artériopathies) ou d’amont (maladies veineuses), mais les vaisseaux eux-
mêmes peuvent être le siège de douleurs inflammatoires, thrombotiques ou d’une dissection
pariétale.
Les sensations d’extrémités froides ou chaudes doivent être confrontées à la mesure
objective de la température locale par la thermométrie ou au moins la palpation, avant d’être
attribuées à des variations de débit sanguin et donc à un mécanisme vasculaire.
Les plaintes du patient peuvent aussi concerner des changements de couleur, comme dans le
cas des acrosyndromes, ou des dysfonctionnements d’organes victimes de la pathologie
vasculaire : dyspnée, fatigabilité, dysfonction érectile.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
1
/
117
100%