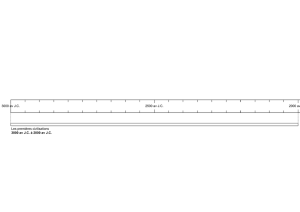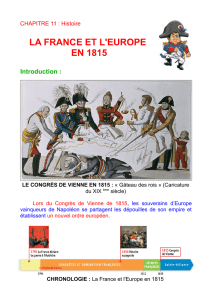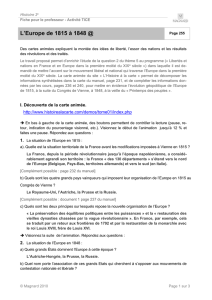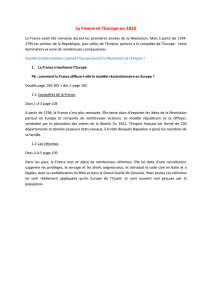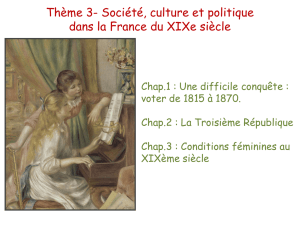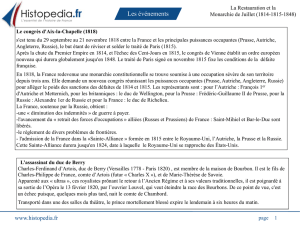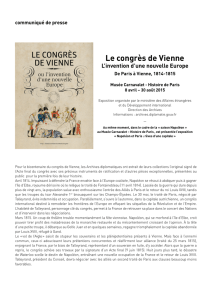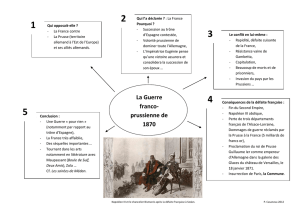7 La France et l`Europe en 1815

JE RÉVISE / HISTOIRE DES ARTS
« Je révise » disponible en version interactive. Lib’ : audio «
La Marseillaise
».
1)
Se situer dans le temps
1. 1804 ; 2. 1792 ; 3. 1789 ; 4. 1801 ; 5. 1798 ; 6. 1789 ; 7. 1789 ;
8. 1792.
2)
Comparer deux situations historiques (voir tableau ci-dessous)
3)
Connaître le vocabulaire du chapitre
1. Suffrage censitaire ; 2. Le préfet ; 3. Souveraineté nationale ;
4. Légion d’honneur ; 5. Peuple ; 6. Code civil.
Histoire des arts
La Marseillaise
n’est pas née à Marseille !
1)
Le Chant de guerre pour l’armée du Rhin est composé par Rouget
de Lisle alors que la France est entrée en guerre contre la Prusse et
l’Autriche. Des volontaires affluent vers le Nord-Est de la France. Parmi
eux, des soldats originaires de la région de Marseille et de Montpellier,
qui s’emparent de ce chant. Ils l’entonnent lorsqu’ils entrent à Paris en
juillet 1792 : les Parisiens le rebaptisent spontanément La Marseillaise.
2)
Les expressions « aux armes », « formez vos bataillons » ou
« combats avec tes défenseurs » montrent que La Marseillaise est
un chant de guerre. Le passage sur les « rois conjurés » indique qu’il
s’agit également d’un chant révolutionnaire.
19
Chapitre 7 x La france eT L’europe en 1815
7La France et l’Europe en 1815
[ pp. 88-99 du manuel ]
Programme officiel Correspondance avec le manuel
II. La Révolution et l’Empire
Thème 3 – La France et l’Europe en 1815
Connaissances
L’Europe, en 1815, donne l’illusion d’un retour à l’ordre ancien. Mais
les guerres révolutionnaires ont répandu les idées de la Révolution
française et engendrent en réaction le sentiment national.
Chapitre 7. La France et l’Europe en 1815
x
Cours – Un retour à l’ordre ancien ?
pp. 94-95
x
Dossier Histoire des arts – Goya et la nation espagnole
pp. 90-91
x
Dossier – L’Europe en 1811 et en 1815
pp. 92-93
x
Histoire des arts – Goethe déçu par la Révolution française
p. 99
Démarches
L’analyse d’une carte de l’Europe en 1815 sert de support à l’étude.
Les témoignages sur l’affirmation du sentiment national sont mis en
évidence notamment au travers d’œuvres artistiques au choix.
x
Dossier – L’Europe en 1811 et en 1815
pp. 92-93
x
Dossier Histoire des arts – Goya et la nation espagnole
pp. 90-91
x
Histoire des arts – Goethe déçu par la Révolution française
p. 99
Capacités
Connaître et utiliser le repère suivant : Congrès de Vienne, 1815.
Décrire les grandes transformations sociales, politiques et territo-
riales issues de la période révolutionnaire en Europe.
x
Cours – Un retour à l’ordre ancien ?
pp. 94-95
x
Exercices –
pp. 96-98
voir programme compLet pp. 348-349
La France avant 1789 FONDATIONS La France en 1815
Tous les pouvoirs au roi
Français sujets
Découpages administratifs complexes
Politiques et
administratives
Constitution séparant les pouvoirs
Français citoyens
Départements et communes
Société d’ordres, privilèges
Droits seigneuriaux
Censure
Armée de professionnels
Sociales
Égalité de tous devant la loi
Droits seigneuriaux abolis
Liberté d’expression
Armée de citoyens-soldats
Diversité des monnaies, des poids et des mesures
Réglementation de la production et douanes intérieures Économiques Le Franc, poids et mesures unifiés
Liberté d’entreprise et de commerce
Pas de liberté de culte
Église riche Religieuses Liberté de culte
Clergé salarié de l’État
© Éditions Belin 2011

OUVERTURE DU CHAPITRE [pp. 88-89]
La France et l’Europe en 1815
x x Problématique
Comment les souverains réorganisent-ils l’Europe après la période
révolutionnaire et impériale ?
Les guerres de la Révolution française et de la période impériale ont
diffusé les idées nouvelles dans toute l’Europe et permis l’éveil d’un
sentiment national au sein des empires. Après la chute de Napoléon I
er
,
la principale préoccupation des souverains est de maintenir l’intégrité
de leur royaume et d’étouffer tout foyer révolutionnaire potentiel.
x x Réponses aux questions
Doc. 1 Pendant la période impériale, l’occupation par les troupes
napoléoniennes entraîne des révoltes. Les populations rejettent la
domination française au nom des idéaux que les guerres révolu-
tionnaires ont diffusés : liberté, égalité des droits et souveraineté
nationale. L’attitude même des personnages donne l’impression
d’une liberté retrouvée, après la fin de l’occupation française.
Doc. 2 La victoire est symbolisée par l’aigle impérial gisant sur
le sol, aux pieds des souverains. Ces derniers se réunissent sous
la croix. Mais derrière le principe religieux, ciment de la « Sainte
Alliance », il s’agit bien d’un rapprochement politique.
DOSSIER [pp. 90-91]
Sur www.libtheque.fr : fiche d’activités. Lib’ : vidéo « Francisco de Goya », œuvre animée.
Goya et la nation espagnole
x x Problématique
Comment Goya témoigne-t-il de l’affirmation du sentiment national
espagnol ?
Le Tres de Mayo demeure l’œuvre emblématique de la résistance
espagnole à l’occupation napoléonienne. Goya peint ce tableau en
1814, alors que le roi Ferdinand VII est rétabli sur le trône et que les
troupes françaises ont évacué le pays. Il s’agit d’ailleurs d’une com-
mande du gouvernement provisoire espagnol, suggérée par Goya,
tout comme le Dos de Mayo, dans lequel le peintre rend également
hommage aux insurgés espagnols.
x x Histoire des Arts
1)
Doc. 1 et 2 Le Tres de Mayo est réalisé par Francisco de Goya en
1814. Il décrit la répression française contre les insurgés madrilènes,
le 3 mai 1808. L’œuvre (266 x 345 cm) est conservée au musée du
Prado à Madrid.
2)
Au moment de l’insurrection, c’est le frère de Napoléon I
er
, Joseph
Bonaparte, qui dirige l’Espagne. Lorsque Goya réalise ce tableau,
Ferdinand VII, qui avait dû abdiquer en 1808, a retrouvé son trône.
3)
Doc. 1 Dans la partie gauche du tableau, des cadavres jonchent
le sol, alors que d’autres hommes s’apprêtent à être fusillés par
des soldats ou sont poussés vers le peloton d’exécution. Leur
attitude exprime des sentiments divers : la peur, le désespoir, mais
également le courage. Représentés de dos, les soldats français, par
contraste, n’expriment aucun sentiment.
4)
Doc. 2 et 3 Les Espagnols se révoltent au nom de leur aspiration
à la souveraineté nationale, bafouée par l’autorité d’un souverain
étranger imposé. Mais ils réagissent également contre la brutalité
de l’occupation française, les exactions des soldats, puis contre la
violence de la répression exercée contre les « patriotes ».
5)
Goya souhaite rendre hommage au martyr subi par les insurgés
madrilènes. Son message est celui de l’unité d’un peuple face à un
ennemi commun, jusque dans le sacrifice.
6)
Le peintre utilise les couleurs et la lumière pour donner de la
force à son œuvre. Le personnage central du tableau, à gauche de
la scène, est représenté par des couleurs très claires et se trouve
en pleine lumière, ce qui renforce sa posture et son expression. À
l’inverse, les soldats français sont déshumanisés : on ne distingue
par leurs visages et ils demeurent dans l’ombre.
7)
Par le choix du sujet, mais également par le traitement artistique
de son œuvre, Goya montre une nation fière, unie et solidaire face
à l’oppression.
x x Bilan du dossier
Les élèves doivent avoir compris que le contexte des événements
représentés par Goya n’est pas le même que celui de la réalisation
du tableau. Ils doivent également avoir retenu qu’un artiste peut
mettre son talent au service d’une cause politique. Enfin, ils doivent
pouvoir expliquer par quels procédés artistiques un peintre peut
susciter l’empathie pour une cause.
DOSSIER [pp. 92-93]
Sur www.libtheque.fr : fiche d’activités. Lib’ : cartes animées.
L’Europe en 1811 et en 1815
x x Problématique
Quelles transformations territoriales sont décidées au Congrès de
Vienne ?
Le Congrès de Vienne met définitivement fin à l’influence de la
France en Europe et scelle un retour à l’ordre ancien, confortant
ainsi les puissances de la Sainte Alliance victorieuses. Mais dans
cette nouvelle Europe, la montée en puissance des mouvements
nationaux se poursuit, même si elle est temporairement étouffée.
x x Réponses aux questions
1)
Doc. 1 Les royaumes allemands, l’Italie et la Pologne. L’occupation
des armées révolutionnaires puis, sous l’Empire, l’introduction du
Code Civil et de Constitutions, ont contribué à cette influence.
2)
Doc. 1 Ils sont situés dans la Confédération du Rhin, en Italie et en
Espagne. Ils correspondent à des pays précédemment évoqués, ou
bien, dans le cas de l’Espagne, à un royaume dans lequel l’occupa-
tion des troupes françaises renforce le sentiment national.
3)
Doc. 1 et 2 En 1815, les frontières françaises sont ramenées à
celles de 1789. La France a perdu le Nord-Ouest de l’Italie, Nice et la
Savoie, ainsi que la Belgique, les Pays-Bas et le Nord de la Prusse.
Les trois États ayant le plus étendu leurs possessions sont : l’Au-
triche, la Russie et la Prusse.
4)
Doc. 1 et 2 Le Grand-duché de Varsovie, créé par Napoléon I
er
en
1807, est démantelé par le Congrès de Vienne. La Prusse et l’Au-
triche intègrent chacune une partie de son territoire, tandis que le
royaume de Pologne est confié à l’empereur de Russie. On assiste
donc à un partage de la Pologne.
5)
Doc. 2 L’Italie et l’Allemagne demeurent morcelées, alors que
l’empire d’Autriche, le royaume des Pays-Bas et la Russie intègrent
des territoires dont les populations aspirent à former une nation
(Hongrois, Belges, Polonais).
6)
Expression écrite et orale En 1811, les frontières de la France
s’étendent jusqu’à la mer Baltique au Nord-Est, et jusqu’à la
région de Rome au Sud. De plus, les États créés par Napoléon I
er
20
© Éditions Belin 2011

et dépendant de la France ont largement entamé les territoires de
l’Autriche, de la Prusse et de la Russie. La défaite française de 1815
et le Congrès de Vienne bouleversent cette donne. La France est
ramenée à ses frontières de 1789 et les puissances victorieuses
étendent leurs territoires, annexant au passage certains États,
comme la Pologne. Cette réorganisation de l’Europe porte toutefois
en elle des foyers d’agitation dans la mesure où elle ne tient aucun
compte des aspirations nationales des peuples.
x x Bilan du dossier
On n’attend pas des élèves qu’ils retiennent le détail des boulever-
sements territoriaux de l’Europe entre 1811 et 1815, mais qu’ils aient
compris quelques idées simples : la fin de la suprématie française,
le renforcement apparent des vainqueurs de Napoléon I
er
, mais
également la contradiction entre la nouvelle géographie politique
de l’Europe et les sentiments nationaux.
COURS 1 [pp. 94-95]
Lib’ : audio « Schubert », cours lu.
Un retour à l’ordre ancien ?
x x Réponses aux questions
Doc. 1 Ce sont ceux de la République : abolition des privilèges du
clergé et de la noblesse, égalité de tous en droit et libertés indivi-
duelles. Le texte y ajoute les valeurs de paix et de fraternité.
Doc. 2 Napoléon I
er
recrée un État polonais, qu’il dote d’une
Constitution et dans lequel il impose le Code Civil. Ces change-
ments, abolis par le dépeçage de la Pologne après le Congrès de
Vienne, sont en partie à l’origine des revendications nationales qui
vont s’exprimer les années suivantes.
Doc. 3 Mme de Staël lui reproche de pressurer les Allemands d’im-
pôts et d’imposer la conscription au pays. Elle dénonce également
la présence de soldats français, ainsi que le népotisme de l’Empe-
reur : il place l’époux de sa sœur et l’un de ses frères à la tête de
deux États de la Confédération du Rhin qu’il a créée.
Doc. 4 La caricature montre des soldats français et l’Empereur lui-
même balayés d’Europe par deux soldats, anglais et prussien. Le
Royaume-Uni et la Prusse mènent effectivement la coalition qui
défait Napoléon I
er
à Waterloo, le 18 juin 1815.
Doc. 5 L’Angleterre, la Prusse, l’Autriche et la Russie. D’autres pays
appartenant à la coalition, la Suède, les Pays-Bas ainsi que plu-
sieurs États allemands ne sont pas représentés.
Doc. 6 L’officier russe accuse les monarques européens d’avoir
rétabli une oppression sur les peuples qu’ils ont privés de toute
liberté. Victor Hugo, pour sa part, met l’accent sur le fait que
le Congrès de Vienne ne tient aucun compte des aspirations
nationales.
EXERCICES [pp. 96-99]
Sur www.libtheque.fr : fiches d’activités.
1
Construire un récit historique
1)
L’entrée des troupes françaises en Savoie entraîne la fuite du roi
de Piémont-Sardaigne, souverain de la Savoie et du comté de Nice.
Sur la caricature, il abandonne sa couronne et son sceptre. Au second
plan, les troupes françaises mettent en déroute son armée. À gauche,
des habitants semblent saluer son départ tandis qu’à l’arrière-plan,
d’autres civils se réjouissent autour d’un arbre de la liberté.
2)
Les Français suppriment le régime seigneurial ainsi que les privi-
lèges des nobles et du clergé.
3)
Comme ailleurs en Europe, les armées révolutionnaires renver-
sent l’Ancien Régime et imposent les principes de 1789 : abolition
des privilèges, introduction des valeurs de liberté et d’égalité
devant la loi.
2
Composer un document
1)
Au moins 15 caricatures correspondent à la consigne, aussi, on
retiendra une sélection, même partielle.
2 et
3)
En fonction des caricatures retenues, on valorisera les
élèves qui ont souligné que les caricaturistes sont le plus sou-
vent français, bien que des artistes étrangers soient également
représentés (allemands, russes, italiens). Certaines caricatures
diabolisent l’Empereur (« Le diable l’emporte ») ou le mettent en
scène dans une danse macabre, d’autres ridiculisent la fragilité
de sa situation après la retraite de Russie (« La justice et la ven-
geance divine poursuivant le crime »), d’autres moquent égale-
ment la situation du « tyran » déchu (« Nicolas Philoctète dans
l’île d’Elbe »). Quel que soit leur choix, les élèves doivent com-
prendre que, pendant la période 1813-1815, au cours de laquelle
Napoléon I
er
subit ses premiers revers graves, les représentations
qui lui sont hostiles se multiplient.
3
Confronter des points de vue
1)
Metternich, principal inspirateur du Congrès de Vienne, est
Chancelier autrichien. Chateaubriand, écrivain français, a dû fuir la
France lors de la Révolution. C’est néanmoins un libéral. Ils écrivent
tous les deux quelques années après le Congrès de Vienne.
2)
La période qu’ils évoquent est celle qui suit immédiatement le
Congrès de Vienne et la restauration des monarques renversés par
les conquêtes révolutionnaires et l’Empire.
3)
Le constat est similaire : l’Europe entière est travaillée par des
mouvements révolutionnaires, au lendemain de la chute de l’Em-
pire. Toutefois, Chateaubriand est favorable aux nouvelles idées
de liberté, tandis que Metternich les considère comme un danger
mortel pour le nouvel ordre politique.
JE RÉVISE / HISTOIRE DES ARTS
« Je révise » disponible en version interactive.
1)
1. B ; 2. D ; 3. A et C.
2)
Empires et royaumes : A. Royaume-Uni ; B. Prusse ; C. Autriche ;
D. Russie ; E. Empire ottoman. Capitales : 1. Londres ; 2. Berlin ; 3.
Vienne ; 4. Moscou ; 5. Constantinople. États à souligner : Russie,
Autriche et Prusse.
3)
1. Guerres de la Révolution et de l’Empire ; 2. Diffusion des
principes de la Révolution ; 3. Poids de la domination française ; 4.
Affirmation du sentiment national ; 5. Un retour à l’ordre ancien ?
Histoire des arts
Goethe déçu par la Révolution française
Goethe est favorable aux idées de la Révolution française et à l’ar-
rivée des armées révolutionnaires parce qu’il pense qu’elles vont
permettre la diffusion des idées des Lumières en Europe. Lorsqu’il
constate que la domination française se caractérise par une « oppres-
sion » et un pillage, il exprime sa déception et son amertume.
21
Chapitre 7 x La france eT L’europe en 1815
© Éditions Belin 2011
1
/
3
100%