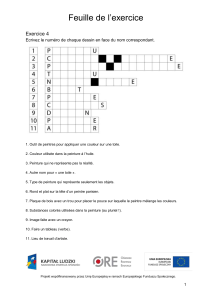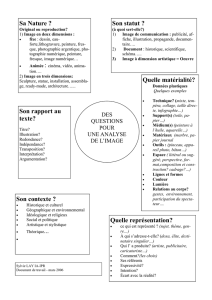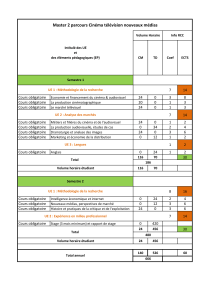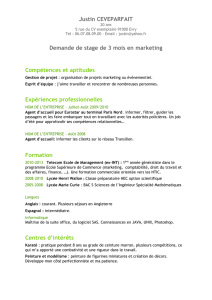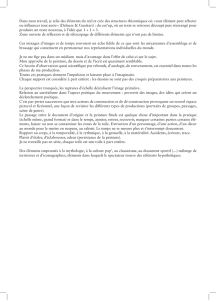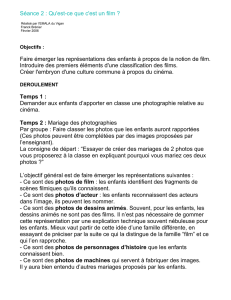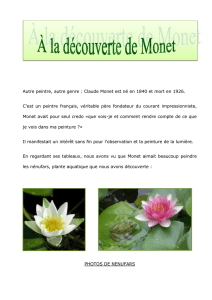Film, Forme, Théorie

Luc Vancheri
Film, Forme, Théorie
L'Harmattan
5-7, me de l'École-Polytechnique
75005 Paris
France
L'Harmattan Hongrie L'Harmattan Italia
Hargita u. 3 Via Bava, 37
1026 Budapest 10214 Torino
HONGRIE ITALlE

Cet essai s'inspire, pour l'essentiel, d'un travail mené à
l'EHESS. Jacques Aumont en a suivi la genèse. Marie-Claire
Ropars, Jacques Gerstenkom, Yves Hersant ont bien voulu lire
l'ensemble achevé.
Viviane Isnard a amicalement assuré la relecture de cet essai.
<QL'Harmattan,2002
ISBN: 2-7475-2909-6

PRESENCES
DE LA THEORIE
Chapitre l
Présences de la théorie
Mais qu'est donc que penser, si la peinture peut en
ouvrir les voies et offrir les moyens, en fournir
l'élément, -seule question, qui nous importe, en
définitive, à toi comme à moi?
Hubert Damisch 1
La théorie est partout écrit Édouard Pommier 2à propos du
portrait en peinture. Dans les traités de peinture et les
correspondances anonymes ou illustres, dans les œuvres des
philosophes et les appréciations élogieuses ou déçues des
commanditaires, dans les disputes théologiques et politiques,
dans les biographies, les journaux ou récits de voyage, dans les
1Hubert Damisch, L'Origine de la Perspective, Paris, Flammarion, 1987,
P 182.
2Édouard Pommier, Théories du portrait, De la Renaissance aux Lumières, Paris,
Gallimard, 1998.
7

FILM, FORME, THEORIE
calculs des peintres et des géomètres. On mesure sans peine ce
que peut avoir de précieux et de difficile la proposition qui
rencontre partout l'indice ou le signe d'une théorie, qui ouvre la
littérature théorique d'une discipline à une plus grande surface
textuelle. En effet, porter la théorie au devant d'une telle
situation, multiplier la nature et les types d'énoncés, c'est
reconnaître l'existence d'une archive subordonnée au système
général de leurs transformations et tenir pour possible, voire
pertinent, le rapprochement et la confrontation de textes relevant
d'origines et de pratiques différentes. C'est en somme se préparer
à découper l'espace discursif que constitue l'inventaire de textes
réunis sous une même volonté de décrire ou de fonder un
certain rapport entre les images et la pensée, les images et le
savoir dont ils sont le dépôt, en même temps que s'appliquer à
rechercher ce qui fait la régularité, la permanence et l'efficacité
d'un ordre discursif. Que dit cette lettre de l'horloger Marin
Etienne ou Estienne de Caen citée par Edouard Pommier, tenté
de la porter au compte de la théorie, sinon ceci qu'elle témoigne
d'un souci, d'une familiarité et d'un goût pour la chose théorique,
et qu'il y a jusque dans son effort pour en mimer les manières le
signe d'un horizon de pensée qu'il convient de réintroduire dans
le champ de nos analyses. L'adverbe de lieu partout, malgré ou à
cause de sa valeur un peu polémique et de son caractère
volontiers elliptique, a donc le mérite de rappeler que toute
administration véritable d'un espace discursif, qu'il soit de
science ou de savoir, débute par la gestion des arguments qui
permettent de recueillir ou d'exclure tel ou tel objet ou
document, telle ou telle proposition. Voilà qui suppose de faire
argument du champ indéfini de relations qui soutiennent une
épistémè non conforme à une histoire déjà pliée à la raison d'un
objet nommé portrait. Voilà qui suggère de dégager l'archive
théorique de ses obligations formelles, de différencier la
solidarité des énoncés de leur égalisation historique, d'opérer en
somme une réforme des critères de validité, de normativité et
d'actualité3 qui participent à la découpe d'un savoir. Ainsi posé,
3Michel Foucault, L'archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, P 81.
8

PRESENCES DE LA THEORIE
le risque d'une dissolution de la spécificité de la pensée
théorique dans cette grande circulation des acteurs paraît
considérablement réduit. Il ne s'agit plus de chercher à définir le
geste discriminant dans l'épaisseur des conduites ou les contours
distincts d'une instance voulue légitime, mais de reconnaître
l'existence de pratiques plus inédites, marginales souvent, isolées
parfois. Au point qu'il y aurait intérêt à faire passer le couteau de
la valeur non plus entre des types d'énoncés, mais entre
l'architecture réticulée d'une archive théorique et la constellation
des pratiques non-écrites, picturales, musicales, littéraires 0u
encore cinématographiques qui ont pu faire vœu ou acte de
théorie. On touche là aux formes mêmes de la pensée, et à la
possibilité d'en surprendre le mouvement en suivant les lignes ou
les plans que tracent les formes qui donnent vie aux œuvres.
C'est que la pensée est sans privilège en regard de l'art, et l'art
sans réserve devant la pensée, ce qui n'exclue ni les passages, ni
les rencontres, ni les interférences4.
Et cependant, même lorsque Eisenstein dit poursuivre la
réflexion par tous les moyens5, et bien qu'il s'agisse de faire
œuvre de théorie au double sens d'une recherche théorique et
d'une pratique poétique conduite selon les voies de la
dialectique, il s'agit encore de maintenir un écart entre les
processus de création et le procès de la raison, en somme entre
des postures intellectuelles dissemblables, la question du génie
n'étant pas la moindre dans la biographie d'Eisenstein. Le film
peut bien être soumis à un modèle de composition théorique -
la spirale logarithmique du Potemkine -, mais c'est à la théorie
4Il y a interférence entre les plans irréductibles de la philosophie
(d'immanence), de l'art (de composition), et de la science (de référence ou de
coordination), quand un artiste crée de pures sensations de concepts, ou de
fonctions, comme on le voit dans les variétés d'art abstrait ou chez Klee.
Mais, ajoute Deleuze, la règle dans tous les cas est que la discipline interférente
doit procéder avec ses propres moyens.
Gilles Deleuze, Félix Guattari, Qu'est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit,
1991, p 204.
5Cf François Albera, Notes sur l'esthétique d'Eisenstein, Lyon, C.I.R.S, 1973,
pp
62-66.
9
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%