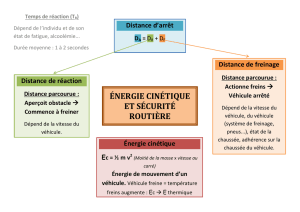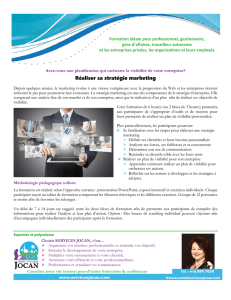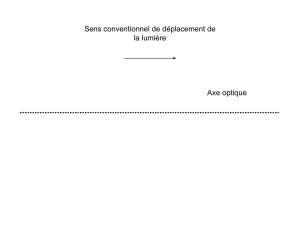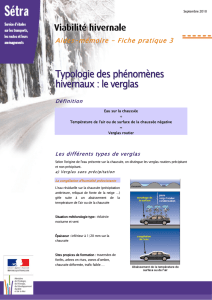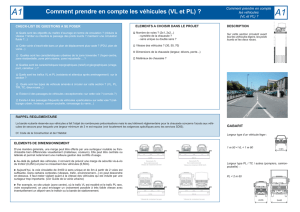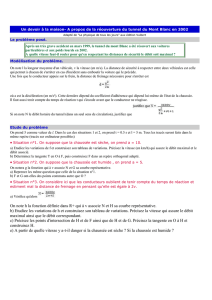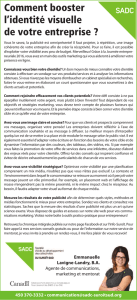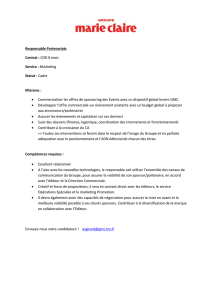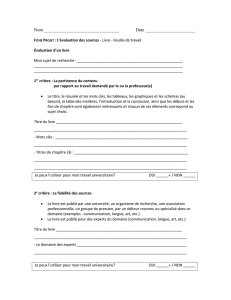Instruction sur les conditions techniques d`aménagement

1
ICTAVRI
Instruction sur les conditions
techniques d’aménagement des
voies rapides interurbaines
Circulaire du … ……….. 2003
SETRA
service d’études
technique
des routes
et autoroute

PROJET
Suivi des modifications successives du document
Document :
examiné le 7 et 8 février 2002 par l’équipe projet
modifié le 15 février 2002 par : le SETRA
transmis pour validation le 18 février 2002 à l’équipe projet
diffusé le : 25 février 2002 au : comité de pilotage
examiné en séance le 6 mars 2002 au comité de pilotage
modifié le 21 mars 2002 par SETRA et J. VIGNERON
transmis le 30 mars 2002 au comité de pilotage pour avis
Examiné Le 19 avril 2002 Par le groupe restreint (DR – JV - SETRA
Discuté le 26 juin 2002 A la DR (en présence de P. GANDIL)
Modifié le 25 juillet 2002 Par JV et LP
Transmis Le 1er août 2002 À DR(AR, IR, CA), DSCR, SETRA, JV
Examiné Le 13 novembre 2002 par DR/IR (courrier et demandes de modifications
Modifié Le 13 janvier 2003 par L. PATTE
Approuvé Le 27 janvier 2003 par J. VIGNERON
Transmis Le 30 janvier 2003 au directeur du SETRA
Les modifications apportées à la version du 25 juillet 2002, suite à la note DR/IR figurent
en bleue et sont soulignées.

PROJET
ICTAVRI - SETRA
3
Sommaire
Préambule .......................................................................................................4
1. Conception générale ...............................................................................5
2. Visibilité ....................................................................................................8
3. Tracé en plan et profil en long.............................................................. 11
4. Profil en travers......................................................................................13
5. Echangeurs ............................................................................................ 17
6. Rétablissements ....................................................................................20
7. Equipements et services à l’usager.....................................................21
8. VRI en relief difficile...............................................................................24
Annexes .....................................................................................................25
Annexe 1 : Visibilité........................................................................................26
Annexe 2 : Valeur du dévers ...........................................................................27
Annexe 3 : Longueur des zones de décélération et d’accélération ...............28
Annexe 4 : Vitesse des poids lourds en rampe ............................................... 29
Table des abréviations.....................................................................................30
Table des notations .........................................................................................30
Bibliographie..................................................................................................31

PROJET
ICTAVRI - SETRA
4
Préambule
Objet du document
L’ICTAVRI traite de la conception des VRI. Ces voies
sont les routes à chaussées séparées, comportant
chacune une seule voie de circulation et des créneaux
de dépassement, isolées de leur environnement et dont
les carrefours sont principalement dénivelés.1 i
Ce document contient les principes généraux et les
règles techniques fondamentales sur ce sujet. Les
études préalables, les règles et recommandations
techniques de détail sont traitées dans les documents
spécialisés.
Des possibilités d’adaptation de certaines règles sont
explicitement prévues, lorsqu’elles s’avèrent
particulièrement contraignantes et que leur application
stricte conduit à empêcher l’amélioration globale de la
situation existante notamment en termes de sécurité.
Domaine d’application
L’ICTAVRI s’applique aux projets d’infrastructure
nouvelle.ii Le retraitement de routes express relève
d’une logique différente de celle de la conception de
voies neuves.
L’ICTAVRI peut permettre de préserver éventuellement
une transformation ultérieure en autoroute interurbaine,
mais les anticipations de la phase future devront être
limitées et justifiées par des analyses économiques. A
ce titre, elle complète l’instruction sur les conditions
techniques d’aménagement des autoroutes de liaison
(ICTAAL) sur la question du phasage transversal.
Elle ne s’applique pas :
aux autres types de routes principales qui font
l’objet du guide Aménagement des routes
principales (ARP) ;
aux autoroutes situées en milieu urbain,
considérées comme des voies rapides urbaines, et
relevant de l’Instruction sur les conditions
techniques d’aménagement des voies rapides
urbaines (ICTAVRU), y compris lorsqu’elles
assurent la continuité ou l’aboutissement d’une VRI.
1 Il est possible dans certains cas particuliers de prévoir d’aménager
les points d’échange en carrefours giratoires (plans).
Structure du document
Ce document comprend huit chapitres.
Le chapitre 1, relatif à la conception générale, décrit la
démarche qui permet d’adapter le projet au contexte
dans lequel il s’inscrit.
Le chapitre 2 énonce les règles de visibilité concernant
tous les aspects de la conception.
Les trois chapitres suivants décrivent les principales
caractéristiques géométriques de la VRI : le tracé (3), le
profil en travers (4), les échangeurs (5).
Les chapitres 6 et 7 donnent les principes de mise en
œuvre des rétablissements d’une part, des
équipements et des services à l’usager d’autre part.
Le chapitres 8 indique les dispositions spécifiques
s’appliquant aux sections de VRI en relief difficile.

PROJET
ICTAVRI - SETRA
5
1. Conception générale
La définition du parti d’aménagement à long terme de la
liaison dépend des objectifs que se fixe le maître
d’ouvrage concernant la nature des fonctions et le
niveau de service assignés à la voie. Cette définition
nécessite d’effectuer le diagnostic de la situation et du
niveau de service existants et de se référer aux
différents avenirs d’évolution possible.
De cette réflexion découle le choix des caractéristiques
générales : le type de route qui détermine l’instruction à
appliquer, la catégorie de route qui conditionne les
principales caractéristiques géométriques du tracé, le
synoptique des échangeurs, des aires et des créneaux
de dépassement et, le cas échéant, la progressivité de
l’aménagement.
Ils requièrent une approche globale et se fondent sur
des études préalables prenant en compte l’ensemble
du contexte géographique, environnemental, les
aspects socio-économiques, les sujétions financières,
les contraintes d’exploitation et d’entretien.
1.1 Fonction de la VRI
La VRI constitue un axe structurant dont le trafic restera
limité. Elle relie principalement à moyenne ou longue
distance, agglomérations ou régions. Le rôle de ces
liaisons justifie un aménagement de qualité – offrant
aux usagers un bon niveau de serviceiii, un bon niveau
de sécurité, une fiabilité des temps de parcours, et un
bon niveau de confort, - alors que le choix d’une
autoroute ne se justifie pas, n’est pas envisagé pour
différentes raisons (contraintes environnementales,
financières, etc.) ou n’est accessible qu’à un horizon
trop éloigné.
La VRI est a priori adaptée à des trafics modérés à
terme (TMJA de l’ordre de 10 000 à 15 000).
1.2 Catégorie
La vitesse d’exploitation d’une VRI est normalement de
110 km/h.
A la différence des autoroutes, on ne retient, pour les
VRI, qu’une seule catégorie – c’est à dire un seul
niveau de caractéristiques de tracé en plan et de profil
en long – adaptée à cette vitesse d’exploitation.
Une section franchissant un site de relief
particulièrement difficile est à considérer comme “ hors
catégorie ” et bénéficie de règles particulières
énoncées au chapitre 8.
Dans tous les cas, l’itinéraire doit être traité de façon
homogène. Les règles d’enchaînement des éléments
du tracé (cf. § 3.1.2.) doivent être tout particulièrement
vérifiées.
1.3 Profil en travers (nombre de
voies)
Chacune des deux chaussées d’une VRI comporte
successivement des tronçons à une voie de circulation
(profil PT1) et à 2 voies de circulation (profil PT2),
hormis certains points singuliers (cf. § 4.3.)
1.3.1 Mode d’exploitation d’une
chaussée à 2 voies
Parmi les chaussées à 2 voies, on distingue :
les créneaux de dépassement, aménagés dans
des zones plates ou de déclivité modérée ;
les voies spéciales pour véhicules lents (VSVL),
implantées dans certaines rampes ou descentes
difficiles (cf. § 3.2.2 & 3.2.3.b), pour limiter la gêne
et le risque liés aux véhicules lents.
Le dépassement des poids lourds sera interdit dans les
créneaux de dépassement, mais autorisé dans les
VSVL.iv
1.3.2 Niveau de service et synoptique
des créneaux
Les conditions de circulation recouvrent principalement
deux aspects : le temps de parcours et la gêne due aux
autres usagers. Elles dépendent surtout du volume et
de la composition du trafic, de la topographie et des
possibilités de dépassement que procurent les
créneaux et, le cas échéant, les VSVL.
L’offre de dépassement sur une section sera
dimensionnée en fonction du niveau de service visé,
mais aussi des conditions de circulation de part et
d’autre de la section, des perspectives d’évolution de la
voie. A titre indicatif, on peut fixer cette offre à 20-25%
du linéaire.
Les créneaux sont judicieusement disposés en tenant
compte :
de la réalisation de VSVL dans des dénivelées
importantes ;
des contraintes exclusives (points d’échanges,
grands ouvrages, courbes à droite difficiles…) ;
des implications techniques et économiques de
leur implantation ;v
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
1
/
35
100%