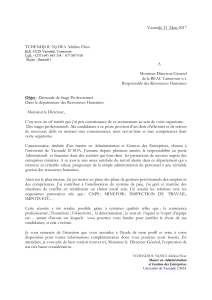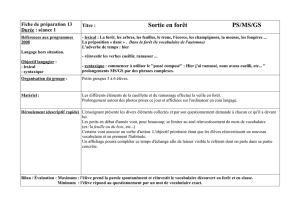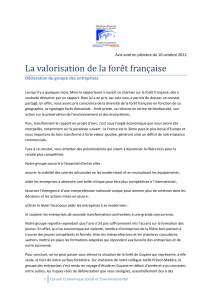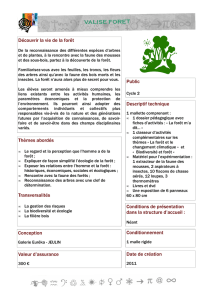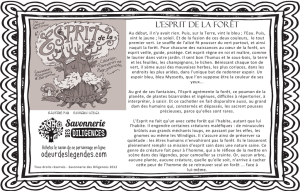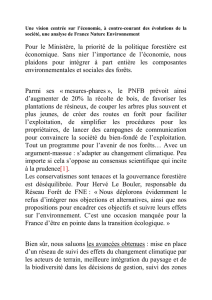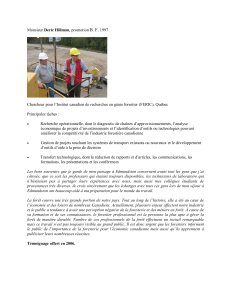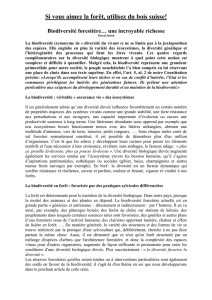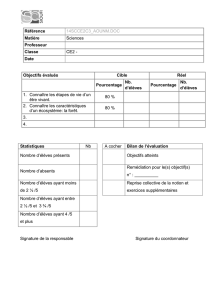Géographie des relation forêt-ville en Afrique centrale

1 Annexe IV
Annexe IV : Synthèse des fiches d'enquêtes villes: Contexte historique,
démographique, culturel et socio-économique
Les données synthétisées dans cette annexe regroupent les données collectées à partir
des fiches d’enquêtes distribuées en (1998-1999) et celles dérivées des recherches
bibliographiques. Il n'a pu être possible de distribuer les fiches dans toutes les villes
mais nous espérons que cet effort de standardisation et de collecte de données sur les
villes sera poursuivi . L’établissement de banque de données standardisé est nécessaire
pour la documentation et une meilleure compréhension des phénomènes de conversion
des forêts et pour faciliter la comparaison entre les différentes villes.
La synthèse des résultats est organisée pour chaque ville suivant le modèle suivant :
l’historique et les traits généraux, la population, l’économie, l’agriculture et la
biodiversité. Les références citées ont été intégrées dans la bibliographie du rapport.
Kinshasa.............................................................................................................................2
Banngui..............................................................................................................................3
Yaoundé.............................................................................................................................4
Libreville............................................................................................................................6
Douala ................................................................................................................................7
Pointe Noire ......................................................................................................................8
Isiro.....................................................................................................................................9
Kisangani .........................................................................................................................10
Ebolowa ...........................................................................................................................10
Franceville .......................................................................................................................12
Yokadouma .....................................................................................................................13
Kindu ...............................................................................................................................15
Mbandaka........................................................................................................................15
Lomela..............................................................................................................................16
Gamba ..............................................................................................................................18
Bitam ...............................................................................................................................19
Bayanga............................................................................................................................20
Makokou..........................................................................................................................21
Oyem ...............................................................................................................................22

2 Annexe IV
1 Kinshasa
Kinshasa est la plus grande ville d’Afrique centrale avec plus de 3 millions d'habitants, se
distribuant sur 24 communes. La ville fût fondée au environ de 1881 (Léopoldville) à
l’emplacement de Stanley Pool, initialement le point de départ de nombreuses
explorations. Bien qu'initialement entourée par des forêts, la végétation dominante
autour de Kinshasa est en 1990 une mosaïque de formations herbeuses et arbustives
très dégradées avec un espace urbain et agricole qui s’étale sur plus de 250 km2
(Dubresson et al,1994). Les quartiers pauvres sont très mal desservis par les moyens
de transport et les routes sont utilisables uniquement par les piétons. Cinq ménages sur
six n’ont pas accès à l’eau et six sur sept à l’électricité. La population souffre de
plusieurs décades d'insécurité politique et économique.
Population
En 1919, la population de Kinshasa n'était que de 14.000 habitants, entre 1954 et
1988 la population de Kinshasa augmenta de 6.8 % en moyenne (Goossens, 1996). La
ville de Kinshasa est de loin la plus grande ville d'Afrique centrale avec plus de 3 millions
d’habitants, sa population est très mélangée mais avec une dominance de population
originaire la région de Bandundu (70%), et de Bakongos (30%) (Houyoux et al, 1986).
Economie
Depuis l'installation de la crise en 1970, l’économie de Kinshasa est en déclin continu et
repose essentiellement sur le secteur informel. La crise débuta en 1974 avec la chutte
du prix du cuivre et celui du pétrole (Shapiro et Tollens 1992). Le produit national brut
annuel est en moyenne de (-2%) depuis 1965. Avec la crise, l’urbanisation c’est
notablement ralentie (Dubresson et al, 1994), une importante détérioration du niveau de
vie s’observe depuis 1985 (pers. Com., Kakolongo Mujika- Fiche d’enquête Kinshasa,
1998).
La pêche artisanale est encore une activité très importante, le poisson étant la source
de protéine animale la moins chère. La zone de pêche couvre Malulku, Ngamanzo,
Kiakolé, Masina, Limete, Ndolo, Kinga, Brakana, et Kinsuka.
Agriculture
L’agriculture urbaine et périurbaine permet à beaucoup de famille un minimum vital en
période de crise. La durée moyenne de la jachère est en forte baisse de l’ordre de 3-4
ans contre 10 ans et plus dans le passé. Les surfaces défrichées ne dépassent pas 0.25
ha. Les cultures les plus proches de la ville sont de type maraîchère dans un rayon de
moins de 20km, puis de riz et de manioc dans un rayon de 50km, et de manioc pour un
rayon de plus de 100 km. La consommation mensuelle de manioc par habitant à
Kinshasa est de l’ordre de 4.5 kg par habitant (contre 13 kg en zone rurale). L’essentiel

3 Annexe IV
de la production de manioc provient de la région du bas zaïre (100 à 300km) et du
Bandundu (200 à 700 km) (Goossens, 1996).
Energie
Bien que l’électricité en provenance du barrage d’Inga alimente Kinshasa. c’est une
énergie chère et mal distribuées et les kinois ont recours essentiellement au charbon de
bois et au bois pour leur besoins journaliers. Le bois de chauffe est exploité dans un
rayon de 10 à 30 km autour de Kinshasa et notamment de Kassangulu à 28km de
Kinshasa, mais en raison de la surexploitation et de la demande importante, la ville est
approvisionnée en charbon de bois par des camions provenant de régions plus éloignée.
Biodiversité
La réserve naturelle la plus proche se trouve à 60 km de la ville, crée en 1972 elle est
très dégradée (Kakolongo Mujika, fiche Kinshasa, 1998).
2 Bangui
Bangui, capitale de la République Centrafricaine a été crée en 1893, sur la rive du fleuve
Oubangui, faisant face à la ville de Zongo en République Démocratique du Congo. La ville
c’est agrandie rapidement entre 1966 et 1971 (Prioul, 1971). Le noyau urbain de
Bangui se réduit à 6.5 km2, et le réseau urbain lâche occupe 55 km2 (Prioul, 1971)
Population
La population de Bangui était de 7,000 habitants en 1910 et d’environ 280,000 en
1975, elle est estimée à 600,000 en 1999. Le taux d'accroissement de la population
est de l’ordre de 4% depuis 1975 (Vickos et al, 1997). Bangui, comme les autres
capitales d’Afrique centrale est un lieu de brassage de la population important, plus de
13 ethnies se partagent l'espace. Les populations autochtones de la région sont les
Ngaka et les Mbati, ils sont originaires de la forêt et pratique la culture itinérante, la
majorité des autres ethnies sont originaires des savanes et de la République
Démocratique du Congo (Vickos et al, 1997 ).
Economie
Comme Kinshasa, l’économie de Bangui repose sur le secteur informel.
Pendant longtemps Bangui a été « sous-peuplée » et la rareté des hommes fut un
handicap sérieux pour la croissance de la ville, notamment pour l’organisation de son
système de transport et pour l’approvisionnement vivrier des résidents (Prioul, 1971).
L’agriculture intra et périurbaine est une partie intégrante du phénomène géographique
de Bangui, Prioul parle d’un système agro-urbain (Prioul, 1971).

4 Annexe IV
Agriculture
L’agriculture périurbaine autour de Bangui est importante, déjà dans les années soixante
dix, l’extension des champs était en passe de devenir régionale (Prioul, 1971). Vers
1950, l’administration de Bangui poussa la population à s’installer à 5 kilomètres du
centre ville, sur une demi couronne de terres plus sèches pour préserver les terres
marécageuses du centre ville à l’agriculture (Prioul,1971).
Le déboisement a été estimé à 1,200 ha entre 1982 et 1989 et 2,500 ha entre 1989
et 1992 (PARN, Volet Agroforestier, Résultats préliminaire).
Energie
De nombreux villages à la périphérie de Bangui approvisionnent la ville en bois de
chauffe, le revenu mensuel tiré de la commercialisation du bois est élevé, de l’ordre de
160.000 CFA soit 1.9 millions de CFA par an.
La consommation de bois s’élève à 170.000 tonnes en 1980 et 290.000 tonnes en
1994). La quantité de charbon de bois livrée sur le marché de Bangui était de l’ordre de
4,557 tonnes en 1994 contre 2,500 tonnes en 1980 (Vickos et al,1997). Il est estimé
que 140 tonnes de charbon de bois entre dans Bangui par an ( PARN, rapport OXFAM-
OCSD- non publié)
Biodiversité
(pas d'informations)
3 Yaoundé
Yaoundé est la capitale du Cameroun depuis 1940. Elle s'est développée autour d’un
ancien poste d'exploration établi sous la colonisation allemande vers (1884-1914), ce
poste fût choisi en raison de sa richesse en gibier (Laburthe-Tolra, 1981). La ville se
situe en zone de forêt dense humide à une altitude de 760 m, à la porte du domaine des
savanes guinéennes, son climat est de type équatorial humide. Parmi les grandes villes,
Yaoundé montre un des patterns de dégradation les plus distincts sur les images AVHRR,
avec une auréole de dégradation (savane) qui s’étend sur environ un rayon de 10
kilomètres de diamètre, correspondant au tissus urbain puis une seconde auréole de
dégradation plus fragmentée entourant la ville proprement dite correspondant à la classe
de complexe rural et forêt secondaire (aussi appelé forêt dégradée).
Population
La population est d’origine Beti, provenant de la zone de savane, aujourd’hui la
population de Yaoundé elle est très hétérogène et elle a grandit de 107% (soit 7.1%
annuel) entre 1970 et 1985 (Sunderlin, 1998). La zone de Yaoundé présente aussi une
des densités de population les plus élevées de la région forestière du Cameroun pouvant
atteindre 240 habitant par km2 (ONAEDF, 1992). En raison de l’exode rural important,
les villages entourant Yaoundé sont phagocytés par la ville, le village de Ngoulemakong
qui a vue sa population passée de 820 en 1966 à plus de 6000 en 1987 (Sunderlin et
al, 1998). Le taux d’accroissement de la population du à l’immigration entre 1957 et

5 Annexe IV
1969 à été estimé 5.8%, les immigrés proviennent essentiellement de la région de la
Mefou (Nord-Est de Yaoundé) et des autres départements du Centre-sud. Cet exode a
un impact négatif sur les communautés rurales, qui voit leur population vieillir, et le
niveau de vie se dégradé. L’exode apparaît donc comme un facteur de régression
économique et social dans les campagnes.
Economie
En 1985, le revenu moyen des population de Yaoundé était de l’ordre de 400,00 CFA
contre 200,000 CFA en zone rurale (Tiki Manga et Weise, 1994). Yaoundé est une ville
administrative, commerciale et agricole. Yaoundé est aussi la capitale de la région
cacaoyère, avec l’essentiel de la production annuelle du pays provenant de la région. La
culture du cacao fût introduite en 1858 par des missionnaires baptistes fuyant le Sao
Tomé, tout de suite adoptée par l'élite Douala, de larges plantations furent installées
long des rivières Mongo, Wuri et Dibamba vers 1907 (Monga, 1996). C'est seulement
vers 1910 que le gouvernement mis en place une politique de promotion de la cacao
culture de petite taille (1 à 2 ha), mais cette tentative ne pris essor dans la région du
Centre Sud (pays Beti) qu'après la première guerre mondiale. Le début de la
dégradation forestière dû à la culture de rente remonte donc à cette époque.
L'importance historique du secteur agricole dans le sud et centre du Cameroun est donc
un facteur important de modification des paysages forestiers. Les prises de décision
politiques faite au début de ce siècle dans le domaine agricole et industriel se reflètent
encore dans l’organisation spatiale des paysages forestiers d’Afrique centrale.
Agriculture
Avant 1940, la famille Beti était moins sédentaire et les pratiques agricoles incluaient un
cycle de culture en savane (zone d’origine des Beti) et un cycle en forêt. Mais le
développement des cultures de rentes entraîna une sédentarisation et introduisit une
division du travail, les femmes se concentrant sur les cultures vivrièreset les hommes sur
les cultures de rente (Eckert, 1996). Les larges superficies de forêts dégradées autour
de Yaoundé sont liées à la fois aux cultures vivrières et de rente. La durée de la jachère
est très courte de l'ordre de 3.9 ans autour de Yaoundé (IITA, 1996)
Le taux de déforestation annuel pour le Cameroun est estimé à 0.6 % par la FAO
(période 1980-90). Mais une étude récente a permis de vérifier que les taux de
déforestation autour de Yaoundé peuvent être jusqu’a 2 fois plus élevés que ce de la
FAO autour de Yaoundé et que l’expansion urbaine c’est ralentie pendant la période de
crise (après 1986) comparé à pré-crise, alors que l’expansion de l’agriculture sur la forêt
a été plus rapide pendant la crise (Laporte, 1999).
Les villages environnant sont spécialisés dans les cultures vivrières et maraîchères et la
production du bois de chauffe, bien que le revenu provenant du bois de chauffe soit en
augmentation constante, l'agriculture est le principal revenu pour la plus part des villages
autour de Yaoundé, celui des cultures pérennes (cacao) est secondaire, les villages les
plus riches étant ceux dont les revenus sont tirés à la fois des cultures vivrières et
pérennes, les villages les plus pauvres tirent essentiellement leurs revenus de la vente du
bois de chauffe (Demedou,1997). Il est possible que le bois de chauffe comme dans les
environs de Bangui soit le source de revenu importante pour les immigrés, une lutte
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%