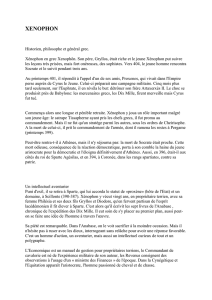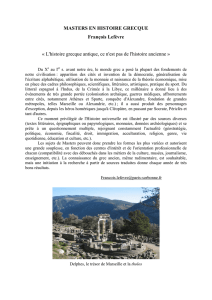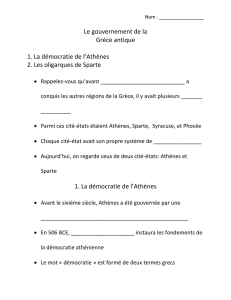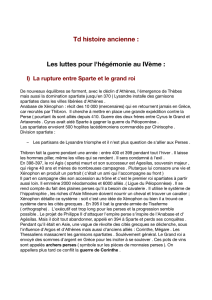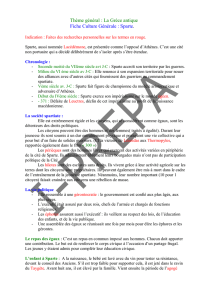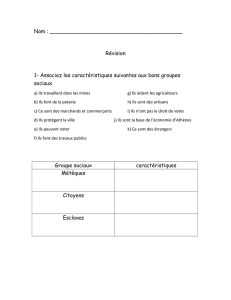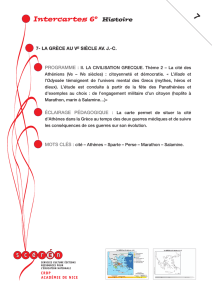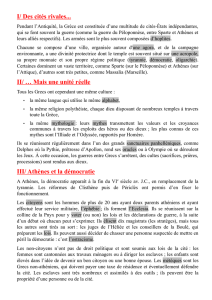T14 - L`Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée

HISTOIRE DE LA GRÈCE
depuis les temps les plus reculés jusqu’à la fin de la génération
contemporaine d’Alexandre Le Grand
George Grote
traduction d’Alfred Sadous
QUATORZIÈME VOLUME

CHAPITRE I — DEPUIS LA BATAILLE DE KNIDOS JUSQU’À LA
RECONSTRUCTION DES LONGS MURS A ATHÈNES.
Après avoir, dans mon dernier chapitre, amené la série des événements
asiatiques jusqu’à la bataille de Knidos, au commencement d’août 394 avant J.-
C., époque à laquelle la guerre était déjà allumée de l’autre côté de la mer Ægée,
dans la Grèce propre, — je reprends maintenant le fil des événements à une
période un peu antérieure ; pour montrer de quelle manière commença cette
guerre que je viens de mentionner, appelée communément la guerre
corinthienne.
A l’avènement d’Agésilas au trône, en 398 avant J.-C., le pouvoir de Sparte dans
toute la Grèce, depuis la Laconie jusqu’à la Thessalia, était plus grand qu’il
n’avait jamais été et plus grand que celui qui, dans aucun temps, avait
appartenu à un État grec quelconque. Elle avait supporté le fardeau de la longue
guerre contre Athènes dans une proportion bien moindre que ses alliés ; quant à
ses fruits, elle les avait exclusivement recueillis pour elle-même. En
conséquence, il régnait parmi les alliés un mécontentement général, que Thêbes
aussi bien que Corinthe manifesta en refusant de prendre part aux expéditions
récentes, soit de Pausanias contre Thrasyboulos et les exilés athéniens de
Peiræeus, — soit d’Agis contre les Éleiens, — soit d’Agésilas contre les Perses en
Asie Mineure. Les Éleiens furent complètement humiliés par les invasions d’Agis.
Toutes les autres cités du Péloponnèse, par crainte, par ancienne habitude et par
la nature de leurs gouvernements oligarchiques qui penchaient vers Sparte pour
trouver un appui, obéissaient à son autorité, — à la seule exception d’Argos, qui
restait, comme auparavant, neutre et tranquille, bien que nourrissant des
sentiments hostiles. Athènes était une simple unité dans le catalogue des alliés
spartiates, fournissant comme les autres son contingent, que devait commander
le xenagos — ou officier envoyé de Sparte, dans le dessein spécial de
commander ces contingents étrangers.
Dans les régions septentrionales de la Grèce, le progrès de la puissance spartiate
est encore plus remarquable. Si l’on remonte à l’année 419 avant J.-C. (environ
deux ans après la paix de Nikias), Sparte avait été si peu en état de protéger sa
colonie d’Hêrakleia, dans le pays de Trachis, sur le golfe Maliaque, près du
détroit des Thermopylæ, que les Bœôtiens furent obligés d’y envoyer une
garnison, afin d’empêcher qu’elle ne tombât entre les mains d’Athènes. Ils
allèrent même jusqu’à renvoyer l’harmoste lacédæmonien1. Dans l’hiver de 409-
408 avant J.-C., il était survenu à Hêrakleia un autre désastre, dans lequel
l’harmoste lacédæmonien fut tué2. Mais vers 399 avant J.-C., nous trouvons
Sparte exerçant un ascendant énergique à Hêrakleia et même faisant de cette
ville un poste central destiné a. tenir en respect le peuple du voisinage du mont
Œta et d’une partie de la Thessalia. Herippidas le Lacédæmonien y fut envoyé ;
afin qu’il réprimât quelques mouvements factieux, avec des forces suffisantes
pour intimider l’assemblée publique, s’emparer du parti hostile dans la ville et en
mettre les membres à mort, au nombre de cinq cents, en dehors de- portes3.
Portant ses armes plus loin contre les Œtæens et les Trachiniens du voisinage,
1 Thucydide, V, 52.
2 Xénophon, Helléniques, I, 2, 18.
3 Diodore, XIV, 38 ; Polyen, II, 21.

qui avaient été longtemps en désaccord avec les colons laconiens à Hêrakleia, il
les chassa de leurs demeures, et les força d’émigrer en Thessalia tr~r leurs
femmes et leurs enfants1. Par lez les Lacédæmoniens furent en état d’étendre
leur influence dans des parties de la Thessalia et de mettre un harmoste avec
une garnison dans Pharsalos, s’appuyant sur Hêrakleia comme sur une base, —
ville qui devint ainsi une position d’une importance extraordinaire pour leur
domination sur les contrées septentrionales.
Avec le pouvoir réel de Sparte ainsi considérablement augmenté sur terre, outre
son vaste empire sur mer, qui grossissait ses revenus par de riches tributs, — et
dans des cités qui non seulement l’avaient longtemps reconnue comme chef,
mais qui n’en avaient jamais reconnu d’autre, — il fallait un stimulant
inaccoutumé pour faire naître une formidable combinaison hostile contre elle,
nonobstant un développement considérable de désaffection et d’antipathie. Le
stimulant vint de Perse, dont les trésors avaient auparavant fourni à Sparte elle-
même le moyen de réduire Athènes. La nouvelle qu’une flotte formidable
s’armait en Phénicie, nouvelle qui avait inspiré l’expédition d’Agésilas dans le
printemps de 396 avant J.-C., fut sans doute mise en circulation et apprise avec
satisfaction par les cités grecques hostiles à Sparte ; et le refus de Thèbes, de
Corinthe et d’Athènes de prendre du service sous ce prince, — aggravé dans le
cas des Thêbains par une offense positive qu’ils lui firent à l’occasion de son
sacrifice à Aulis, — était assez pour avertir Sparte des tendances et des
sentiments dangereux dont elle était entourée dans son voisinage immédiat.
Ce fut sur ces tendances que les instigations et les promesses positives de la
Perse furent dirigées dans le courant de l’année suivante (395 av. J.-C.) ; et non
seulement des promesses, mais des secours pécuniaires, avec la nouvelle que la
guerre maritime venait de se rallumer et menaçait la domination insulaire de
Sparte. Tithraustês, le nouveau satrape, qui avait mis Tissaphernês à mort et lui
avait succédé, n’eut pas plus tût conclu l’armistice mentionné plus haut et décidé
Agésilas à emmener son armée dans la satrapie de Pharnabazos qu’il employa
des mesures actives pour allumer la guerre en Grèce contre Sparte, afin qu’elle
fût réduite à la nécessité de rappeler Agésilas d’Asie. Il envoya en Grèce un
Rhodien nommé Timokratês comme ambassadeur dans les villes les plus hostiles
aux Lacédæmoniens, avec une somme de cinquante talents2, lui ordonnant
d’employer cet argent à gagner les principaux personnages dans ces villes et
d’échanger des serments solennels d’alliance et de secours avec la Perse, pour
une hostilité commune contre Sparte. L’île de Rhodes, qui venait de se révolter
contre la domination spartiate, avait reçu Konôn avec la flotte persane (comme je
l’ai mentionné dans le dernier chapitre), de sorte que probablement le député rhodien
était en mission auprès de Tithraustês au sujet de ses compatriotes. C’était un
député propre à cette mission, en ce qu’il avait un vif intérêt à créer de
nouveaux ennemis à Sparte, et qu’il était ardent à faire naître chez les Thêbains
et les Corinthiens le même esprit qui avait amené la révolte de Rhodes. J’ai déjà
1 Diodore, XIV, 38 : cf. XIV, 81.
2 Xénophon, Helléniques, III, 5, 1.
Timokratês reçoit l’ordre de donner l’argent, non pas toutefois absolument, mais seulement à une
certaine condition, dans le cas où il trouverait que cette condition pourrait être remplie, c’est-à-dire
si en le donnant il pourrait obtenir de divers Grecs de conséquence des assurances et des garanties
suffisantes qu’ils soulèveraient une guerre contre Sparte. Comme c’était une chose plus ou moins
douteuse, Timokratês a l’ordre d’essayer de donner de l’argent dans ce dessein. Bien que
l’explication de πειράσθαι le rattache à διδόναι, le sens du mot appartient plus proprement à
έξοίσειν, — qui désigne le dessein à accomplir.

signalé l’effet que produisit cette révolte en alarmant et en exaspérant les
Spartiates ; et l’on peut à bon droit présumer que son effet de l’autre côte, en
encourageant leurs ennemis grecs, fut considérable. Timokratês visita Thèbes,
Corinthe et Argos, et distribua ses fonds. Il conclut des engagements, au nom du
satrape, avec différents personnages de conséquence dans chacune, en les
mettant en communication mutuelle, — c’étaient Ismenias, Androkleidas et
autres à Thèbes ; — Timolaos et Polyanthês à Corinthe ; — Kylôn et autres à
Argos. Il paraît qu’il ne visita pas Athènes ; du moins Xénophon dit
expressément qu’il n’y entra rien de son argent. L’influence de cette mission, —
jointe, nous devons nous le rappeler, à la guerre navale renouvelée sur la côte
d’Asie et à la promesse d’une flotte persane qui serait opposée à celle de Sparte,
— se fit bientôt sentir dans la manifestation plus prononcée de sentiments anti-
laconiens dans ces diverses cités, et dans le commencement de tentatives faites
pour établir une alliance entre elles1.
Avec cette partialité en faveur des Lacédœmoniens qui règne dans ses Hellenica,
Xénophon représente la guerre que Sparte va avoir, à soutenir comme amenée
presque uniquement par les présents que fit la Perse aux différents personnages
dans les diverses cités. J’ai déjà dit dans plus d’une occasion que la moyenne de
la moralité publique des politiques grecs individuellement, à Sparte et à Athènes,
et dans les autres villes, n’était pas telle qu’elle exclût la corruption personnelle ;
qu’il fallait une moralité plus haute que la moyenne pour résister à cette
tentation ; — et une moralité considérablement plus haute que cette moyenne
pour y résister systématiquement et pendant une longue existence, comme le
firent Nikias et Periklês. Il ne serait donc pas surprenant qu’Ismenias et les
autres eussent reçu des présents dans les circonstances mentionnées plus haut.
Mais il parait extrêmement improbable que l’argent donné par Timokratês ait pu
être un cadeau destiné à corrompre, c’est-à-dire donné en secret et pour l’usage
particulier de ces chefs. Il était fourni pour favoriser un certain objet public qui
ne pouvait être accompli sans de gros déboursés ; il était analogue à cette
somme de trente talents que (comme Xénophon lui-même nous le dit) Tithraustês
venait de donner à Agésilas, comme incitation à emmener son armée dans la
satrapie de Pharnabazos — non comme présent pour la bourse particulière du roi
spartiate, mais comme contribution pour les besoins de l’armée2 —, ou à celle
que le satrape Tiribazos donna plus tard à Antalkidas3, également pour des
objets publics. Xénophon affirme qu’Ismenias et les autres, après avoir reçu ces
présents de Timokratês, accusèrent les Lacédæmoniens et les rendirent odieux,
chacun dans sa cité respective4. Mais il est certain, d’après son exposé même,
que la haine contre eux existait dans ces cités avant l’arrivée de Timokratês. A
Argos, cette haine était de vieille date ; à Corinthe et à Thèbes, bien qu’elle ne
fût allumée que depuis la fin de la guerre, elle n’était pas moins prononcée. De
plus, Xénophon lui-même nous apprend que les Athéniens, bien qu’ils ne
reçussent rien de cet argent5, étaient tout aussi prêts à faire la guerre que les
autres villes. Si donc nous admettons son assertion comme un fait réel, que
1 Xénophon, Helléniques, III, 5, 2 ; Pausanias, III, 9, 4 ; Plutarque, Artaxerxés, c. 20.
2 Xénophon, Helléniques, III, 4, 26.
3 Xénophon, Helléniques, IV, 8, 16.
4 Xénophon, Helléniques, III, 5, 2.
5 Xénophon, Helléniques, III, 5, 2.
Pausanias (III, 9, 4) nomme quelques Athéniens qui auraient reçu une partie de l’argent. De même
Plutarque, en termes généraux (Agésilas, c. 15).
Diodore ne dit rien ni de la mission, ni des présents de Timokratês.

Timokratês fit des présents secrets à divers politiques de conséquence, ce qui
n’est nullement improbable, — nous devons différer de l’interprétation qu’il
donne à ce fait, en le présentant d’une manière saillante comme étant la cause
de la guerre. Ce que ces principaux personnages trouvaient difficile à faire naître,
ce n’était pas la haine de Sparte, mais la confiance et le courage pour braver la
puissance de cet État. Et dans ce dessein la mission de Timokratês était une aide
précieuse, en ce qu’elle apportait des assurances de concours et d’appui persans
contre Sparte. Il a dû être présenté publiquement, soit devant le peuple, devant
le sénat, soit au moins devant le grand corps du parti anti-laconien dans chaque
cité. Et l’argent qu’il apportait avec lui, bien qu’une portion en ait pu être donnée
en présents à des particuliers, était pour ce parti la garantie la meilleure de la
sincérité du satrape.
Quelles qu’aient pu être les négociations en train entre les cités que visita
Timokratês, aucune union ne les avait rapprochées, quand la guerre, allumée par
un accident, éclata comme Guerre bœôtienne1, entre Thèbes et Sparte
séparément. Entre les Lokriens Opontiens et les Phokiens, au nord de la Bœôtia,
il y avait une bande de terre frontière, objet de contestation ; à ce sujet, les
Phokiens, imputant aux Lokriens d’injustes empiétements, envahirent leur
territoire. Les Lokriens, alliés de Thèbes, implorèrent sa protection ; sur cette
prière, un corps de Bœôtiens envahit la Phokis ; tandis que les Phokiens, de leur
côté, s’adressèrent à Lacédæmone, invoquant son aide contre Thèbes2. Les
Lacédæmoniens (dit Xénophon) furent charmés d’avoir un prétexte pour faire la
guerre aux Thêbains, — car ils avaient été longtemps fâchés contre eux pour
plusieurs motifs différents. Ils crurent que le moment actuel était un temps
excellent pour marcher contre eux et abattre leur insolence, vu qu’Agésilas était
en plein succès en Asie et qu’il n’y avait pas d’autre guerre qui les gênât en
Grèce3. Les divers motifs sur lesquels les Lacédæmoniens fondaient leur
mécontentement contre Thèbes commencent à une époque qui suit
immédiatement la fin de la guerre contre Athènes, et le sentiment était à la fois
établi et véhément. Ce furent eux qui, à ce moment, commencèrent la guerre
bœôtienne, et non les Thêbains, ni les présents apportés par Timokratês.
1 Diodore, XIV, 81).
2 Xénophon, (Helléniques, III, 5, 3) dit, — et Pausanias (III, 9, 4) le suit que les chefs thêbains,
désirant faire la guerre à Sparte, et sachant que Sparte ne la commencerait pas, excitèrent à
dessein les Lokriens à empiéter sur cette frontière contestée, afin d’irriter les Phokiens et d’allumer
ainsi une guerre. Je rejette sans hésitation cette version, qui, je le crois, a sa source dans la
tendance de Xénophon à favoriser les Lacédæmoniens et à haïr les Thêbains, et je pense que la
lutte entre les Lokriens et les Phokiens, aussi bien que celle entre les Phokiens et les Thébains,
éclata sans aucun dessein de la part de ces derniers de provoquer Sparte. C’est ainsi que Diodore
le raconte par rapport à la guerre entre les Phokiens et les Thébains ; car il ne dit rien au sujet des
Lokriens (XIV, 81).
Les événements subséquents, tels que les raconte Xénophon lui-même, prouvent que les
Spartiates étaient non seulement prêts sous le rapport des forces, mais disposés sous celui de la
volonté à faire la guerre aux Thêbains, tandis que les derniers ne l’étaient pas du tout à la faire à
Sparte. Ils n’avaient pas un seul allié ; car leur demande à Athènes, douteuse en elle-même, ne fut
faite qu’après que Sparte leur avait déclaré la guerre.
3 Xénophon, Helléniques, III, 5, 5. Cf. VII, I, 34.
La description que fait ici Xénophon lui-même de l’ancienne conduite et du sentiment établi entre
Sparte et Thèbes réfute son allégation, à savoir que ce furent les présents apportés par Timokratês
aux principaux Thêbains qui allumèrent pour la première fois la haine contre Sparte, et elle prouve
en outre que Sparte n’eut pas besoin des manœuvres détournées des Thêbains pour avoir un
prétexte de faire la guerre.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
1
/
179
100%