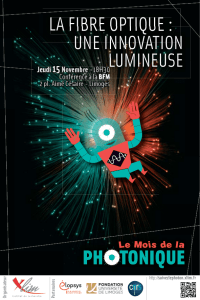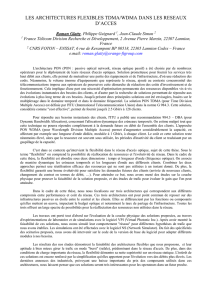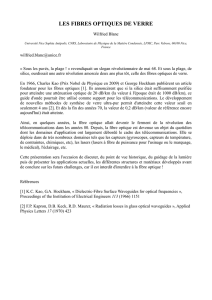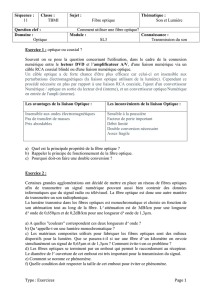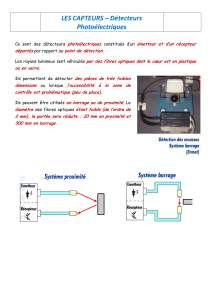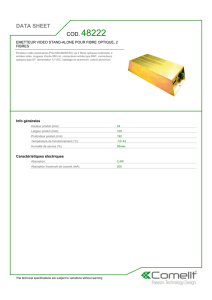Note de Cadrage Technique

ASSISTANCE POUR L’ELABORATION
D’UNE STRATEGIE NUMERIQUE
Note de cadrage
- Aspects technologiques -
2012

2012 – Note de cadrage technique 2
Résumé du document
Au-delà de la disponibilité du haut débit pour tous qui a fait l’objet de nombreuses actions au
cours des dernières années, l’évolution des usages du numérique conduit à délivrer le très haut
débit (> 20 Mb/s) et l’ultra haut débit (100 Mb/s) aux différentes catégories d’utilisateurs. Le
présent document a pour objectif de passer en revue les différents aspects relatifs à ce
domaine et à tracer les lignes directrices d’une approche structurée permettant à la collectivité
d’opérer les choix en toute connaissance de cause.
La hiérarchie des réseaux de communications électroniques permettant de délivrer les signaux
correspondant à ces services comprend les réseaux à longue distance, les réseaux de collecte et
les réseaux d’accès ou de desserte. Les enjeux économiques majeurs étant principalement
concentrés sur cette boucle locale, il convient de comparer les technologies disponibles et de
déterminer l’architecture du réseau cible satisfaisant les objectifs ; en effet les technologies
actuelles sont insuffisantes, sauf dans le cas des réseaux câblés lorsqu’ils sont présents dans les
grandes agglomérations comme celle d’Annemasse. De plus, il convient de souligner que les
contraintes économiques et opérationnelles peuvent conduire à identifier des étapes
intermédiaires permettant une évolution progressive vers cette cible. Parmi les technologies
envisageables, la fibre optique, dans ses différentes déclinaisons FTTX, est reconnue par les
experts comme la plus appropriée, même si des solutions radio peuvent être considérées
comme outsiders dans certaines situations, à condition que les expérimentations en cours
confirment les attentes.
Au-delà du choix technologique, le document aborde la problématique de la mutualisation de
ces infrastructures et présente un certain nombre de recommandations sur l’architecture et le
dimensionnement de ces installations, notamment dans le cadre de programmes
d’aménagement, de réhabilitation ou d’enfouissement de réseaux. Une attention particulière est
portée sur le réseau terminal sur le domaine privé, surtout lorsqu’il s’agit d’immeubles collectifs
existants ou neufs pour lesquels les promoteurs, co-propriétés ou bailleurs sociaux doivent être
impliqués.
Enfin, on présente les techniques récentes de pose de câbles qui permettent d’alléger les coûts
de construction de ces infrastructures. En effet, au-delà des techniques traditionnelles, la mise
en œuvre de génie civil allégé ou la mise en place de câbles dans les réseaux d’assainissement
non visitables sont tout à fait attractives, même si elles ne sont pas applicables dans tous les
cas.

2012 – Note de cadrage technique 3
Sommaire
I.
Introduction ........................................................................................................ 4
II.
Hiérarchie des réseaux de communications électroniques .............................. 4
II-1 Hiérarchie et architectures de réseaux ......................................................... 4
II-2 Principales technologies ............................................................................... 5
III.
Les architectures FTTX ..................................................................................... 6
III-1 Topologies FTTH ..................................................................................... 6
III-2 Topologies intermédiaires FTTX ............................................................. 8
IV.
Comparaison des technologies d’accès .......................................................... 10
IV-1 Comparaison débit / portée ........................................................................ 10
IV-2 Influence du taux de partage ..................................................................... 10
IV-3 Positionnement respectif et complémentarités .......................................... 11
V.
La mutualisation des réseaux d’accès ............................................................... 12
V-1 La mutualisation des infrastructures .......................................................... 12
V-2 La problématique des architectures partagées ........................................... 12
V.2-a Généralités .................................................................................................. 12
V.2-b Le cas des réseaux câblés............................................................................. 13
V.2-c Le cas des réseaux FTTH .............................................................................. 13
V.2-d Options de mutualisation des PON ................................................................. 13
VI.
Conséquences et recommandations générales .............................................. 15
VI-1 Stratégies de conception ............................................................................ 15
VI.1-a Réseau de collecte ....................................................................................... 15
VI.1-b Réseau d’accès ............................................................................................ 15
VI-2 Modélisation de l’infrastructure d’accès ..................................................... 16
VI-3 Règles de dimensionnement du réseau d’accès .......................................... 17
VI-4 Problématique du réseau terminal sur le domaine privé ............................ 19
VII.
Techniques de pose de câbles ........................................................................ 20
VII-1 Techniques traditionnelles ................................................................... 20
VII-2 Techniques récentes ............................................................................. 21
VII.2-a Le génie civil allégé ...................................................................................... 21
VII.2-b L’utilisation du réseau d’assainissement ......................................................... 22
VIII.
Documents de référence ............................................................................. 23
IX.
Glossaire ........................................................................................................ 25

2012 – Note de cadrage technique 4
I. Introduction
Le présent document traite des enjeux que représentent les réseaux à très haut débit et ultra
haut débit. Les programmes de déploiements FTTx, annoncés par les opérateurs (France
Telecom, Free, SFR/Neuf) que par des collectivités territoriales (Sipperec, CU du Grand Nancy,
CA du Pays d’Aix, CG92, etc…), montrent que la situation évolue rapidement pour les différents
segments d’applications. A plusieurs reprises, l’ARCEP a clairement souligné le rôle des
Collectivités Territoriales dans la mise en place des infrastructures FTTH, afin de garantir leur
neutralité et leur mutualisation. Le présent document a pour objectif de passer en revue les
différents aspects relatifs à ce domaine et à tracer les lignes directrices d’une approche
structurée permettant à la collectivité d’opérer les choix en toute connaissance de cause.
II. Hiérarchie des réseaux de communications électroniques
II-1
Hiérarchie et architectures de réseaux
Avant de comparer le positionnement respectif des différentes technologies, il convient de
considérer la hiérarchie structurelle dans les réseaux de communication. La figure 1 schématise
la situation.
Figure 1 : Hiérarchie des réseaux
Réseaux longue distance
Les réseaux longue distance (nationaux, pan-européens ou intercontinentaux) assurent
l’interconnexion entre plusieurs réseaux de collecte à travers des passerelles, souvent appelés
points de présence opérateur (POP) ; on parle alors de backbone. Dans le cas de l‘opérateur
historique, ces nœuds d’accès correspondent à la localisation des CAA (Commutateurs à
Autonomie d’Acheminement). Les technologies mises en œuvre à ce niveau sont
majoritairement des liaisons sur fibre optique, terrestres ou sous-marines.
Réseaux de collecte
Les réseaux de collecte, souvent appelés MAN, sont la base des boucles régionales,
départementales ou locales. Ces réseaux sont principalement basés sur des architectures en
boucles et des technologies fibres optiques ; en outre, on démultiplie la capacité de chacune
des fibres optiques par les techniques de multiplexage en longueur d’ondes (WDM).
En ce qui concerne les solutions techniques, on trouve en fait deux approches : l’approche
traditionnelle « télécom », basée sur SDH et ATM et une approche orientée IP connue sous le
nom MPLS (Multi Protocol Label Switching), qui présente des avantages indéniables en termes
économique et opérationnel.

2012 – Note de cadrage technique 5
Réseaux d’accès ou de desserte
Finalement, l’élément crucial notamment en terme économique correspond à la « chevelure »
(capillarité) qui constitue le dernier (ou le premier) bond vers les utilisateurs. C’est ce qu’on
appelle le réseau d’accès ou boucle locale. C’est le principal enjeu du déploiement du très haut
débit et de l’ultra haut débit dans la mesure où il constitue la part prépondérante des coûts de
construction des réseaux.
II-2
Principales technologies
On dispose d’une importante panoplie de technologies filaires ou hertziennes qui ont chacune
leurs avantages et inconvénients en fonction des applications.
Pour les infrastructures filaires, on trouve:
o la boucle locale cuivre est le champ d’action privilégié de l’opérateur historique France
Telecom; l’introduction des technologies xDSL apporte un certain nombre de contraintes,
notamment vis à vis des débits et de la portée ; néanmoins, il faudra considérer d’une
part l’évolution des normes (notamment ADSL 2+) qui augmente les débits en diminuant
la portée, et d’autre part les possibilités offertes par des solutions sur fibre optique
permettant de s’affranchir des limitations de portée ;
o les réseaux câblés de télédistribution, centrés sur les zones urbaines et disposant d’une
capacité multiservices ; ils mettent en œuvre une combinaison de transmission large
bande sur fibre optique et sur câble coaxial ;
o les réseaux optiques passifs, qui sont entre autres le support privilégié d’Ethernet à haut
débit (FastEthernet ou GigabitEthernet) ; ils peuvent être déployés sous la forme de
liaisons spécialisées (« point à point ») ou à partir d’architectures partagées telles que les
PON (Passive Optical Network = Réseau Optique Passif) dans diverses configurations ;
o les courants porteurs en ligne, qui sont adaptés aux réseaux locaux d’entreprise ou aux
réseaux domestiques, mais restent encore problématiques en réseau d’accès.
Du côté des réseaux « radio », on trouve une panoplie assez large comprenant:
o les réseaux satellites, notamment ceux dédiés à la diffusion directe, qui proposent
maintenant des solutions bidirectionnelles pour les services de données ;
o la télévision numérique terrestre, qui remplacera progressivement le réseau de diffusion
de télévision analogique sur les antennes individuelles ou collectives ;
o la boucle locale radio, avec les normes MMDS (à 3,5 GHz), LMDS (à 26 GHz) ou MVDS (à
40 GHz) ; la nouvelle norme générique (WirelessMAN™) qui couvre ces systèmes est le
802.16, dont la version 802.16d correspond au label Wimax d’interopérabilité des
matériels dans la bande des 3,4 – 3,6 GHz ; les fréquences correspondantes ont été
attribuées par l’ARCEP ; la nouvelle norme 802.16e permettra d’introduire les
fonctionnalités liées à la mobilité, après accord de l’ARCEP ;
o dans la même perspective, mais sur des fréquences plus élevées (bande Ku entre 10,7 et
12,5 GHz ou bande Q entre 40,5 et 43,5 GHz), certains constructeurs comme Bluwan
présentent des solutions propriétaires ;
o la téléphonie mobile avec les versions successives du GSM de deuxième génération
(WAP, GPRS, EDGE) et plus récemment de l’UMTS ; les technologies propriétaires de type
QDMA, permettant de mettre en œuvre des architectures maillées (meshed networks)
basées sur la combinaison de liaisons par bonds successifs « peer to peer », où chaque
station terminale joue le rôle de répéteur / routeur ;
o les réseaux locaux radio, avec des normes comme :
802.11b, dite WiFi, et ses dérivées 802.11a, 802.11g (WiFi 2) et 802.11n ;
la norme européenne Hiperlan 2, voisine de 802.11a, mais non compatible ;
d’autres technologies comme Bluetooth ou DECT ne rentrent pas dans la catégorie
large bande et multiservices.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
1
/
30
100%