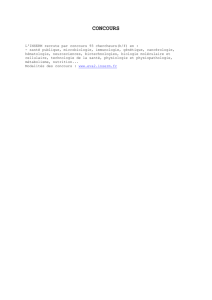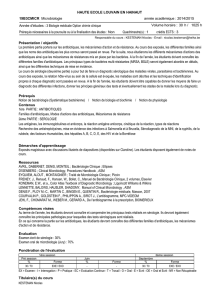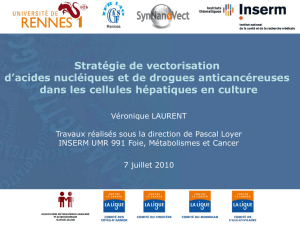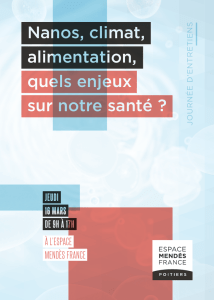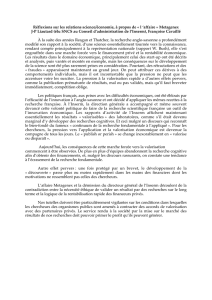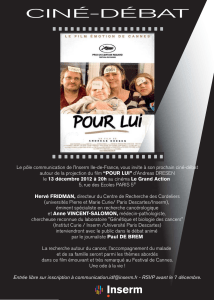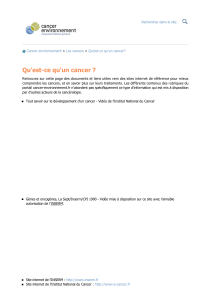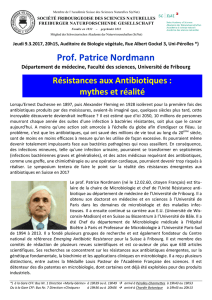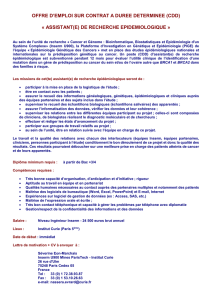UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4418

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4418
Numéro dans le SI local : CHAIRE INSERM
Référence GESUP : 0532
Corps : Maître de conférences
Article : 26-I-1
Chaire : Oui
Section 1 : 87-Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)
Section 2 :
Section 3 :
Profil : E:microbiologie
R:caractéris° des mécanismes de résistance ou/et d'adaptat° auxantibiotiques pour
ledéveloppement de modèles PK-PD semi-mécanistiques visant àoptimiser les stratégies
thérapeutiques
Job profile : Teaching : microbiology
research : characterization of resistance or/and adaptation mechanism for the
development of semi-mechanistic PK-PD models in ordre to optimize therapeutic
strategies
Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences Other
Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS
Localisation : UFR de Medecine et de Pharmacie
Code postal de la localisation : 86000
Etat du poste : Vacant
Adresse d'envoi du
dossier : 15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7; TSA 71117
86073 - POITIERS CEDEX 9
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58 05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
Date d'ouverture des candidatures
:16/02/2016
Date de fermeture des
candidatures : 30/03/2016, 16 heures heure de Paris
Date de prise de fonction : 01/09/2016
Mots-clés : résistance aux antibiotiques ; modélisation PK-PD ;
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR : UFR de Medecine et de Pharmacie
Profil recherche :
Laboratoire 1 : UMR_S1070 (201220154J) - PHARMACOLOGIE DES ANTI-INFECTIEUX
Dossier Papier OUI
Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB) NON
Dossier transmis par courrier
électronique NON e-mail gestionnaire
Application spécifique NON URL application

Informations Complémentaires
Ce poste correspond à une chaire mixte INSERM/Université de Poitiers
Le dispositif des Chaires mixtes vise à attirer des chercheurs de talent sur des postes définis en
concertation entre l’Inserm et une université dans le cadre d’une politique scientifique
commune.
Le lauréat sélectionné conjointement par l’Inserm et l’université de Poitiers, dans le cadre
d’un comité de sélection mixte, sera recruté par l’université en qualité de maître de
conférences et placé en délégation auprès de l’Inserm.
La Chaire permet ainsi à l’enseignant-chercheur de se consacrer, pendant une durée de cinq
ans, majoritairement au développement de son projet de recherche dans un environnement
scientifique approprié tandis qu’il développera ses compétences pédagogiques en assurant un
service d’enseignement limité à un tiers de temps.
Outre sa rémunération, le lauréat de la chaire Inserm – Université de Poitiers pourra
bénéficier de crédits destinés à soutenir sa recherche.
Job profile : Teaching : microbiology
Research : characterization of resistance or/and adaptation mechanism for the development of semi-mechanistic
PK-PD models in order to optimize therapeutic strategies
Enseignement :
Département d'enseignement : microbiologie en médecine et pharmacie
Lieu(x) d'exercice : UFR de Médecine et de Pharmacie - Poitiers
Equipe pédagogique :
Nom directeur département :
Tel directeur dépt. :
Email directeur dépt. :
URL dépt. :
Description du profil enseignement :
L’enseignement de microbiologie comprendra :
- La responsabilité du module "Virologie fondamentale et systémique" en 3ème année de pharmacie (17h
de Cours Magistraux)
- La participation au cours multidisciplinaire sur les pathologies infectieuses en DFASM2 (5ème année
médecine) (5x6h de Cours Magistraux)
Recherche :
Lieu(x) d'exercice : Laboratoire Inserm UMR_S 1070 – Pôle Biologie Santé - Poitiers
Nom directeur labo : Pr William COUET
Tel directeur labo : 05.49.45.43.79

Email directeur labo : [email protected]
URL labo : http://phar.labo.univ-poitiers.fr
Descriptif labo :
Le laboratoire de recherche « Pharmacologie des anti-infectieux » est une unité Inserm intégrée dans le
Pôle Biologie Santé de l’Université de Poitiers. L’objectif principal du laboratoire est d’optimiser le traitement
des infections bactériennes multi-résistantes.
Descriptif projet :
Description du profil recherche :
Le mauvais usage des antibiotiques est une des principales causes du développement des résistances
bactériennes. Ce phénomène a atteint une telle ampleur qu’il est devenu un enjeu majeur de santé publique. Le
problème est d’autant plus aigu pour les bactéries Gram(-) multi-résistantes qu’aucun nouvel antibiotique n’est
attendu dans les années à venir. Face à ce constat les pouvoirs publics ont initié plusieurs programmes
Européens dans la cadre du FP7, dont un intitulé « Old drugs for new bugs », afin d’évaluer l’intérêt potentiel et
éventuellement repositionner de vieilles molécules longtemps délaissées, pour lutter contre les bactéries
devenues résistantes. Dans le cadre de cet appel d’offre l’U1070 participe au projet AIDA
(http://www.aida-project.eu/) grâce à la reconnaissance qu’elle a acquise dans le domaine de la
pharmacocinétique des antibiotiques utilisés pour lutter contre les infections bactériennes sévères et en
particulier pour ses travaux portant sur la colistine.
Le développement de modèles pharmacocinétiques-pharmacodynamiques (PK-PD) semi-mécanistiques, permet
d’optimiser les posologies à la recherche du meilleur compromis efficacité-toxicité, mais aussi de limiter
l’émergence des résistances. Ces modèles permettent de proposer et tester de nouvelles stratégies
thérapeutiques comme par exemple le recours à des doses élevées en début de traitement (front loading
strategy) mais aussi d’optimiser la durée des traitements antibiotiques sur des bases rationnelles. Ces modèles
PK-PD semi-mécanistiques sont particulièrement utiles pour optimiser les schémas posologiques
d’antibiotiques utilisés en associations, ce qui est souvent le cas pour le traitement des infections sévères. Dans
le prolongement d’AIDA, l’U1070 vient d’être retenue avec 5 autres groupes pour participer à un projet jpiamr
afin d’identifier des associations prometteuses d’antibiotiques et d’optimiser leurs posologies par modélisations
PK-PD (http://www.jpiamr.eu/activities/joint-calls/secondjointcall/).
L’U1070 participe aussi à deux programmes IMI, Combacte-Care
http://www.combacte.com/About-us/COMBACTE-CARE et iABC http://www.imi.europa.eu/content/iabc,
beaucoup plus ambitieux et dont l’objectif consiste à développer de nouvelles molécules dans le cadre de
collaborations public-privé.
Mais les mécanismes d’adaptation ou de résistance des bactéries aux antibiotiques sont nombreux: modification
de la perméabilité par activation de pompes d’efflux ou action sur les porines, dégradation enzymatique,
modification de la cible…. Leur bonne compréhension est nécessaire au développement de modèles PK-PD
pertinents, mais elle est aussi utile afin de bien choisir les associations d’antibiotiques permettant de limiter, ou
même de « réverser » ces résistances. De plus l’acquisition d’une résistance peut s’accompagner d’une
modification de la virulence bactérienne et cet aspect doit aussi être pris en compte.
L’U1070 ne possède pas le savoir-faire en microbiologie nécessaire au développement de ces modèles PK-PD
et a donc jusque-là eu recours à des collaborations. Mais le développement rapide de la thématique justifie
maintenant le recrutement d’un expert dans le domaine.
Le ou la candidat(e) devra avoir acquis des connaissances approfondies en microbiologie durant sa thèse ou son
stage post-doctoral. Outre une bonne connaissance des mécanismes d'acquisition des résistances aux
antibiotiques, le ou la candidat(e) devra maîtriser les techniques de microbiologie et de biologie moléculaire
nécessaires à leur étude. Il/elle devra aussi être capable de développer-utiliser des modèles d’infection
expérimentale chez le rongeur. Une expérience préalable en expérimentation animale est donc fortement
souhaitée.

Le poste se situe à l’interface microbiologie-pharmacologie et nécessite une réelle ouverture d’esprit et
l’envie de travailler et de s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire (pharmacocinéticiens, chimistes
analystes, galénistes, cliniciens…), afin de participer à des travaux de recherche translationnelle visant à étudier
l'influence des schémas posologiques des antibiotiques, utilisés seuls ou en associations, sur leur efficacité et
sur les phénomènes d’adaptation ou/et d'acquisition de résistances.
Description activités complémentaires :
Moyens :
Moyens matériels :
Moyens humains :
Moyens financiers :
Autres moyens :
Autres informations :
Compétences particulières requises :
Evolution du poste :
Rémunération :
Job profile
research
The inappropriate use of antibiotics is one of the major cause of bacterial resistances which are becoming a
major threat for public health. This problem is of special concern for multidrug resistant (MDR) Gram(-)
bacteria since no new antibiotics are expected in the coming years. In order to address this issue, public health
authorities have launched several European projects within the FP7 framework, including one entitled “Old
drugs for new bugs” in order to assess the potential interest and possibly reposition old forgotten antibiotics in
order to fight against resistant new bugs. Our group, Inserm U1070, is involved in this program through AIDA
(http://www.aida-project.eu/) thanks to its expertise in pharmacokinetics and it’s recognition gained in the field
of antibiotics used for the treatment of severe infections, in particular colistin.
The development of semi-mechanistic pharmacokinetic-pharmacodynamic (PK-PD) models allows dosing
regimen optimization by increasing the efficacy versus toxicity ratio but also by controlling the emergence of
resistances. These models allow the characterization and new therapeutic alternatives such as front loading
strategies, but also to define the optimal treatment duration on rational bases. These PK-PD models are
especially useful for the optimization of antibiotics dosing regimens used in combinations, which is a common
practice for the treatment of severe infections. After AIDA, the U1070 has recently been selected to participate
with 5 other groups in a jpiamr project to identify potentially efficient antibiotics combinations and optimize
dosing regimens using PK-PD modeling (http://www.jpiamr.eu/activities/joint-calls/secondjointcall/).
Inserm U1070 team is also participating to two IMI programs: Combacte-Care
http://www.combacte.com/About-us/COMBACTE-CARE and iABC http://www.imi.europa.eu/content/iabc,
by far more ambitious with the objective of developing new antibiotics as part of a public-private
collaboration.
But many different types of mechanism may be responsible for adaptation or resistance of bacteria to
antibiotics, such as alteration of membrane permeability by activation of efflux pumps or interaction with
porins, enzymatic degradation, target alteration… A good understanding of these mechanisms is necessary to

develop relevant PK-PD models, but also to select the most efficient combinations to overcome or even
“reverse” resistances. Furthermore resistance acquisition may be accompanied with changing virulence, which
needs also to be taken into consideration.
Inserm U1070 does not possess the necessary skills in microbiology to develop the most relevant PK-PD
models and had to develop collaborations in order to overcome this limitation. However the rapid development
of the area makes necessary the recruitment of an expert in microbiology.
The candidate must have gained deep expertise in microbiology during his/her PhD or post-doctoral training.
Apart from a good theoretical understanding of resistance mechanism to antibiotics, the candidate must be able
to handle the main techniques used in microbiology and molecular biology for their investigation. He/she will
also be able to develop and use experimental models of infections in rodents. Therefore animal handling
background is more than welcome.
The position lies at the interface between microbiology and pharmacology and would be suited to an
open-minded candidate with a real willingness to work as a team-player in a multidisciplinary environment
(pharmacokineticist, analytical chemists, drug formulation specialists, clinicians…) in order to develop
translational research to investigate the consequences of changing antibiotics dosing regimen, administered
alone or in combination, on their efficacy and ability to enhance the development of resistances.
Teaching
The teaching in microbiology will cover :
- Responsability of a module "Fundamental and applied virology" in 3rd year of pharmacy (17h of
“Cours Magistraux”)
- Participation to multidisciplinary courses on infectious diseases (DFASM2 – 5th year of medicine -
5x6h of “Cours Magistraux”)
 6
6
1
/
6
100%